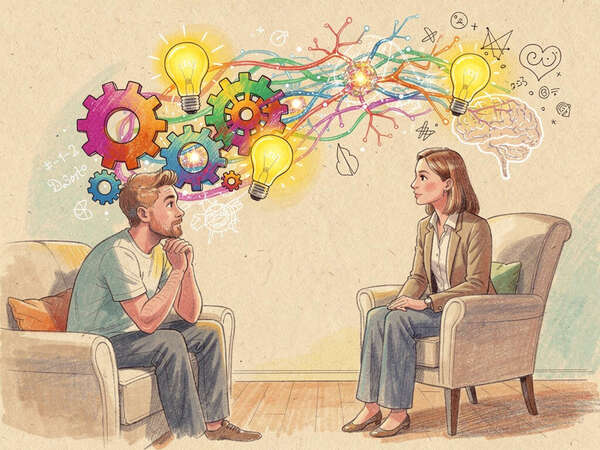Implication des personnes avec une déficience intellectuelle dans la recherche participative
La posture traditionnelle du chercheur, observateur distant d’une réalité qu’il prétend objectiver, trouve ses limites les plus manifestes lorsqu’elle s’applique à l’expérience humaine de la déficience intellectuelle. Durant des décennies, le champ de la recherche a traité les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) comme des « sujets » passifs, des réceptacles de nos investigations, des objets d’étude dont on analyse les déficits, les comportements et les besoins depuis une tour d’ivoire académique. Cette approche, héritée d’un paradigme positiviste et médicalisant, a certes produit un corpus de connaissances, mais à quel prix ? Elle a systématiquement exclu la perspective des premiers concernés, invalidant leur savoir expérientiel et renforçant les dynamiques de pouvoir qui contribuent à leur marginalisation.
Aujourd’hui, un changement de paradigme s’impose avec la force d’une évidence éthique et d’une nécessité épistémologique. Ce tournant est celui de la recherche participative. Il ne s’agit plus simplement d’étudier « sur » un groupe, mais de construire la connaissance « avec » lui. Ce mouvement, porté par le slogan emblématique des mouvements pour les droits des personnes handicapées, « Rien sur nous sans nous » (Nothing About Us Without Us), invite à une refonte radicale de nos méthodologies et de notre posture déontologique. Impliquer des personnes ayant une DI non plus comme simples participants, mais comme co-chercheurs, partenaires actifs à toutes les étapes du processus de recherche – de la formulation de la question initiale à la diffusion des résultats – n’est pas un simple ajout méthodologique. C’est une révolution conceptuelle qui interroge la nature même du savoir, sa légitimité et sa finalité. Cet article se propose d’explorer en profondeur les fondements, les bénéfices, les défis et les modalités pratiques de cette approche, en soutenant la thèse qu’elle constitue non seulement une pratique plus juste, mais également une voie vers une science plus rigoureuse, plus pertinente et plus transformatrice.
A. Fondements Conceptuels et Historiques : De l’Objet d’Étude à l’Acteur de la Recherche
La recherche participative, dans son essence, n’est pas une innovation récente. Ses racines plongent dans les travaux de Kurt Lewin sur la recherche-action dans les années 1940, qui postulaient déjà que la meilleure façon de comprendre un système social est d’essayer de le changer. Cependant, son application au champ de la déficience intellectuelle est le fruit d’une convergence plus tardive entre la critique des sciences sociales, les théories critiques et, surtout, la montée en puissance des mouvements d’auto-représentation (self-advocacy) des personnes handicapées à partir des années 1970.
Le modèle traditionnel de recherche, souvent qualifié de modèle « extractif », se fonde sur une asymétrie de pouvoir fondamentale. Le chercheur, détenteur du savoir théorique et méthodologique, définit le problème, conçoit les outils, collecte les données auprès des participants, les analyse et en tire des conclusions qu’il diffuse au sein de la communauté scientifique. Dans ce schéma, la personne avec une DI est un « sujet-objet » ; son expérience est une matière première à analyser, mais sa capacité à produire une analyse ou à façonner le processus est niée ou ignorée. Cette approche a conduit à une abondante littérature décrivant les « déficits » et les « problèmes » associés à la DI, souvent déconnectée des priorités et des aspirations des personnes elles-mêmes. Les questions de recherche étaient celles que les chercheurs, les cliniciens ou les décideurs politiques jugeaient importantes, et non celles qui émergeaient de l’expérience vécue de l’exclusion, de la recherche d’autonomie ou du désir d’inclusion sociale.
La recherche participative opère une rupture épistémologique radicale avec ce modèle. Elle repose sur le principe que les personnes ayant une expérience vécue d’un phénomène (ici, la DI) possèdent une expertise unique et indispensable – un savoir expérientiel – qui est complémentaire et de valeur égale au savoir académique du chercheur. La personne avec une DI n’est plus un objet d’étude mais un « sujet-acteur », un partenaire épistémique. Ce partenariat se manifeste par la création d’équipes de recherche inclusives où des chercheurs académiques collaborent avec des personnes ayant une DI, qui acquièrent le statut de « co-chercheurs ».
Cette collaboration peut prendre diverses formes, allant de la consultation ponctuelle à un co-pilotage intégral du projet. Les modèles les plus aboutis, comme la Recherche-Action Participative (RAP), visent un double objectif : produire des connaissances scientifiquement valides et provoquer un changement social concret au bénéfice de la communauté impliquée. Le processus devient cyclique : l’action informe la recherche, et la recherche informe l’action. Dans ce cadre, l’implication des co-chercheurs avec DI est transversale :
- Définition du problème et des questions de recherche : Les priorités sont définies conjointement, assurant leur pertinence pour la communauté.
- Conception de la méthodologie : Les outils (questionnaires, guides d’entretien) sont co-construits pour être accessibles, respectueux et culturellement adaptés.
- Collecte des données : Les co-chercheurs peuvent participer activement au recrutement et à la collecte, créant un environnement de confiance pour les autres participants.
- Analyse et interprétation des données : Leur perspective unique permet de nuancer l’analyse, d’éviter les mésinterprétations et de faire émerger des thèmes que le chercheur académique n’aurait pas identifiés.
- Diffusion des résultats : Les résultats sont partagés dans des formats accessibles (langage Facile à Lire et à Comprendre, vidéos, présentations théâtrales) pour atteindre non seulement les cercles académiques mais aussi la communauté, les familles et les décideurs.
Ce faisant, la recherche participative ne se contente pas de démocratiser le processus de recherche ; elle en redéfinit la finalité. Le but n’est plus seulement de comprendre le monde, mais de le transformer en collaboration avec ceux qui y vivent.
B. Les Bénéfices Épistémologiques et Scientifiques : Vers une Rigueur Accrue
Loin d’être un compromis sur la rigueur scientifique au nom de l’éthique, la recherche participative, lorsqu’elle est menée avec soin, renforce la qualité et la validité de la recherche de multiples manières. L’implication de co-chercheurs avec une DI n’est pas un supplément d’âme, mais un avantage méthodologique stratégique.
Premièrement, elle améliore de façon spectaculaire la pertinence des questions de recherche. Les chercheurs universitaires, même les plus empathiques, opèrent à partir de cadres théoriques et de préoccupations institutionnelles qui peuvent être éloignés des réalités quotidiennes des personnes avec une DI. En impliquant ces dernières dès la genèse du projet, on s’assure que la recherche s’attaque à des problématiques qui ont un sens et une importance réels pour elles. Au lieu de se demander « Quels sont les facteurs prédictifs de l’échec de l’insertion professionnelle ? », la question pourrait devenir, sous l’impulsion des co-chercheurs : « Comment créer un environnement de travail où je me sens compétent et respecté ? ». Ce changement de perspective n’est pas anodin ; il déplace le focus du déficit individuel vers les barrières systémiques et les solutions capacitantes.
Deuxièmement, la co-conception des outils de recherche augmente leur validité et leur fiabilité. Un questionnaire ou un guide d’entretien élaboré uniquement par des universitaires peut contenir un jargon, des concepts abstraits ou des formulations involontairement infantilisantes ou stigmatisantes. Les co-chercheurs avec une DI peuvent identifier ces écueils et aider à reformuler les questions en langage clair, à utiliser des supports visuels ou à proposer des méthodes de collecte de données alternatives (photovoice, narration, dessin) qui permettent une expression plus riche et authentique. Cela réduit les biais de réponse liés à l’incompréhension ou à l’anxiété et permet de recueillir des données de meilleure qualité.
Troisièmement, l’étape de l’analyse et de l’interprétation des données est profondément enrichie. Un chercheur académique peut interpréter un silence ou une réponse hésitante d’un participant comme un manque de compréhension. Un co-chercheur avec une DI pourrait y voir l’expression d’une peur du jugement, le souvenir d’une expérience passée ou une critique implicite de la question posée. Cette « traduction culturelle » et expérientielle est cruciale pour éviter les biais interprétatifs et pour saisir la complexité des significations. Les co-chercheurs apportent un niveau de granularité et d’authenticité à l’analyse que l’observation extérieure ne peut atteindre. Ils aident à distinguer ce qui relève de la DI et ce qui relève de l’expérience universelle de l’oppression, de l’amitié ou de l’espoir.
Quatrièmement, la validité écologique et sociale de la recherche est renforcée. La validité écologique concerne la mesure dans laquelle les résultats d’une étude peuvent être généralisés à des contextes de vie réelle. En ancrant la recherche dans les expériences vécues et les environnements quotidiens, la recherche participative produit des résultats qui sont intrinsèquement plus connectés à la réalité du terrain. La validité sociale, quant à elle, se réfère à l’acceptabilité et à l’utilité des objectifs, des procédures et des résultats de la recherche pour la communauté concernée. Une recherche co-construite est, par définition, socialement plus valide, car elle a été façonnée et validée par les parties prenantes tout au long du processus.
Enfin, la diffusion et l’application des connaissances (knowledge translation) deviennent plus efficaces. Les publications dans des revues scientifiques à comité de lecture sont essentielles, mais elles atteignent rarement les personnes avec une DI, leurs familles ou les professionnels de première ligne. Les co-chercheurs sont des vecteurs de diffusion exceptionnels. Ils peuvent co-créer des synthèses en langage Facile à Lire, des vidéos, des ateliers ou des pièces de théâtre pour partager les résultats de manière engageante et accessible. Cette diffusion multi-formats garantit que les connaissances produites ne restent pas lettre morte dans les bibliothèques universitaires, mais qu’elles informent réellement les pratiques, les politiques et la vie des gens.
C. Les Retombées Éthiques et l’Empowerment des Participants : Au-delà de la Justice Procédurale
Si les bénéfices scientifiques sont indéniables, le cœur de la recherche participative réside dans sa dimension éthique et transformatrice pour les individus impliqués. Elle va bien au-delà des principes éthiques procéduraux classiques (consentement éclairé, confidentialité), bien que ceux-ci doivent être adaptés et renforcés. Elle incarne une éthique de la justice sociale, de la reconnaissance et de l’empowerment.
L’empowerment, ou capacitation, est sans doute l’impact le plus significatif. En passant du statut d’objet d’étude à celui de producteur de savoir, les co-chercheurs avec une DI vivent une expérience profondément valorisante. Ils développent un large éventail de compétences concrètes : parler en public, animer une réunion, utiliser des logiciels, analyser des textes, argumenter une position. Cette acquisition de compétences renforce leur estime de soi et leur sentiment d’auto-efficacité. Ils réalisent qu’ils ont une expertise valable et une contribution unique à apporter, ce qui peut avoir des effets en cascade sur d’autres sphères de leur vie, comme l’emploi, l’engagement civique ou les relations interpersonnelles.
Cette approche opère également une déconstruction des asymétries de pouvoir. La relation chercheur-participant est intrinsèquement hiérarchique. La recherche participative s’efforce de la transformer en une relation de partenariat et de réciprocité. Les chercheurs académiques doivent apprendre à lâcher prise, à écouter, à se défaire de leur posture d’expert unique pour devenir des facilitateurs et des alliés. De leur côté, les co-chercheurs avec une DI apprennent à prendre leur place, à exprimer leurs opinions et à challenger les idées des universitaires. Ce processus de négociation et d’apprentissage mutuel est en soi une forme d’action sociale qui modifie les représentations et les dynamiques relationnelles bien au-delà du seul projet de recherche.
Sur le plan de l’autodétermination, la recherche participative offre une plateforme pour que les personnes avec une DI puissent définir leurs propres problèmes et proposer leurs propres solutions. Cela est fondamentalement aligné avec les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui insiste sur le droit à la participation pleine et effective à la société. En façonnant la recherche qui les concerne, ils façonnent indirectement les politiques publiques et les pratiques professionnelles qui en découleront, promouvant ainsi des solutions qui soutiennent réellement leur autonomie et leur inclusion, plutôt que des approches paternalistes.
Enfin, cette démarche permet de lutter contre le tokenisme, c’est-à-dire la pratique consistant à faire une concession superficielle ou symbolique à un groupe minoritaire. Une véritable recherche participative ne se contente pas d’inviter une personne avec une DI à une réunion pour cocher une case. Elle implique un investissement substantiel en temps, en formation et en soutien pour garantir que leur participation soit significative, informée et influente à chaque étape. Cela exige une rémunération équitable pour leur travail de co-chercheur, reconnaissant ainsi leur contribution comme une véritable expertise professionnelle. En traitant les co-chercheurs avec une DI comme des collègues à part entière, on envoie un message puissant qui combat la stigmatisation et valorise leur citoyenneté.
D. Défis Méthodologiques et Considérations Pratiques : Naviguer la Complexité
Adopter une démarche de recherche participative avec des personnes ayant une DI n’est pas un chemin exempt d’obstacles. Reconnaître et anticiper ces défis est une condition sine qua non à la réussite et à l’intégrité du projet.
Le premier défi est celui du temps et des ressources. La recherche participative est intrinsèquement plus lente que la recherche traditionnelle. Construire la confiance, former l’équipe, développer des modes de communication accessibles, prendre des décisions de manière consensuelle – tout cela demande un investissement temporel considérable qui est souvent en décalage avec les calendriers serrés des financements de recherche. Les budgets doivent également prévoir des postes de dépenses spécifiques : rémunération des co-chercheurs, salaires des facilitateurs ou accompagnateurs, frais de transport adaptés, création de matériel en format accessible, etc. Les agences de financement et les institutions académiques doivent faire évoluer leurs critères pour reconnaître et soutenir cette spécificité.
La question de la représentativité et du recrutement est également complexe. Comment s’assurer que les co-chercheurs impliqués ne représentent pas uniquement les personnes les plus verbales ou ayant les plus grandes facilités, laissant de côté celles ayant des besoins de soutien plus importants ou des difficultés de communication ? Les stratégies de recrutement doivent être proactives et diversifiées, en s’appuyant sur des réseaux communautaires variés. Il est crucial d’inclure des personnes avec différents niveaux de DI, y compris celles qui communiquent de manière non verbale, ce qui exige des méthodes d’implication encore plus créatives et adaptées (par exemple, via des facilitateurs spécialisés en communication alternative et améliorée).
Un défi majeur réside dans la gestion des dynamiques de pouvoir, même au sein d’équipes bien intentionnées. Les chercheurs académiques, de par leur statut, leur vocabulaire et leurs habitudes de travail, peuvent involontairement dominer les discussions et imposer leurs vues. Les co-chercheurs avec une DI peuvent, à l’inverse, se sentir intimidés ou hésiter à contredire l’« expert ». Il est donc indispensable de mettre en place des mécanismes pour équilibrer les prises de parole, de former les chercheurs académiques à une posture de facilitation et d’écoute active, et de créer un climat de sécurité psychologique où chaque opinion est légitime et respectée. La présence d’un facilitateur externe, neutre, peut s’avérer précieuse.
L’adaptation des procédures éthiques standards pose aussi question. Le consentement éclairé, par exemple, ne peut se résumer à la signature d’un formulaire. Il doit être un processus continu, dialogué, utilisant des supports accessibles pour s’assurer que les co-chercheurs comprennent pleinement leur rôle, les risques et les bénéfices, et qu’ils peuvent se retirer à tout moment sans préjudice. Les comités d’éthique de la recherche, souvent peu familiers avec ces approches, peuvent se montrer rigides et soulever des objections basées sur une vision protectionniste plutôt que capacitante, ce qui constitue une barrière institutionnelle importante.
Enfin, il existe un risque de surcharge ou d’instrumentalisation des co-chercheurs. Leur expertise étant précieuse, ils peuvent être sur-sollicités. Il est essentiel de définir clairement les attentes, la charge de travail et de veiller à leur bien-être. L’instrumentalisation survient lorsque leur participation reste symbolique, utilisée pour légitimer un projet sans que leur influence soit réelle. Pour contrer cela, il faut une transparence totale sur les processus de décision et des exemples concrets de la manière dont leurs contributions ont modifié le cours de la recherche.
E. Stratégies et Approches pour une Mise en Œuvre Réussie
Surmonter les défis de la recherche participative exige une planification méticuleuse, de la flexibilité et un engagement authentique envers ses principes. Plusieurs stratégies concrètes ont fait leurs preuves.
L’étape initiale et fondamentale est la construction de relations de confiance. Cela se fait en amont du projet, en passant du temps au sein de la communauté, en participant à des événements, en écoutant les préoccupations sans agenda de recherche immédiat. La recherche doit émerger de la relation, et non l’inverse.
Une formation adéquate et réciproque est indispensable. Les co-chercheurs avec une DI ont besoin d’une formation sur les concepts de base de la recherche (qu’est-ce qu’une question de recherche, l’éthique, la confidentialité, etc.), dispensée de manière accessible. Simultanément, les chercheurs académiques et les étudiants doivent être formés sur la DI, l’histoire du mouvement d’auto-représentation, les techniques de communication inclusive et la posture de facilitation. Cette co-formation crée un langage et une culture commune au sein de l’équipe.
La communication doit être systématiquement accessible. Cela implique l’utilisation du langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) pour tous les documents écrits, le recours à des supports visuels (icônes, photos, schémas), la structuration claire des réunions avec des ordres du jour visuels, et la vérification régulière de la compréhension mutuelle. Chaque réunion devrait être co-animée par un chercheur académique et un co-chercheur avec DI.
La flexibilité méthodologique est la clé. Il faut être prêt à adapter les plans, les calendriers et les méthodes en fonction des besoins et des idées de l’équipe. Si une méthode de collecte de données s’avère trop complexe ou stressante, l’équipe doit pouvoir pivoter vers une autre approche co-développée. Cette agilité est une force, non une faiblesse.
Un soutien continu doit être assuré pour les co-chercheurs. Cela peut prendre la forme d’un mentor ou d’un « ami de recherche » (research buddy), une personne ressource dédiée qui peut répondre aux questions en dehors des réunions, aider à préparer les interventions et s’assurer que le co-chercheur se sent à l’aise et soutenu. Ce soutien permet de prévenir le découragement et de garantir une participation effective sur le long terme.
La clarification des rôles et des responsabilités dès le départ est essentielle pour éviter les malentendus. Un accord d’équipe, co-rédigé, peut définir qui fait quoi, comment les décisions sont prises (consensus, vote), comment les conflits sont gérés et quelles sont les règles de base pour une collaboration respectueuse.
Enfin, une rémunération juste et équitable est un principe non négociable. Le travail des co-chercheurs est une expertise qui doit être reconnue financièrement, au même titre que celle des autres membres de l’équipe. Cela affirme leur statut de professionnels et respecte la valeur de leur contribution.
F. L’Avenir de la Recherche Inclusive : Perspectives et Innovations
La recherche participative avec les personnes ayant une DI n’est plus à la marge ; elle est de plus en plus reconnue comme un standard d’excellence. Son avenir dépendra de notre capacité à la systématiser, à l’innover et à l’intégrer pleinement dans les structures académiques et politiques.
Une première perspective est l’intégration des technologies. Les outils de collaboration en ligne, les plateformes de communication améliorée et alternative (CAA), les applications mobiles pour la collecte de données ou les logiciels de transcription vocale peuvent lever de nombreuses barrières à la participation, notamment pour les personnes ayant des limitations de mobilité ou des difficultés de communication importantes. L’enjeu sera de co-concevoir ces technologies pour qu’elles soient véritablement inclusives et non un nouveau facteur d’exclusion numérique.
Une autre voie de développement est le passage de la recherche avec à la recherche menée par des personnes ayant une DI. Il s’agit de l’étape ultime de l’empowerment, où des chercheurs ayant eux-mêmes une DI dirigent leurs propres projets de recherche, en engageant des universitaires comme consultants ou collaborateurs techniques. Cela exige de repenser les parcours de formation universitaire pour les rendre accessibles et de créer des postes de chercheurs pour des personnes issues de ces parcours.
Pour que ces approches se généralisent, un changement institutionnel profond est nécessaire. Les universités doivent intégrer des modules sur la recherche inclusive dans tous les cursus de sciences humaines et sociales et de santé. Les comités d’éthique doivent développer une expertise spécifique pour évaluer ces projets de manière adéquate. Les agences de financement doivent créer des programmes dédiés qui reconnaissent la valeur et les exigences de la recherche participative.
L’impact à long terme de la recherche participative se mesurera à sa capacité à influencer les politiques publiques et les pratiques professionnelles. Les résultats issus de ces recherches, parce qu’ils sont ancrés dans la réalité et co-validés par les premiers concernés, ont une légitimité et une force de persuasion uniques. Ils peuvent fournir des données probantes pour un plaidoyer en faveur de services plus personnalisés, d’environnements plus inclusifs et de lois plus justes, réalisant ainsi la boucle vertueuse de la recherche-action.
Conclusion
L’implication des personnes ayant une déficience intellectuelle comme partenaires de recherche n’est ni une concession charitable, ni une mode passagère. C’est une exigence fondamentale qui découle d’une double prise de conscience : d’une part, l’injustice et les limites épistémologiques d’un modèle de recherche qui a longtemps parlé « sur » elles sans jamais leur donner la parole ; d’autre part, l’immense potentiel d’une science co-construite qui allie la rigueur méthodologique à la richesse du savoir expérientiel.
En transformant la dynamique de pouvoir, en valorisant des compétences et des perspectives jusqu’alors ignorées, et en orientant la production de savoir vers des objectifs de justice sociale et d’autodétermination, la recherche participative offre bien plus que des données de meilleure qualité. Elle offre une voie vers une science plus humaine, plus pertinente et plus responsable. Les défis sont réels et ne doivent pas être minimisés. Ils exigent des chercheurs, des institutions et des bailleurs de fonds un investissement sincère, une humilité intellectuelle et une volonté de réinventer leurs pratiques. Mais l’enjeu en vaut la peine. Car, en définitive, il ne s’agit pas simplement de changer la manière dont nous faisons de la recherche. Il s’agit de contribuer, par la recherche, à changer le monde pour et avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il ne s’agit plus de leur donner une voix, mais de reconnaître, de respecter et d’amplifier celle qui existe déjà.
Les sources :
Bigby, C., & Frawley, P. (2020). A framework for supported decision-making by people with cognitive disability. Australian Journal of Social Issues, 55(2), 156–172. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajs4.94
Frankena, T. K., Naaldenberg, J., Cardol, M., Linehan, C., & van Schrojenstein Lantman-de Valk, H. (2015). A consensus statement on how to conduct inclusive health research. Journal of Intellectual Disability Research, 59(9), 857–866. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jir.12194
Jurkowski, J. M. (2008). Participatory Research with Children and Youth. In L. M. Given (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (pp. 603-607). SAGE Publications, Inc. https://methods.sagepub.com/reference/sage-encyc-qualitative-research-methods/n306.xml [Note: Bien que plus ancien, ce texte de référence reste fondamental pour les principes de base].
McDonald, K. E., & Raymaker, D. M. (2013). Paradigm shifts in disability and health: Toward more ethical public health research. American Journal of Public Health, 103(12), 2165–2173. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828965/
Ní Shé, É., O’Donnell, E., O’Shea, M., & O’Brien, P. (2022). Power dynamics in a long-term inclusive research partnership. Disability & Society, 37(4), 541–561. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2020.1834914
O’Brien, P., Ní Shé, É., & O’Donnell, E. (2021). Building Capacity for Inclusive Research: A Co-Created Model of Research Training for People with Intellectual Disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(3), 882-892. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12856
Povee, K., & Roberts, D. (2021). Valuing and facilitating the inclusion of people with intellectual disabilities as co-researchers: ‘It is a good thing to be involved in research, it makes you feel proud and clever’. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(6), 1461–1470. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12903
Strnadová, I., & Walmsley, J. (2021). From Research on to Research with and by People with Intellectual Disabilities. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-1466
Walmsley, J., & Johnson, K. (2003). Inclusive research with people with learning disabilities: Past, present and futures. Jessica Kingsley Publishers. [Note: ouvrage fondateur, cité ici pour son importance historique et conceptuelle persistante dans les travaux récents].
Wenger, K. R., McDonald, K. E., & Glick, Z. D. (2021). Perceptions of Co-Researcher Roles of People with Intellectual and Developmental Disabilities on Research Teams. Intellectual and Developmental Disabilities, 59(5), 417–429. https://meridian.allenpress.com/idd/article/59/5/417/469440/Perceptions-of-Co-Researcher-Roles-of-People-with