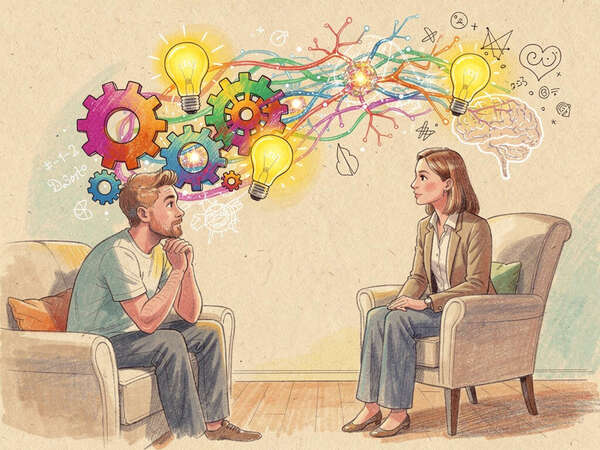Les troubles de la personnalité : Quelles sont les approches thérapeutiques modernes ?
La personnalité, ce substrat stable et singulier qui colore nos perceptions, nos émotions et nos comportements, est au cœur de l'expérience humaine. Elle est la signature psychologique de l'individu, façonnée au gré des prédispositions innées et des expériences vécues. Mais où se situe la frontière entre une personnalité simplement "difficile" et un trouble pathologique ? Quand les traits qui nous définissent cessent-ils d'être une simple facette de notre identité pour devenir la source d'une souffrance envahissante et d'un dysfonctionnement persistant ? C'est à cette intersection complexe que se situe le champ des troubles de la personnalité, une des catégories diagnostiques les plus ardues et les plus stigmatisées de la psychopathologie.
Longtemps considérés comme des conditions immuables et réfractaires au traitement, les troubles de la personnalité font aujourd'tui l'objet d'un profond renouvellement conceptuel et thérapeutique. La recherche contemporaine, s'appuyant sur les neurosciences affectives, la génétique comportementale et la psychologie du développement, a permis de déconstruire les anciens dogmes. Nous comprenons désormais ces troubles non pas comme des défauts de caractère, mais comme des stratégies d'adaptation complexes, bien que dysfonctionnelles, développées en réponse à des environnements précoces souvent adverses.
Cet article se propose de dresser un panorama actualisé de la compréhension des troubles de la personnalité. Nous naviguerons des modèles de classification en pleine mutation, qui délaissent progressivement les catégories rigides pour une approche dimensionnelle plus nuancée, à l'exploration de leur étiologie multifactorielle. Enfin, nous nous attarderons sur les avancées thérapeutiques majeures qui, aujourd'hui, offrent des perspectives d'amélioration et de rémission réelles pour des millions d'individus. Il s'agit d'offrir une synthèse rigoureuse, destinée à éclairer la complexité de ces pathologies et à souligner l'espoir porté par les approches modernes fondées sur des preuves.
A. La Nosographie des Troubles de la Personnalité : D'une Approche Catégorielle à une Vision Dimensionnelle
La manière dont nous classifions et définissons les troubles mentaux n'est pas neutre ; elle influence directement le diagnostic, la recherche et la prise en charge. Dans le domaine des troubles de la personnalité, nous assistons à une transition paradigmatique majeure, passant d'un modèle catégoriel historique à une perspective dimensionnelle plus flexible et empiriquement fondée.
Le modèle catégoriel traditionnel et ses limites
Le modèle dominant depuis plusieurs décennies, incarné par le DSM-5 (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, 5ème édition) et l'ICD-10 (Classification Internationale des Maladies, 10ème révision), est un modèle dit "catégoriel". Il postule que les troubles de la personnalité sont des entités distinctes, qualitativement différentes de la personnalité normale. Un individu "a" ou "n'a pas" un trouble, sur la base de la présence d'un certain nombre de critères diagnostiques. Ces troubles sont organisés en trois grands clusters (ou groupes) :
Cluster A (bizarre ou excentrique) :
- Trouble de la personnalité paranoïaque : Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres.
- Trouble de la personnalité schizoïde : Détachement des relations sociales et restriction de la variété des expressions émotionnelles.
- Trouble de la personnalité schizotypique : Compétences sociales et interpersonnelles déficitaires marquées par une gêne aiguë, associées à des distorsions cognitives ou perceptuelles et à des conduites excentriques.
Cluster B (dramatique, émotionnel ou erratique) :
- Trouble de la personnalité antisociale : Mépris et transgression des droits d'autrui.
- Trouble de la personnalité borderline (ou limite) : Instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée.
- Trouble de la personnalité histrionique : Réponses émotionnelles excessives et quête d'attention.
- Trouble de la personnalité narcissique : Fantaisies ou comportements grandioses, besoin d'être admiré et manque d'empathie.
Cluster C (anxieux ou craintif) :
- Trouble de la personnalité évitante : Inhibition sociale, sentiments de ne pas être à la hauteur et hypersensibilité au jugement négatif d'autrui.
- Trouble de la personnalité dépendante : Comportement de soumission lié à un besoin excessif d'être pris en charge.
- Trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive : Préoccupation par l'ordre, la perfection et le contrôle.
Bien qu'utile sur le plan heuristique, ce modèle catégoriel présente des limites importantes, largement documentées :
- Comorbidité excessive : Il est extrêmement fréquent qu'un patient réponde aux critères de plusieurs troubles de la personnalité, ce qui remet en question la validité de ces catégories distinctes.
- Hétérogénéité intra-diagnostique : Deux individus diagnostiqués avec le même trouble (par exemple, le trouble borderline) peuvent ne partager qu'un seul critère diagnostique, présentant des tableaux cliniques très différents.
- Seuils diagnostiques arbitraires : La ligne de démarcation entre la présence et l'absence d'un trouble est souvent artificielle. Un patient avec quatre critères du trouble borderline n'est pas diagnostiqué, tandis qu'un autre avec cinq l'est, bien que leur niveau de souffrance puisse être similaire.
- Stigmatisation : L'attribution d'une étiquette diagnostique catégorielle peut être réductrice et stigmatisante, masquant la singularité de l'individu.
L'émergence des modèles dimensionnels
Face à ces critiques, la recherche s'est orientée vers des modèles dimensionnels qui conçoivent la pathologie de la personnalité comme l'expression extrême de traits de personnalité que tout le monde possède à des degrés divers. Cette approche est plus alignée avec les données empiriques et offre une description plus fine et individualisée.
Le Modèle Alternatif pour les Troubles de la Personnalité (AMPD), proposé en section III du DSM-5, illustre cette transition. Il évalue la pathologie de la personnalité sur deux axes principaux :
- Critère A : Niveau de fonctionnement de la personnalité. Il s'agit d'évaluer les altérations dans le fonctionnement du soi (identité, auto-direction) et le fonctionnement interpersonnel (empathie, intimité). Ce critère permet d'établir la sévérité globale du trouble.
- Critère B : Traits de personnalité pathologiques. Ce critère s'appuie sur un modèle de cinq grands domaines de traits, inspiré du modèle des "Big Five" de la personnalité normale, mais orienté vers la pathologie :
- Affectivité Négative (vs. Stabilité Émotionnelle) : Tendance à éprouver intensivement et fréquemment des émotions négatives.
- Détachement (vs. Extraversion) : Évitement des expériences socio-émotionnelles.
- Antagonisme (vs. Amabilité) : Comportements qui mettent l'individu en opposition avec les autres.
- Désinhibition (vs. Méticulosité/Contrôle) : Tendance à l'impulsivité et à la recherche de gratification immédiate.
- Psychoticisme (vs. Lucidité) : Tendance à avoir des expériences cognitives et perceptuelles inhabituelles et excentriques.
Chaque domaine se décline en facettes plus spécifiques, permettant un profilage très détaillé du patient.
L'ICD-11 a franchi un pas encore plus décisif. Elle a abandonné les dix catégories traditionnelles pour un diagnostic principal basé sur la sévérité du dysfonctionnement de la personnalité (léger, modéré, sévère). Ce diagnostic peut ensuite être complété par la description de "qualificateurs de domaines de traits" (affectivité négative, détachement, dissocialité, désinhibition, anankastie/obsessionnalité), qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Cette approche est radicalement dimensionnelle et vise à capturer la complexité clinique de manière plus fidèle.
Cette évolution nosographique n'est pas un simple débat d'experts. Elle transforme la pratique clinique en favorisant une évaluation personnalisée qui guide plus précisément le plan de traitement, en se concentrant sur les mécanismes dysfonctionnels sous-jacents plutôt que sur une simple étiquette.
B. Étiologie Multifactorielle : L'Interaction Complexe entre Gènes et Environnement
Aucun trouble de la personnalité ne peut être attribué à une cause unique. La vision contemporaine est celle d'une étiologie multifactorielle, où des vulnérabilités biologiques et génétiques interagissent de manière dynamique avec des facteurs environnementaux et psychologiques, le plus souvent durant les périodes critiques du développement. Le modèle diathèse-stress est ici particulièrement pertinent.
Facteurs génétiques et neurobiologiques (la diathèse)
La recherche en génétique comportementale, notamment les études sur les jumeaux et les adoptions, a démontré une héritabilité modérée pour les troubles de la personnalité, généralement estimée entre 30% et 60%. Il ne s'agit pas de "gènes d'un trouble" spécifique, mais plutôt de l'héritabilité de tempéraments de base qui constituent des facteurs de risque. Par exemple, des traits comme l'impulsivité, la recherche de nouveauté, l'évitement du danger ou l'instabilité affective ont une composante génétique significative.
Ces prédispositions génétiques se traduisent par des particularités au niveau de la structure et du fonctionnement cérébral. Les études en neuroimagerie ont mis en évidence des corrélats neurobiologiques, particulièrement dans le trouble de la personnalité borderline :
- Dérégulation du circuit cortico-limbique : On observe fréquemment une hyperactivité de l'amygdale (structure clé dans le traitement de la peur et des émotions) et une hypoactivité du cortex préfrontal (impliqué dans la régulation émotionnelle, la planification et le contrôle des impulsions). Cette configuration "accélérateur bloqué, freins défaillants" pourrait expliquer l'intensité des réactions émotionnelles et la difficulté à les moduler.
- Anomalies des systèmes de neurotransmetteurs : Des dysfonctionnements dans les systèmes sérotoninergique (associé à l'impulsivité et à l'agressivité), dopaminergique (lié à la recherche de récompense et aux symptômes quasi-psychotiques) et noradrénergique (impliqué dans la vigilance et la réponse au stress) sont régulièrement rapportés.
Ces vulnérabilités neurobiologiques ne sont pas une fatalité. Elles constituent une "diathèse", une prédisposition qui rend l'individu plus sensible à l'impact des stresseurs environnementaux.
Facteurs environnementaux et psychologiques (les stresseurs)
L'environnement précoce joue un rôle absolument crucial dans la modulation de ces prédispositions. Les expériences adverses durant l'enfance et l'adolescence sont des facteurs de risque majeurs et robustement établis.
- Traumatismes et maltraitance : Un historique de négligence émotionnelle ou physique, d'abus sexuels ou physiques, ou d'exposition à la violence est retrouvé chez une proportion très élevée de patients, notamment ceux souffrant de troubles du Cluster B. Le trauma complexe et chronique perturbe profondément le développement de l'attachement, de la régulation émotionnelle et de la construction d'une image de soi cohérente et positive.
- Théorie de l'attachement (Bowlby & Ainsworth) : La qualité du lien précoce avec les figures parentales est fondamentale. Un attachement insécure (de type anxieux, évitant ou, plus grave encore, désorganisé) est un précurseur puissant des difficultés relationnelles et de la pathologie de la personnalité à l'âge adulte. L'attachement désorganisé, souvent lié à un parent à la fois source de réconfort et de peur, est particulièrement associé au développement du trouble borderline.
- Environnements invalidants : Marsha Linehan, conceptrice de la Thérapie Comportementale Dialectique, a développé le concept d'environnement invalidant". Il s'agit d'un contexte familial où les expériences internes de l'enfant (ses émotions, ses pensées, ses sensations) sont systématiquement ignorées, minimisées, punies ou jugées comme étant inappropriées. Face à cette invalidation chronique, un enfant biologiquement prédisposé à une forte réactivité émotionnelle n'apprend pas à comprendre, à nommer, à réguler et à faire confiance à ses propres émotions, ce qui constitue le socle de la dérégulation émotionnelle caractéristique du trouble borderline.
En somme, un trouble de la personnalité émerge le plus souvent de la rencontre tragique entre un enfant au tempérament "sensible" ou "réactif" et un environnement qui, par son caractère traumatique, négligent ou invalidant, échoue à lui fournir la sécurité, la validation et les outils de co-régulation nécessaires à un développement psychique harmonieux.
C. Focus sur des Troubles Spécifiques : Illustrations Cliniques et Défis Diagnostiques
Pour illustrer concrètement la complexité de ces troubles, examinons trois d'entre eux, issus de clusters différents, qui soulèvent des enjeux cliniques et diagnostiques distincts.
Le trouble de la personnalité borderline (TPB)
Le TPB est sans doute le trouble de la personnalité le plus étudié et celui pour lequel les avancées thérapeutiques ont été les plus spectaculaires. Il se caractérise par un schéma envahissant de dérégulation dans quatre domaines principaux :
- Dérégulation émotionnelle : Instabilité affective intense avec des épisodes de dysphorie, d'irritabilité ou d'anxiété durant généralement quelques heures. Les patients décrivent des "tempêtes émotionnelles" qu'ils ne parviennent pas à maîtriser.
- Dérégulation interpersonnelle : Relations intenses et chaotiques, marquées par une alternance entre l'idéalisation extrême de l'autre et sa dévalorisation ("splitting" ou clivage). La peur frénétique de l'abandon, réelle ou imaginaire, est centrale.
- Dérégulation comportementale : Impulsivité dans des domaines potentiellement dommageables (dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite dangereuse) et comportements suicidaires ou d'automutilation récurrents (scarifications, brûlures), souvent utilisés comme une stratégie inadaptée pour réguler une détresse émotionnelle intolérable.
- Dérégulation du soi : Perturbation de l'identité avec une image de soi instable, un sentiment chronique de vide, et parfois, dans les moments de stress intense, des symptômes dissociatifs ou des idéations paranoïaques transitoires.
Le modèle biosocial de Linehan reste la référence pour comprendre le TPB : l'interaction entre une vulnérabilité émotionnelle biologique et un environnement invalidant crée un cercle vicieux où la dérégulation émotionnelle s'auto-entretient.
Le trouble de la personnalité narcissique (TPN)
Le TPN est souvent mal compris, réduit à une caricature d'arrogance et d'égocentrisme. Si la facette grandiose est bien réelle (sentiment de supériorité, besoin d'admiration, exploitation d'autrui, manque d'empathie), la recherche clinique a révélé une dynamique sous-jacente bien plus complexe. On distingue souvent deux présentations :
- Le narcissisme grandiose (ou "overt") : C'est le phénotype classique, extraverti, arrogant, et ouvertement en quête de pouvoir et d'admiration.
- Le narcissisme vulnérable (ou "covert") : Ce phénotype est plus subtil. L'individu est intérieurement tout aussi grandiose, mais il est inhibé, hypersensible à la critique, et rongé par des sentiments de honte et d'inadéquation. Sa grandiosité se manifeste souvent par des fantasmes secrets de succès et une attitude de supériorité distante.
Au cœur du TPN, qu'il soit grandiose ou vulnérable, se trouve une estime de soi paradoxalement très fragile. La grandiosité est une structure de défense massive érigée pour protéger le "self" d'une "blessure narcissique" fondamentale, d'un sentiment intolérable de n'être rien, d'être défectueux ou sans valeur. Cette défense coupe l'individu de son authenticité et de sa capacité à nouer des liens réciproques, le condamnant à une quête incessante de validation externe ("narcissistic supply").
Le trouble de la personnalité évitante (TPEv)
Le TPEv se situe à l'intersection de l'anxiété sociale et des traits de personnalité. Il est défini par un schéma envahissant d'inhibition sociale, de sentiments de ne pas être à la hauteur et d'une hypersensibilité au jugement négatif. Contrairement au trouble d'anxiété sociale qui peut être limité à des situations de performance, le TPEv est plus pervasif : la personne se sent fondamentalement inadéquate, inférieure aux autres, et évite tout contact social ou prise de risque interpersonnel, à moins d'être certaine d'être aimée.
Le défi diagnostique est de le distinguer de la forme généralisée du trouble d'anxiété sociale. La distinction se joue souvent sur le caractère ego-syntone des cognitions : dans le TPEv, la croyance "je suis nul et inintéressant" est une partie intégrante et stable de l'identité, alors que dans l'anxiété sociale, elle peut être davantage perçue comme une pensée irrationnelle et ego-dystone. L'étiologie pointe souvent vers un tempérament d'inhibition comportementale à la naissance, exacerbé par des expériences précoces de rejet, de moqueries ou de critiques parentales. La thérapie doit non seulement cibler l'anxiété mais aussi et surtout restructurer ces croyances fondamentales sur soi-même.
D. Les Approches Thérapeutiques Fondées sur des Preuves : Au-delà de la Psychothérapie de Soutien
L'idée que les troubles de la personnalité sont incurables est aujourd'hui obsolète. Au cours des trente dernières années, plusieurs modèles de psychothérapie structurés et spécialisés ont été développés et validés empiriquement, transformant radicalement le pronostic de ces pathologies. Ces thérapies partagent certains principes : elles sont généralement de longue durée (1 à 3 ans, voire plus), hautement structurées, et se concentrent sur la relation thérapeutique comme principal levier de changement.
La Thérapie Comportementale Dialectique (TCD / DBT)
Développée par Marsha Linehan spécifiquement pour les patients suicidaires atteints de TPB, la TCD est aujourd'hui le traitement de référence pour ce trouble. Sa philosophie centrale est la dialectique entre l'acceptation et le changement. Le thérapeute valide radicalement l'expérience et la souffrance du patient tout en l'aidant à acquérir les compétences nécessaires pour changer ses comportements dysfonctionnels. Le traitement standard combine thérapie individuelle, un groupe d'entraînement aux compétences, du coaching téléphonique et une supervision d'équipe pour les thérapeutes. Les quatre modules de compétences enseignés sont :
- Pleine Conscience (Mindfulness) : Apprendre à observer ses pensées et émotions sans jugement et à vivre dans le moment présent.
- Tolérance à la Détresse : Développer des stratégies pour survivre aux crises émotionnelles sans y réagir impulsivement (par l'automutilation, par exemple).
- Régulation Émotionnelle : Comprendre ses émotions, réduire sa vulnérabilité aux émotions négatives et moduler ses réponses émotionnelles.
- Efficacité Interpersonnelle : Apprendre à formuler des demandes, à poser des limites et à gérer les conflits relationnels de manière assertive et respectueuse.
La Thérapie Basée sur la Mentalisation (TBM / MBT)
Développée par Peter Fonagy et Anthony Bateman, la TBM repose sur le concept de mentalisation : la capacité à comprendre son propre comportement et celui des autres en termes d'états mentaux sous-jacents (sentiments, désirs, croyances, intentions). Selon ce modèle, les patients souffrant de TPB ont une capacité de mentalisation fragile qui s'effondre sous l'effet du stress et de l'activation de l'attachement. Ils basculent alors dans des modes de pensée "pré-mentalistiques" (comme le "mode d'équivalence psychique", où le monde interne est confondu avec la réalité externe, ou le "mode téléologique", où seules les actions concrètes ont un sens). La thérapie vise à restaurer et à renforcer la capacité de mentalisation du patient, principalement en explorant de manière curieuse et non-jugeante ce qui se passe dans son esprit et dans l'esprit du thérapeute, notamment lors des ruptures et des réparations de l'alliance thérapeutique.
La Thérapie des Schémas (Schema Therapy - SFT)
Créée par Jeffrey Young, la Thérapie des Schémas est une approche intégrative qui combine des éléments des thérapies cognitives et comportementales, de l'attachement, de la Gestalt et des approches psychodynamiques. Elle est particulièrement efficace pour une large gamme de troubles de la personnalité (notamment narcissique, évitant et borderline). Le modèle postule que les expériences précoces négatives mènent au développement de Schémas Précoces Inadaptés (SPI), des croyances profondes et envahissantes sur soi-même et le monde (ex: "Abandon/Instabilité", "Imperfection/Honte", "Méfiance/Abus"). Pour faire face à la douleur de ces schémas, l'individu développe des styles d'adaptation (soumission, évitement, contre-attaque). La thérapie travaille avec les "modes", qui sont des états émotionnels et comportementaux momentanés (ex: "l'Enfant Vulnérable", "le Parent Punitif", "le Protecteur Détaché"). Le but est de guérir les schémas en utilisant des techniques cognitives, comportementales mais aussi, et c'est sa spécificité, des techniques expérientielles puissantes comme l'imagerie mentale et le "reparentage limité", où le thérapeute offre, dans les limites du cadre thérapeutique, la validation, la sécurité et l'empathie qui ont manqué au patient dans son enfance.
La Psychothérapie Centrée sur le Transfert (TFP)
La TFP est une thérapie psychodynamique moderne, développée par Otto Kernberg, particulièrement indiquée pour les troubles de la personnalité de l'organisation borderline (incluant le TPB et le TPN). L'axe central du traitement est l'analyse du transfert, c'est-à-dire l'activation, dans la relation avec le thérapeute, des relations d'objet internes clivées du patient. Le patient perçoit alternativement lui-même et le thérapeute comme étant "tout-bon" ou "tout-mauvais". Le thérapeute aide le patient à prendre conscience de ces oscillations, à les nommer, à les comprendre et, progressivement, à intégrer ces représentations polarisées de soi et de l'autre en une vision plus nuancée et cohérente, ce qui conduit à une meilleure intégration de l'identité et à des relations plus stables.
Conclusion
Le paysage de la compréhension et du traitement des troubles de la personnalité a été profondément remodelé au cours des dernières décennies. Nous sommes passés d'une vision fataliste et stigmatisante à une conception nuancée et porteuse d'espoir, ancrée dans un modèle bio-psycho-social robuste. La transition nosographique vers des modèles dimensionnels promet une évaluation plus précise et personnalisée, tandis que la recherche étiologique éclaire les trajectoires développementales complexes qui mènent à ces pathologies.
Plus important encore, l'émergence de psychothérapies spécialisées et fondées sur des preuves, telles que la TCD, la TBM, la Thérapie des Schémas ou la TFP, a démontré que le changement est possible. Ces approches, bien qu'exigeantes pour le patient comme pour le thérapeute, permettent de s'attaquer aux mécanismes centraux de la pathologie : la dérégulation émotionnelle, les schémas cognitifs rigides, les déficits de mentalisation et les relations d'objet clivées. Elles offrent aux individus non seulement un soulagement de leurs symptômes, mais aussi la possibilité de construire une identité plus intégrée, des relations plus satisfaisantes et, en définitive, une vie qui mérite d'être vécue. Le défi demeure immense : il s'agit de poursuivre la recherche, de lutter contre la stigmatisation et, surtout, de rendre ces soins spécialisés accessibles au plus grand nombre. Car derrière chaque étiquette diagnostique se trouve une personne en quête de compréhension, de validation et d'un chemin vers la guérison.
Les sources :
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787
- Bach, B., & First, M. B. (2018). Application of the ICD-11 classification of personality disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 351. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1938-1. URL: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1938-1
- Bateman, A., & Fonagy, P. (2019). A randomized controlled trial of a mentalization-based intervention (MBT-light) for patients with borderline personality disorder. The American Journal of Psychiatry, 176(3), 194-202. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.18030322. URL: https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.18030322
- Cristea, I. A., Gentili, C., Cotet, C. D., Palomba, D., Barbui, C., & Cuijpers, P. (2017). Efficacy of psychotherapies for personality disorders: A systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 74(4), 319–328. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.4206. URL: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2604245
- Crowell, S. E., Beauchaine, T. P., & Linehan, M. M. (2009). A biosocial developmental model of borderline personality: Elaborating and extending Linehan's theory. Psychological Bulletin, 135(3), 495–510. https://doi.org/10.1037/a0015616. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3187889/
- Krueger, R. F., & Hobbs, K. A. (2020). An overview of the DSM-5 alternative model of personality disorders. Psychopathology, 53(3), 126-132. https://doi.org/10.1159/000508538. URL: https://www.karger.com/Article/FullText/508538
- Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., ... & Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63(7), 757-766. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.7.757. URL: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/209803
- Torgersen, S. (2012). The nature (and nurture) of personality disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 53(6), 445-452. https://doi.org/10.1111/sjop.12001. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12001
- World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/en. URL: https://icd.who.int/browse11/l-m/en
- Yeomans, F. E., Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (2015). Transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder: A clinical guide. American Psychiatric Publishing.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press.
- Zeigler-Hill, V., & Besser, A. (2013). A glimpse into the grandiose and vulnerable sides of narcissism. In Handbook of narcissism and narcissistic personality disorder (pp. 59-70). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118093108.ch5. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118093108.ch5