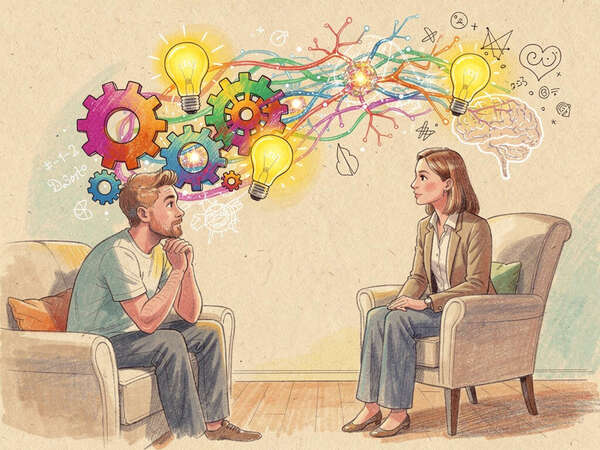Les troubles bipolaires : Diagnostic, traitement et gestion au quotidien
Au cœur de l'expérience humaine se trouve une rythmicité fondamentale : l'alternance du jour et de la nuit, de l'éveil et du sommeil, de l'activité et du repos. Notre humeur, notre énergie et notre cognition sont, elles aussi, soumises à des fluctuations naturelles, orchestrées par une horlogerie biologique interne d'une précision remarquable. Le trouble bipolaire, dans son essence clinique, représente une rupture profonde de cette orchestration. Il ne s'agit pas simplement de "sautes d'humeur", une simplification réductrice et dangereusement banalisante, mais d'une pathologie neurobiologique sévère qui dérègle le métronome central de l'existence. Les individus qui en souffrent ne naviguent pas entre la joie et la tristesse, mais sont emportés par des vagues cycloniques d'énergie, de pensée et d'affect, oscillant entre les sommets vertigineux de la manie et les abîmes de la dépression. Comprendre cette pathologie exige de dépasser les caricatures pour s'immerger dans la complexité de ses mécanismes, la subtilité de son diagnostic et la sophistication de sa prise en charge, qui repose sur une alliance indissociable entre la pharmacologie, la psychothérapie et l'engagement actif du patient dans la gestion de sa propre condition. Cet article se propose d'explorer ces trois dimensions, en s'appuyant sur les données les plus récentes de la recherche clinique et fondamentale pour offrir un panorama exhaustif et nuancé de ce que signifie, au XXIe siècle, diagnostiquer, traiter et vivre avec un trouble bipolaire.
A. Le Spectre Bipolaire : Définition, Classification et Phénoménologie Clinique
Le trouble bipolaire n'est pas une entité monolithique mais un spectre de conditions définies par la présence d'au moins un épisode d'humeur élevée (maniaque ou hypomaniaque). La classification contemporaine, telle que définie par le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-5), distingue principalement trois entités.
1. Le Trouble Bipolaire de Type I : La caractéristique cardinale du trouble bipolaire de type I est la survenue d'au moins un épisode maniaque franc. L'épisode maniaque est une période distincte, d'une durée d'au moins une semaine (ou de toute durée si une hospitalisation est nécessaire), durant laquelle l'humeur est élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante, accompagnée d'une augmentation de l'énergie ou de l'activité dirigée vers un but. Pour poser le diagnostic, au moins trois des symptômes suivants doivent être présents (quatre si l'humeur est seulement irritable) :
- Augmentation de l'estime de soi ou idées de grandeur.
- Réduction du besoin de sommeil (par exemple, se sentir reposé après seulement trois heures de sommeil).
- Logorrhée ou désir constant de parler.
- Fuite des idées ou sentiment subjectif que les pensées défilent.
- Distractibilité (l'attention est trop facilement attirée par des stimuli externes non importants ou non pertinents).
- Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel, scolaire ou sexuel) ou agitation psychomotrice.
- Engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables (achats inconsidérés, investissements financiers risqués, indiscrétions sexuelles).
La sévérité de l'épisode maniaque est telle qu'elle entraîne une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social, nécessite une hospitalisation pour prévenir les conséquences dangereuses pour le sujet ou pour autrui, ou s'accompagne de caractéristiques psychotiques (délires, hallucinations). La plupart des individus avec un trouble bipolaire de type I connaissent également des épisodes dépressifs majeurs, bien que ceux-ci ne soient pas requis pour le diagnostic.
- 2. Le Trouble Bipolaire de Type II : Le trouble bipolaire de type II est défini par la présence d'au moins un épisode hypomaniaque et d'au moins un épisode dépressif majeur. L'hypomanie partage les mêmes symptômes que la manie, mais l'épisode est moins sévère et doit durer au moins quatre jours consécutifs. La différence cruciale réside dans l'impact fonctionnel : l'épisode hypomaniaque représente un changement observable par autrui par rapport au fonctionnement habituel, mais il n'est pas suffisamment grave pour causer une altération marquée du fonctionnement social ou professionnel, ni pour nécessiter une hospitalisation. Il n'y a jamais eu d'épisode maniaque franc. Souvent, les patients ne perçoivent pas l'hypomanie comme pathologique ; ils peuvent même l'apprécier pour l'augmentation de productivité et de créativité qu'elle procure. C'est l'épisode dépressif majeur qui motive généralement la consultation. La dépression bipolaire est phénoménologiquement similaire à la dépression unipolaire, mais elle est souvent associée à une plus grande labilité émotionnelle, une irritabilité, une hypersomnie, une hyperphagie et un ralentissement psychomoteur plus marqué (caractéristiques dites "atypiques").
- 3. Le Trouble Cyclothymique : La cyclothymie est considérée comme une forme atténuée et chronique du trouble bipolaire. Elle est caractérisée par une période d'au moins deux ans (un an chez les enfants et adolescents) durant laquelle se succèdent de nombreuses périodes avec des symptômes hypomaniaques qui ne remplissent pas les critères d'un épisode hypomaniaque complet, et de nombreuses périodes avec des symptômes dépressifs qui ne remplissent pas les critères d'un épisode dépressif majeur. Durant cette période de deux ans, les périodes symptomatiques sont présentes au moins la moitié du temps, et l'individu n'a pas été asymptomatique pendant plus de deux mois consécutifs. Ces fluctuations chroniques de l'humeur provoquent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement.
- Les Méandres du Diagnostic : Un Défi Clinique et Scientifique
Le diagnostic du trouble bipolaire est l'un des plus complexes en psychiatrie, ce qui explique un retard diagnostique moyen estimé entre 5 et 10 ans après l'apparition des premiers symptômes. Plusieurs facteurs contribuent à cette difficulté.
- 1. La Confusion avec le Trouble Dépressif Majeur (Unipolaire) : La majorité des patients bipolaires, en particulier ceux de type II, consultent initialement lors d'un épisode dépressif. En l'absence d'un interrogatoire minutieux et systématique sur d'éventuels antécédents d'épisodes (hypo)maniaques, le clinicien peut à tort poser un diagnostic de dépression unipolaire. Cette erreur diagnostique a des conséquences thérapeutiques potentiellement graves : la prescription d'un antidépresseur en monothérapie peut induire un virage maniaque, une accélération des cycles ou une résistance au traitement à long terme. La recherche d'antécédents d'hypomanie doit être proactive, en posant des questions ciblées sur des périodes de moindre besoin de sommeil, d'énergie décuplée, de dépenses excessives ou de projets grandioses.
- 2. Le Diagnostic Différentiel : Le tableau clinique du trouble bipolaire, notamment lors des phases d'instabilité ou des états mixtes (présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs), peut mimer d'autres pathologies psychiatriques.
- Trouble de la personnalité borderline (TPL) : Le TPL est caractérisé par une instabilité de l'humeur, des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Cependant, la labilité émotionnelle du TPL est généralement de plus courte durée (quelques heures ou jours) et réactive à des stresseurs interpersonnels, tandis que les épisodes thymiques du trouble bipolaire sont plus soutenus (jours ou semaines) et plus autonomes.
- Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) : La distractibilité, l'agitation psychomotrice et l'impulsivité sont des symptômes communs. Chez l'adulte, la distinction est cruciale. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental chronique et stable, alors que les symptômes du trouble bipolaire sont épisodiques.
- Troubles Anxieux et Troubles liés à l'Usage de Substances : La comorbidité est la règle plutôt que l'exception. Plus de la moitié des patients bipolaires présentent un trouble anxieux associé, et environ 60% un trouble lié à l'usage de substances au cours de leur vie. Ces conditions peuvent masquer ou exacerber les symptômes thymiques, compliquant davantage le tableau clinique.
- 3. L'Absence de Biomarqueurs : À ce jour, il n'existe aucun test sanguin, examen d'imagerie cérébrale ou marqueur biologique validé pour confirmer le diagnostic de trouble bipolaire. Le diagnostic reste exclusivement clinique, reposant sur l'anamnèse détaillée, l'hétéro-anamnèse (informations recueillies auprès de l'entourage) et l'observation longitudinale de l'évolution du patient. Des outils comme les échelles d'évaluation (par exemple, le Mood Disorder Questionnaire - MDQ) peuvent aider au dépistage, mais ne remplacent pas un entretien clinique approfondi.
- Étiologie des Troubles Bipolaires : Une Mosaïque Complexe de Facteurs
L'étiologie du trouble bipolaire est multifactorielle, résultant d'une interaction complexe entre une vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux, médiée par des dysfonctionnements neurobiologiques spécifiques.
- 1. La Forte Composante Génétique : Le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques les plus héritables. Les études de jumeaux montrent des taux de concordance de 40 à 70% chez les jumeaux monozygotes, contre environ 5 à 10% chez les jumeaux dizygotes. Le risque pour un parent au premier degré d'un patient bipolaire de développer le trouble est environ 10 fois supérieur à celui de la population générale. La recherche a identifié plusieurs gènes de susceptibilité (par exemple, CACNA1C, ANK3, ODZ4), mais chacun ne contribue qu'à une infime partie du risque. Il s'agit d'une architecture polygénique complexe, où des centaines, voire des milliers de variants génétiques communs, chacun avec un petit effet, interagissent pour augmenter la vulnérabilité.
- 2. Les Dysfonctionnements Neurobiologiques : La recherche en neuroimagerie et en neurobiologie a mis en évidence des anomalies structurelles et fonctionnelles dans des circuits cérébraux cruciaux pour la régulation émotionnelle.
- Le Circuit Cortico-Limbique : Un modèle prédominant postule un déséquilibre entre les régions préfrontales (impliquées dans le contrôle cognitif et la régulation descendante des émotions) et les structures limbiques sous-corticales comme l'amygdale (impliquée dans la détection des menaces et la génération des réponses émotionnelles). Chez les patients bipolaires, on observe souvent une hyperactivité de l'amygdale et une hypoactivité du cortex préfrontal, notamment lors des tâches de régulation émotionnelle. Ce déséquilibre pourrait expliquer la réactivité émotionnelle exacerbée et les difficultés à moduler les affects.
- Les Neurotransmetteurs : Si les modèles monoaminergiques classiques (impliquant la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline) sont jugés trop simplistes, il est clair que ces systèmes sont dysrégulés. La manie est associée à une hyperactivité dopaminergique, tandis que la dépression serait liée à un déficit fonctionnel de ces trois neurotransmetteurs. Les traitements actuels ciblent majoritairement ces systèmes.
- La Plasticité Synaptique et la Signalisation Intracellulaire : Des anomalies dans les cascades de signalisation intracellulaire (comme les voies du GSK-3β, du BDNF ou du mTOR) et dans la plasticité synaptique semblent jouer un rôle central. Le lithium, traitement de référence, agit sur plusieurs de ces voies, suggérant leur importance physiopathologique.
- Le Rôle de l'Inflammation et du Stress Oxydatif : Des données croissantes indiquent une inflammation de bas grade et un stress oxydatif accrus chez les patients bipolaires, y compris pendant les périodes de rémission. Ces processus pourraient contribuer à la neuroprogression du trouble, c'est-à-dire à l'aggravation des symptômes et à la résistance au traitement au fil du temps.
- 3. Les Facteurs Environnementaux et Psychosociaux : Les gènes ne déterminent pas un destin. Des facteurs environnementaux interagissent avec la vulnérabilité génétique pour déclencher ou moduler l'expression du trouble. Les traumatismes durant l'enfance (abus, négligence) sont des facteurs de risque robustes, associés à un âge de début plus précoce, à une plus grande sévérité des symptômes et à une moins bonne réponse au traitement. Les événements de vie stressants peuvent précipiter les premiers épisodes ou les rechutes. La perturbation des rythmes circadiens (par exemple, le travail de nuit, le décalage horaire, un sommeil irrégulier) est un déclencheur particulièrement puissant d'épisodes (hypo)maniaques.
- L'Arsenal Thérapeutique : Stratégies Pharmacologiques
La prise en charge pharmacologique est la pierre angulaire du traitement du trouble bipolaire. Elle vise à traiter les épisodes aigus (maniaques ou dépressifs) et, de manière cruciale, à prévenir les récurrences (traitement de maintenance ou prophylactique).
1. Les Thymorégulateurs (Stabilisateurs de l'Humeur) : Ce sont les médicaments de première ligne.
- Le Lithium : Considéré comme le "gold standard", le lithium est efficace pour le traitement de la manie aiguë, la prévention des récurrences maniaques et dépressives, et il est le seul médicament ayant démontré un effet anti-suicidaire spécifique dans le trouble bipolaire. Son mécanisme d'action est complexe et pas entièrement élucidé, impliquant la modulation de voies de signalisation intracellulaires (inhibition de la GSK-3β) et des effets neuroprotecteurs. Son utilisation requiert une surveillance régulière des taux sanguins (lithiémie) en raison de sa marge thérapeutique étroite et de sa toxicité potentielle (rénale, thyroïdienne).
- Les Anticonvulsivants : Plusieurs antiépileptiques ont démontré une efficacité thymorégulatrice.
- Le Valproate (Divalproex) : Très efficace dans le traitement de la manie aiguë et des états mixtes. Il est également utilisé en maintenance, bien que son efficacité préventive sur la dépression soit moins établie que celle du lithium. Il est tératogène et doit être évité chez les femmes en âge de procréer.
- La Lamotrigine : Particulièrement efficace pour la prévention des épisodes dépressifs, elle est le traitement de choix pour la maintenance chez les patients dont la polarité prédominante est dépressive. Elle n'est pas efficace pour traiter la manie aiguë. Son introduction doit être très progressive en raison du risque rare mais grave de rash cutané (syndrome de Stevens-Johnson).
- La Carbamazépine : Une option plus ancienne, efficace pour la manie aiguë, mais son profil d'interactions médicamenteuses et ses effets secondaires limitent son utilisation en première ligne.
2. Les Antipsychotiques de Seconde Génération (Atypiques) : Ces médicaments jouent un rôle majeur dans toutes les phases du traitement. L'olanzapine, la rispéridone, la quétiapine, l'aripiprazole, la ziprasidone et la lurasidone ont tous des indications dans le trouble bipolaire.
- En phase maniaque aiguë : Ils sont très efficaces, seuls ou en association avec un thymorégulateur, pour réduire rapidement l'agitation, les symptômes psychotiques et l'humeur expansive.
- En phase dépressive aiguë : La quétiapine, la lurasidone et l'association olanzapine-fluoxétine ont une indication approuvée pour le traitement de la dépression bipolaire.
- En traitement de maintenance : Plusieurs d'entre eux (notamment l'aripiprazole, l'olanzapine, la quétiapine) ont démontré leur efficacité dans la prévention des rechutes, maniaques et/ou dépressives. Leur principal inconvénient est le risque d'effets secondaires métaboliques (prise de poids, diabète, dyslipidémie), qui nécessite une surveillance rigoureuse.
- 3. Les Antidépresseurs : Leur utilisation dans le trouble bipolaire est controversée et doit être extrêmement prudente. Prescrits seuls (en monothérapie), ils peuvent induire un virage maniaque ou une accélération des cycles. Les recommandations actuelles stipulent qu'ils ne devraient être envisagés que pour un épisode dépressif sévère, pour une durée limitée, et toujours en association avec un traitement thymorégulateur efficace.
- Les Approches Psychothérapeutiques : Un Complément Indispensable
Si la pharmacothérapie stabilise le socle neurobiologique, la psychothérapie est essentielle pour aider les patients à comprendre leur maladie, à développer des stratégies de gestion, à améliorer leur fonctionnement psychosocial et à réduire le risque de rechute. Plusieurs approches structurées ont prouvé leur efficacité.
- 1. La Psychoéducation : C'est le fondement de toute prise en charge. Menée en groupe ou en individuel, elle vise à fournir des informations détaillées sur la nature du trouble, ses symptômes, son évolution, ses traitements et l'importance de l'adhésion thérapeutique. Elle permet au patient de devenir un partenaire actif de ses soins. La psychoéducation réduit significativement les taux de rechute et améliore le fonctionnement global.
- 2. La Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) : La TCC adaptée au trouble bipolaire aide les patients à identifier et à modifier les pensées et les comportements dysfonctionnels qui contribuent aux fluctuations de l'humeur. Elle se concentre sur des objectifs concrets : régularisation des routines quotidiennes, gestion des pensées automatiques négatives lors de la dépression, modération des comportements à risque lors des phases d'élévation de l'humeur, et développement de compétences en résolution de problèmes.
- 3. La Thérapie Interpersonnelle et des Rythmes Sociaux (TIRTS ou IPSRT) : Cette thérapie a été spécifiquement conçue pour le trouble bipolaire. Elle part du postulat que les perturbations des rythmes sociaux et circadiens (heure de lever, de coucher, des repas, des interactions sociales) et les événements de vie interpersonnels sont des déclencheurs majeurs d'épisodes. La TIRTS aide le patient à stabiliser ses routines quotidiennes pour stabiliser son horloge biologique interne, et à gérer les conflits interpersonnels qui peuvent déstabiliser l'humeur.
- 4. Les Thérapies Familiales et de Couple : Le trouble bipolaire a un impact considérable sur l'entourage. Les thérapies centrées sur la famille visent à améliorer la communication, à réduire les niveaux d'« émotions exprimées » (critique, hostilité) au sein de la famille, qui sont un prédicteur de rechute, et à fournir aux proches des outils pour soutenir le patient de manière constructive.
- Gestion au Quotidien et Stratégies d'Auto-Gestion (Self-Management)
Au-delà des traitements formels, l'implication du patient dans la gestion active de sa maladie est un facteur pronostique majeur.
1. L'Hygiène de Vie et la Régularité : La stabilisation des rythmes est cruciale. Cela inclut :
- Une hygiène de sommeil stricte : Se coucher et se lever à heures fixes, même le week-end, est sans doute la stratégie d'auto-gestion la plus importante.
- Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière : Celles-ci contribuent à la santé physique (souvent mise à mal par les effets secondaires métaboliques des traitements) et ont un effet stabilisateur sur l'humeur.
- La limitation ou l'évitement des substances : L'alcool, le cannabis et les stimulants peuvent déstabiliser l'humeur et interagir avec les médicaments.
- 2. Le Monitorage de l'Humeur (Mood Charting) : Tenir un journal de l'humeur, où le patient note quotidiennement son niveau d'humeur (sur une échelle de -5 à +5, par exemple), ses heures de sommeil, ses médicaments, son niveau d'anxiété et les événements de vie, est un outil extrêmement puissant. Il permet au patient et au clinicien de repérer les signes avant-coureurs d'une rechute, d'identifier les déclencheurs et d'évaluer l'efficacité des traitements.
- 3. L'Élaboration d'un Plan de Crise : Il s'agit d'un document rédigé conjointement par le patient et son clinicien (et si possible sa famille) pendant une période de stabilité. Ce plan détaille :
- Les signes avant-coureurs personnels d'un épisode maniaque ou dépressif.
- Les stratégies d'auto-gestion à mettre en place dès l'apparition de ces signes (contacter le médecin, ajuster le sommeil, etc.).
- Les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence (clinicien, proches, services d'urgence).
- Les informations sur les traitements et les éventuelles directives anticipées concernant les soins en cas de crise.
G. Recherche Actuelle et Perspectives d'Avenir
La recherche sur le trouble bipolaire est extrêmement active et vise à surmonter les défis actuels. Les pistes d'avenir incluent :
- L'identification de biomarqueurs : L'objectif est de développer des tests (basés sur la neuroimagerie, la génétique, les analyses sanguines ou l'électroencéphalographie) pour aider au diagnostic précoce, au diagnostic différentiel et à la prédiction de la réponse aux traitements.
- La pharmacogénomique : Elle vise à utiliser le profil génétique d'un patient pour choisir le médicament le plus efficace et le mieux toléré, personnalisant ainsi la pharmacothérapie.
- Les nouvelles cibles thérapeutiques : La recherche explore de nouvelles voies, au-delà des systèmes monoaminergiques, comme la modulation du système glutamatergique (par exemple avec la kétamine pour la dépression bipolaire résistante), les agents anti-inflammatoires ou les interventions ciblant le métabolisme mitochondrial.
- Les technologies numériques : Les applications mobiles pour le monitorage de l'humeur, les capteurs passifs (analysant les modèles de sommeil, d'activité, de communication via le smartphone) et la télémédecine offrent des outils prometteurs pour un suivi plus continu et une détection précoce des rechutes.
Conclusion
Le trouble bipolaire est une affection médicale complexe, chronique et potentiellement dévastatrice, dont les fondements neurobiologiques sont de mieux en mieux compris. Son diagnostic, qui demeure un exercice clinique délicat, est la porte d'entrée vers une prise en charge intégrative qui a radicalement transformé son pronostic. Loin d'une fatalité, la condition bipolaire est aujourd'hui gérable grâce à une synergie thérapeutique rigoureuse, articulant une pharmacothérapie personnalisée, des psychothérapies structurées et l'autonomisation du patient. Le succès de cette prise en charge repose sur une alliance thérapeutique solide, une éducation continue et un engagement à long terme de la part du patient, de son entourage et de l'équipe soignante. Si des défis majeurs persistent, notamment dans la lutte contre la stigmatisation, la réduction du délai diagnostique et le développement de traitements plus ciblés, les avancées de la recherche offrent un espoir tangible. L'avenir du traitement réside dans une médecine de plus en plus personnalisée, capable de décrypter la signature biologique unique de chaque patient pour restaurer, avec la plus grande finesse possible, le rythme fondamental de son existence.
Sources (Normes APA 7)
Grande, I., Berk, M., Birmaher, B., & Vieta, E. (2016). Bipolar disorder. The Lancet, 387(10027), 1561–1572. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00241-X
Goodwin, G. M., Haddad, P. M., Ferrier, I. N., Aronson, J. K., Barnes, T. R. H., Cipriani, A., Coghill, D. R., Fazel, S., Geddes, J. R., Grunze, H., Holmes, E. A., Kennan, N., Malhi, G. S., Mitchell, P. B., Nulman, I., & Young, A. H. (2016). Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised second edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. Journal of Psychopharmacology, 30(6), 495–553. https://doi.org/10.1177/0269881116636545
Harrison, P. J., Geddes, J. R., & Tunbridge, E. M. (2018). The emerging neurobiology of bipolar disorder. Trends in Neurosciences, 41(1), 18–30. https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.10.006
McCormick, U., Murray, B., & McNew, B. (2015). Diagnosis and treatment of bipolar II disorder. The Nurse Practitioner, 40(10), 31–38. https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/the-nurse-practitioner-1090-2178
Miklowitz, D. J. (2019). The psychobiology and treatment of bipolar disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 295–322. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095537
Miklowitz, D. J., & Gitlin, M. J. (2021). The new practice of evidence-based psychotherapy for bipolar disorder. World Psychiatry, 20(2), 202–211. https://doi.org/10.1002/wps.20857
Post, R. M. (2016). Treatment of bipolar depression. Psychiatric Clinics of North America, 39(1), 11–33. https://doi.org/10.1016/j.psc.2015.10.005
Rowland, T. A., & Marwaha, S. (2018). Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 8(9), 251–269. https://doi.org/10.1177/2045125318769235
Strakowski, S. M., & DelBello, M. P. (2021). The neurodevelopmental basis of bipolar disorder. JAMA Psychiatry, 78(10), 1149–1150. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.1718
Yatham, L. N., Kennedy, S. H., Parikh, S. V., Schaffer, A., Bond, D. J., Frey, B. N., Sharma, V., Goldstein, B. I., Rej, S., Beaulieu, S., Yim, C. Y., & Ravindran, A. (2018). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disorders, 20(2), 97–170. https://doi.org/10.1111/bdi.12609