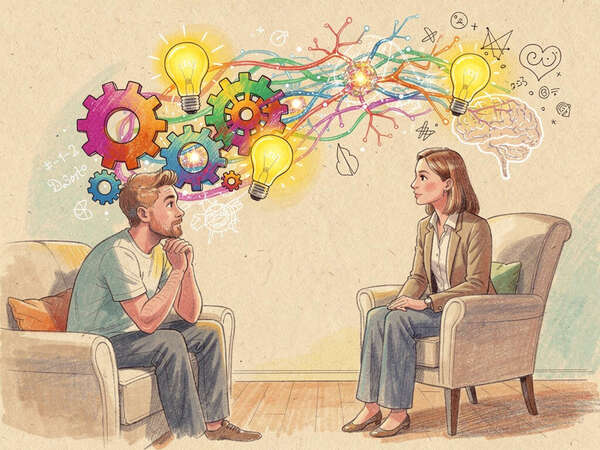La résilience psychologique : Comment certaines personnes surmontent les traumatismes et les adversités ?
L’existence humaine est intrinsèquement liée à la confrontation avec l’adversité. Pourtant, face à des épreuves identiques – un deuil brutal, un accident grave, une violence subie, une maladie invalidante – les trajectoires de vie qui en découlent divergent de manière spectaculaire. Là où une personne peut sombrer dans un état de détresse chronique, une autre, après une période de tumulte, semble non seulement retrouver son équilibre, mais parfois en émerger avec une force et une profondeur nouvelles. Cette observation, aussi ancienne que l’humanité elle-même, pose une question fondamentale pour les sciences humaines et neuronales : quel est le ressort intime qui permet à certains individus de plier sans rompre, de se reconfigurer face au chaos ?
Ce phénomène, que la psychologie moderne a conceptualisé sous le terme de « résilience », a longtemps été mal compris, souvent assimilé à une forme d’invulnérabilité ou de dureté de caractère. Une telle vision est non seulement réductrice, mais scientifiquement inexacte. La résilience n’est pas l’absence de cicatrice ; elle est l’art de vivre avec, et parfois, grâce à elles. Elle n’est pas une armure imperméable à la souffrance, mais plutôt un processus dynamique et multifactoriel, une danse complexe entre nos prédispositions génétiques, l’architecture de notre cerveau, nos apprentissages cognitifs et émotionnels, et la qualité des liens que nous tissons avec notre environnement.
Cet article se propose de disséquer le concept de résilience psychologique en s’appuyant sur les avancées les plus récentes de la recherche. Nous nous éloignerons des simplifications populaires pour plonger au cœur de ses mécanismes neurobiologiques, de ses fondements génétiques et épigénétiques, et des piliers psychologiques qui la soutiennent. Nous explorerons comment la résilience se distingue de la simple survie pour parfois ouvrir la voie à une véritable croissance post-traumatique. Enfin, nous examinerons comment cette capacité, loin d’être un don inné réservé à une élite, peut être activement cultivée à travers des interventions thérapeutiques validées. Il s’agit, en somme, de comprendre non pas pourquoi nous souffrons, mais comment, malgré la souffrance, nous parvenons à nous reconstruire et à continuer de donner un sens à notre existence.
A. Définir la Résilience : Au-delà du Mythe de l'Invulnérabilité
Le terme « résilience », emprunté à la physique pour décrire la capacité d’un matériau à retrouver sa forme initiale après un choc, a été popularisé en psychologie principalement grâce aux travaux pionniers d'Emmy Werner et Ruth Smith. Leur étude longitudinale, menée sur plusieurs décennies auprès d'une cohorte de près de 700 enfants nés en 1955 sur l'île de Kauai à Hawaï, a constitué un tournant majeur. Confrontés à de multiples facteurs de risque (pauvreté, conflits familiaux, troubles mentaux parentaux), un tiers de ces enfants, considérés comme à « haut risque », ont pourtant évolué vers une vie d'adulte équilibrée et compétente, défiant tous les pronostics. Ce ne sont pas des "super-enfants" invulnérables, mais des individus qui ont su mobiliser des ressources internes et externes pour naviguer avec succès dans un environnement hostile.
Cette étude a permis d'établir une définition fonctionnelle et dynamique de la résilience. Loin d'être un trait de personnalité statique et inné, la résilience est aujourd'hui comprise comme un processus d'adaptation positive face à une adversité significative. Cette définition comporte trois éléments essentiels :
L’Exposition à l’Adversité : La résilience ne peut être observée qu’en présence d’un risque ou d’un traumatisme avéré. Il ne s’agit pas de bien-être en l’absence de difficultés, mais de la capacité à maintenir ou à retrouver un fonctionnement adaptatif malgré ces difficultés. L'adversité peut être aiguë (un événement traumatique unique) ou chronique (une situation de stress prolongée).
L’Adaptation Positive : L'issue de ce processus doit être positive. Cela ne signifie pas l'absence de détresse ou de symptômes. Une personne résiliente peut ressentir une profonde tristesse, de l'anxiété ou des flashbacks. Cependant, elle parvient à maintenir ou à rétablir ses compétences fondamentales dans les domaines clés de la vie (relations interpersonnelles, travail, santé physique et mentale), évitant ainsi une trajectoire pathologique durable comme le trouble de stress post-traumatique (TSPT) chronique ou la dépression majeure.
Le Processus Dynamique : La résilience n'est pas un interrupteur "on/off". C'est une interaction continue et fluctuante entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Un individu peut se montrer résilient face à un type d'épreuve et beaucoup plus vulnérable face à un autre. De même, la capacité de résilience d'une personne peut évoluer au cours de sa vie, se renforcer ou s'affaiblir en fonction des expériences et du soutien disponible.
Il est crucial de distinguer la résilience de concepts voisins. La résistance est la capacité à ne montrer que peu ou pas de symptômes de détresse pendant ou immédiatement après l'événement. La récupération (ou recovery) décrit un retour progressif à la normale après une période initiale de détresse significative. La résilience, dans son acception la plus large, englobe ces deux trajectoires mais se définit surtout par la capacité à maintenir un équilibre fonctionnel sur le long terme, en s'appuyant sur des mécanismes d'adaptation flexibles. C'est cette flexibilité qui est au cœur du concept moderne de résilience.
B. Les Substrats Neurobiologiques de la Résilience
La capacité à surmonter l'adversité n'est pas une abstraction purement psychologique ; elle est ancrée dans l'architecture et le fonctionnement de notre cerveau. Les neurosciences ont fait des progrès considérables dans l'identification des circuits neuronaux et des systèmes hormonaux qui sous-tendent les réponses adaptatives au stress. La résilience peut être vue comme l'efficacité de ces systèmes à réguler la réponse à une menace, à l'éteindre une fois le danger passé, et à promouvoir l'apprentissage et l'adaptation.
Au centre de cette machinerie se trouve le dialogue entre plusieurs structures cérébrales clés :
Le Cortex Préfrontal (CPF) : Particulièrement sa partie médiane (CPFm), est le "chef d'orchestre" de notre cerveau. Il est responsable des fonctions exécutives supérieures : la planification, la prise de décision, la régulation des émotions et l'inhibition des réponses impulsives. Chez les individus résilients, le CPFm exerce un contrôle inhibiteur (un "frein") efficace sur l'amygdale. Il permet de réévaluer une situation menaçante de manière plus objective ("Ce bruit n'est pas un danger, c'est juste le vent"), un processus appelé réévaluation cognitive. Une activité robuste du CPFm est l'une des signatures neuronales les plus constantes de la résilience.
L'Amygdale : Ce petit noyau en forme d'amande est notre "détecteur de menaces". Elle s'active rapidement en présence d'un danger potentiel, déclenchant les réponses de peur et d'anxiété (la fameuse réaction de "lutte ou fuite"). Chez les personnes vulnérables au TSPT, l'amygdale est souvent hyperactive et ne parvient pas à être régulée par le CPF. Chez les individus résilients, non seulement le CPFm calme l'amygdale, mais l'amygdale elle-même montre une réactivité plus proportionnée à la menace réelle.
L'Hippocampe : Cette structure est essentielle à la mémoire, et plus particulièrement à la contextualisation des souvenirs. Il aide à distinguer un contexte sûr d'un contexte dangereux. Un hippocampe fonctionnel permet de comprendre qu'un bruit fort entendu dans la rue n'a pas la même signification que le même bruit entendu sur un champ de bataille. Dans le TSPT, un hippocampe dysfonctionnel peut entraîner une généralisation de la peur, où des stimuli neutres déclenchent la mémoire traumatique. La résilience est associée à une meilleure capacité de l'hippocampe à discriminer les contextes et à encoder les souvenirs de manière appropriée.
Ces interactions cérébrales sont modulées par le système neuroendocrinien, principalement l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS). En réponse à un stress, cet axe orchestre la libération de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est vital à court terme, mais toxique pour le cerveau (en particulier pour l'hippocampe et le CPF) lorsqu'il est sécrété de manière chronique. Les individus résilients se caractérisent par une régulation plus efficace de l'axe HHS : une réponse rapide et adéquate au stress, suivie d'un retour rapide à la normale (homéostasie) grâce à une boucle de rétroaction négative performante. À l'inverse, la vulnérabilité est souvent liée à une réponse cortisolique émoussée ou, au contraire, prolongée.
Enfin, le concept de neuroplasticité est fondamental. Le cerveau n'est pas figé. Les expériences, positives comme négatives, modifient constamment les connexions synaptiques. La résilience est l'expression même de cette plasticité adaptative : la capacité du cerveau à se réorganiser, à renforcer les circuits régulateurs (CPF) et à affaiblir les circuits de la peur (amygdale) en réponse à l'adversité et à l'apprentissage.
C. La Danse de la Génétique et de l'Épigénétique
La question de savoir si la résilience est innée ou acquise est obsolète. La recherche moderne montre une interaction complexe entre nos gènes ("nature") et notre environnement ("nurture"), un dialogue orchestré par des mécanismes épigénétiques.
D'un point de vue génétique, il n'existe pas de "gène de la résilience". La résilience est un trait polygénique, influencé par de multiples variations génétiques qui, chacune, apportent une petite contribution. Des recherches se sont par exemple intéressées à des gènes impliqués dans la régulation des neurotransmetteurs comme la sérotonine (le gène transporteur de la sérotonine, 5-HTTLPR) ou la dopamine, ainsi qu'à des gènes régulant la réponse au stress (par exemple, le gène du récepteur des glucocorticoïdes, NR3C1). Cependant, ces gènes n'agissent pas dans le vide. Leur influence dépend de manière cruciale de l'environnement. Le célèbre modèle de la diathèse-stress suggère que les individus porteurs de certaines variations génétiques de "vulnérabilité" ne développeront une psychopathologie que s'ils sont exposés à un stress environnemental significatif.
C'est ici que l'épigénétique entre en scène. L'épigénétique désigne l'ensemble des modifications chimiques qui se produisent sur l'ADN ou les protéines qui l'entourent (les histones) sans changer la séquence d'ADN elle-même. Ces modifications agissent comme des "interrupteurs" qui peuvent allumer ou éteindre des gènes. L'environnement, en particulier durant les périodes critiques du développement (période prénatale, petite enfance), peut laisser des marques épigénétiques durables.
Des études fondatrices sur des modèles animaux, puis confirmées chez l'humain, ont montré que le stress précoce (comme la séparation maternelle) peut entraîner une méthylation (un type de marque épigénétique qui "éteint" généralement un gène) du gène du récepteur des glucocorticoïdes (NR3C1) dans l'hippocampe. Cette modification réduit le nombre de récepteurs capables de détecter le cortisol, ce qui altère la boucle de rétroaction négative de l'axe HHS. L'individu devient alors, à l'âge adulte, moins capable de réguler sa réponse au stress, le rendant plus vulnérable à la dépression ou à l'anxiété.
À l'inverse, un environnement précoce riche en soins et en soutien (par exemple, des soins maternels de haute qualité) favorise un profil épigénétique qui optimise l'expression de ces mêmes gènes, programmant ainsi un système de réponse au stress plus efficace et, par conséquent, une plus grande résilience.
L'implication la plus profonde de ces découvertes est que l'empreinte du traumatisme peut être biochimique et potentiellement transmissible, mais aussi que ces marques ne sont pas nécessairement permanentes. Des interventions positives, comme la psychothérapie ou un environnement enrichi, pourraient potentiellement inverser certaines de ces modifications épigénétiques, offrant une base biologique à l'idée que la résilience peut être apprise et renforcée tout au long de la vie.
D. Les Piliers Psychologiques : Cartographie des Facteurs Internes
Si la neurobiologie et la génétique fournissent l'infrastructure de la résilience, ce sont les processus psychologiques qui constituent les stratégies et les compétences mises en œuvre pour naviguer dans l'adversité. Plusieurs facteurs psychologiques clés ont été identifiés comme des piliers de la résilience.
Régulation Émotionnelle et Flexibilité Cognitive La régulation émotionnelle est la capacité à gérer et à moduler ses propres états affectifs. Les individus résilients ne sont pas ceux qui ne ressentent pas d'émotions négatives, mais ceux qui ne se laissent pas submerger par elles. Ils utilisent des stratégies adaptatives, notamment la réévaluation cognitive, déjà mentionnée. Plutôt que de supprimer l'émotion (une stratégie souvent contre-productive), ils modifient leur interprétation de la situation qui la génère ("Perdre mon emploi est terrible, mais c'est aussi une opportunité de me réorienter vers quelque chose qui me passionne vraiment"). Cette capacité est étroitement liée à la flexibilité cognitive, c'est-à-dire l'aptitude à changer de perspective, à envisager plusieurs solutions à un problème et à s'adapter à des circonstances changeantes. Une pensée rigide et ruminative est un facteur de risque majeur pour la dépression et le TSPT, tandis que la flexibilité permet de sortir des impasses mentales et de trouver de nouvelles voies.
Le Locus de Contrôle Interne et le Sentiment d'Auto-Efficacité Le concept de locus de contrôle fait référence à la croyance d'un individu quant à la source des événements de sa vie. Un locus de contrôle interne signifie que la personne croit avoir une influence sur ce qui lui arrive, tandis qu'un locus externe implique une croyance en la fatalité, la chance ou le pouvoir des autres. Les personnes résilientes tendent à avoir un locus de contrôle plus interne. Face à un traumatisme, elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler, même si c'est minime, plutôt que de se sentir totalement impuissantes. Ceci est corrélé au sentiment d'auto-efficacité, un concept développé par Albert Bandura, qui est la croyance en sa propre capacité à organiser et exécuter les actions nécessaires pour atteindre un objectif. Croire en sa capacité à surmonter les obstacles, même face à l'échec, est un moteur puissant de la persévérance et de l'action constructive.
L'Optimisme Réaliste et la Quête de Sens L'optimisme associé à la résilience n'est pas un optimisme naïf ou aveugle. Il s'agit d'un optimisme réaliste : la croyance générale que l'avenir sera globalement positif, tout en reconnaissant les difficultés et les obstacles du présent. C'est une attente positive qui motive à agir pour améliorer la situation. Plus profondément, la résilience est souvent soutenue par une capacité à trouver un sens à l'épreuve vécue. Inspirés par les travaux de Viktor Frankl, qui a survécu aux camps de concentration en se raccrochant à la quête de sens (logothérapie), les chercheurs ont montré que la capacité à intégrer l'événement traumatique dans un récit de vie cohérent et porteur de signification est un facteur de protection majeur. Ce sens peut être trouvé dans l'aide apportée aux autres, dans un engagement pour une cause, dans une redéfinition de ses priorités de vie ou dans une croissance spirituelle.
La Spiritualité et les Systèmes de Croyances Pour de nombreuses personnes, la spiritualité ou la religion offre un cadre puissant pour la résilience. Elle peut fournir un système de croyances qui donne un sens à la souffrance, une communauté de soutien (l'église, la mosquée, la synagogue, etc.), des rituels qui structurent le deuil et l'épreuve, et une source d'espoir et de réconfort. La foi en une puissance supérieure ou en un ordre cosmique peut aider à réduire le sentiment d'isolement et de chaos existentiel qui accompagne souvent le traumatisme.
E. Le Pouvoir des Connexions : Le Rôle Indispensable du Soutien Social
La résilience n'est jamais une entreprise solitaire. L'un des constats les plus robustes de la recherche, depuis l'étude de Kauai jusqu'aux recherches neuroscientifiques les plus récentes, est le rôle absolument central du soutien social. Les liens humains agissent comme un puissant tampon contre les effets délétères du stress.
Ce soutien peut prendre plusieurs formes :
- Soutien émotionnel : L'empathie, l'écoute, le réconfort et le sentiment d'être aimé et compris.
- Soutien instrumental : L'aide matérielle et pratique (aide financière, garde d'enfants, hébergement).
- Soutien informationnel : Les conseils, les informations qui aident à comprendre et à gérer la situation.
Sur le plan neurobiologique, le soutien social a des effets directs et mesurables. Les interactions sociales positives déclenchent la libération d'ocytocine, une neurohormone qui favorise le sentiment d'attachement, réduit l'anxiété et atténue l'activité de l'amygdale. Elle peut également moduler l'axe HHS, contribuant à diminuer les niveaux de cortisol. Tenir la main d'un être cher peut littéralement réduire l'activation des circuits de la menace dans le cerveau face à un stimulus anxiogène.
Il est important de noter que c'est la perception du soutien qui est souvent plus importante que le nombre objectif de relations. Le sentiment de pouvoir compter sur au moins une personne de confiance en cas de besoin est un prédicteur de résilience plus puissant que le fait d'être entouré de nombreuses connaissances superficielles. C'est la qualité des liens, et non la quantité, qui est primordiale. Les travaux d'Emmy Werner avaient déjà souligné ce point : la quasi-totalité des enfants résilients de Kauai avaient pu établir un lien fort et stable avec au moins un adulte bienveillant (un parent, un grand-parent, un enseignant, un voisin). Cet "autre significatif" a servi d'ancre, leur offrant la sécurité affective nécessaire pour explorer le monde et développer leurs propres compétences.
F. De la Survie à la Croissance : Le Concept de Croissance Post-Traumatique (CPT)
Pour certains individus, le processus de résilience ne se limite pas à un retour à l'état antérieur. L'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir le catalyseur d'un changement psychologique positif profond. Ce phénomène est connu sous le nom de Croissance Post-Traumatique (CPT), un concept formalisé par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun.
La CPT n'est pas la même chose que la résilience. La résilience est la capacité à résister à la détresse et à maintenir son fonctionnement. La CPT est une transformation qui se produit à travers la lutte contre le traumatisme. C'est le processus de reconstruction qui mène à un niveau de fonctionnement psychologique supérieur ou plus complexe qu'avant l'épreuve. La CPT se manifeste généralement dans cinq domaines principaux :
- Une plus grande appréciation de la vie : Une conscience renouvelée de la préciosité de chaque instant.
- Des relations interpersonnelles plus profondes : Un sentiment accru d'intimité et de compassion pour les autres.
- Un sentiment de force personnelle accrue : La prise de conscience "Si j'ai survécu à ça, je peux tout affronter".
- L'identification de nouvelles possibilités ou d'une nouvelle voie dans la vie : Un changement de priorités, une réorientation de carrière, un nouvel engagement.
- Un développement spirituel ou existentiel : Un approfondissement des questions sur le sens de la vie et sa place dans l'univers.
Le moteur de la CPT semble être la rumination cognitive. Cependant, il ne s'agit pas de la rumination intrusive et anxiogène qui caractérise le TSPT, mais d'une rumination délibérée et constructive. C'est un effort cognitif intense pour comprendre l'événement, lui trouver un sens et l'intégrer dans sa vision du monde. Le choc du traumatisme brise les croyances fondamentales de la personne sur le monde (qui est juste, prévisible, bienveillant). La CPT émerge de la lutte pour reconstruire une vision du monde nouvelle, plus nuancée et plus sage. Le soutien social et la capacité à s'ouvrir sur son expérience sont des facilitateurs essentiels de ce processus.
G. Cultiver la Résilience : Interventions Thérapeutiques et Stratégies Pratiques
La compréhension scientifique de la résilience a ouvert la voie à des interventions ciblées visant à la renforcer. Puisque la résilience est un processus dynamique reposant sur des compétences, elle peut être apprise et développée.
Plusieurs approches thérapeutiques ont prouvé leur efficacité :
Les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC) : Les TCC aident les individus à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs et les comportements inadaptés qui entretiennent la détresse. En enseignant des compétences comme la réévaluation cognitive, la résolution de problèmes et l'exposition progressive aux situations redoutées, les TCC renforcent directement les piliers psychologiques de la résilience.
La Thérapie d'Acceptation et d'Engagement (ACT) : L'ACT, une vague plus récente de TCC, ne vise pas à éliminer les pensées et émotions difficiles, mais à changer notre relation avec elles. Elle encourage l'acceptation de ce qui ne peut être contrôlé et l'engagement dans des actions alignées avec ses valeurs personnelles. En cultivant la flexibilité psychologique, l'ACT est particulièrement efficace pour renforcer la résilience face à la douleur inévitable de l'existence.
L'Intégration Neuro-Émotionnelle par les Mouvements Oculaires (EMDR) : Spécifiquement conçue pour le traitement des traumatismes, l'EMDR aide le cerveau à retraiter les souvenirs traumatiques "bloqués" et à les intégrer de manière adaptative. En réduisant la charge émotionnelle des souvenirs, l'EMDR libère des ressources cognitives et émotionnelles, permettant à la personne de se projeter à nouveau dans l'avenir.
Les Interventions basées sur la Pleine Conscience (Mindfulness) : Des programmes comme la Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience (MBSR) entraînent l'individu à porter une attention non jugeante au moment présent. Cette pratique renforce les circuits du cortex préfrontal, améliore la régulation émotionnelle et réduit la réactivité au stress. La pleine conscience permet de créer un espace entre le stimulus (l'émotion, la pensée) et la réponse, un espace où le choix et l'adaptation deviennent possibles.
Au-delà des thérapies formelles, des stratégies comme la tenue d'un journal, l'exercice physique régulier (qui a des effets neurotrophiques et anti-dépresseurs), le renforcement délibéré des liens sociaux et l'engagement dans des activités porteuses de sens sont autant de moyens concrets de bâtir son "capital résilience" au quotidien.
Conclusion
La résilience psychologique est loin d'être la simple capacité à "encaisser les coups". C'est un phénomène extraordinairement complexe, une symphonie jouée sur plusieurs niveaux de notre être. Elle puise ses racines dans la flexibilité de nos circuits neuronaux et la régulation de notre biochimie, est façonnée par l'interaction subtile de nos gènes et de nos expériences de vie, et s'exprime à travers un ensemble de compétences cognitives et émotionnelles. Elle ne s'épanouit que rarement dans l'isolement, mais se nourrit au contraire de la chaleur des liens humains qui nous soutiennent.
Comprendre la résilience, c'est reconnaître que la vulnérabilité et la force ne sont pas opposées, mais deux facettes d'une même condition humaine. La souffrance n'est pas un signe d'échec, mais une partie inhérente du parcours. La résilience n'est pas la promesse d'une vie sans douleur, mais la démonstration de l'incroyable capacité de l'esprit humain à guérir, à s'adapter et, parfois, à transformer ses blessures les plus profondes en une source de sagesse et de force insoupçonnée. La recherche scientifique sur ce sujet ne fait pas qu'éclairer un mécanisme psychologique fascinant ; elle offre une feuille de route pleine d'espoir, nous rappelant que même après les plus grandes tempêtes, la reconstruction et la croissance restent possibles.
Les sources :
Afifi, T. O., & MacMillan, H. L. (2011). Resilience following child maltreatment: A review of protective factors. The Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 266–272. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674371105600504
Feder, A., Nestler, E. J., & Charney, D. S. (2009). Psychobiology and molecular genetics of resilience. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 446–457. https://www.nature.com/articles/nrn2649.pdf
Kalisch, R., Baker, D. G., Basten, U., Boks, M. P., Bonanno, G. A., Brummelman, E., ... & Geuze, E. (2017). The resilience framework as a strategy to combat stress-related disorders. Nature Human Behaviour, 1(11), 784–790. https://www.nature.com/articles/s41562-017-0200-8.pdf
Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and future. Journal of Family Theory & Review, 10(1), 12–31. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jftr.12255
Rutten, B. P., Hammels, C., Geschwind, N., Menne-Lothmann, C., Pishva, E., Schruers, K., ... & van den Hove, D. (2013). Resilience in mental health: linking psychological and neurobiological perspectives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 128(5), 343-356. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/acps.12212
Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 25338. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/ejpt.v5.25338
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1–18. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15327965pli1501_01