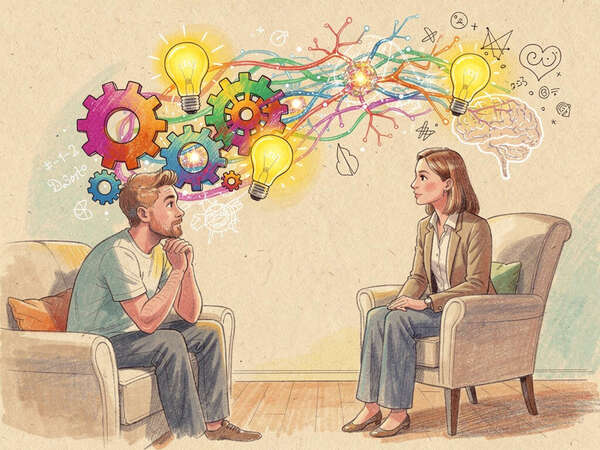Quel est l'impact de la musique sur le bien-être mental ?
Peu de phénomènes humains sont aussi omniprésents et pourtant aussi énigmatiques que la musique. De la berceuse murmurée à un nourrisson aux hymnes puissants qui unissent les foules, elle tisse la trame de nos existences individuelles et collectives. Cette universalité cache une complexité neurologique et psychologique profonde, que la science commence à peine à cartographier avec précision. Au-delà de sa fonction esthétique ou récréative, la musique se révèle être un puissant modulateur de l'activité cérébrale, capable d'influencer nos états émotionnels, nos processus cognitifs et même notre physiologie. Cette reconnaissance croissante de son potentiel a ouvert la voie à une discipline clinique structurée et fondée sur des preuves : la musicothérapie.
Cet article se propose d'explorer en profondeur la relation entre la musique et le bien-être mental. Nous nous éloignerons de l'anecdote pour nous ancrer dans les données scientifiques actuelles. Dans un premier temps, nous disséquerons les fondements neurobiologiques qui expliquent comment les sons organisés peuvent susciter des émotions et altérer notre état de conscience. Nous examinerons ensuite les mécanismes psychologiques par lesquels la musique exerce son influence, de la régulation affective à la stimulation de la mémoire. Enfin, nous aborderons le cœur de notre sujet : la musicothérapie en tant qu'intervention clinique. Nous définirons ses principes, ses méthodes et, surtout, nous détaillerons ses applications concrètes dans le traitement de diverses affections psychiatriques et neurologiques, de la dépression aux troubles du spectre de l'autisme, en passant par les syndromes post-traumatiques et les démences. L'objectif est de fournir une synthèse rigoureuse qui met en lumière non pas la "magie" de la musique, mais la science sophistiquée qui sous-tend son efficacité thérapeutique.
A. Fondements Neurobiologiques de l'Expérience Musicale
Pour comprendre comment la musique peut devenir un outil thérapeutique, il est impératif de saisir la manière dont le cerveau humain la traite. L'écoute musicale n'est pas une activité passive confinée au cortex auditif ; elle engage un vaste réseau de structures cérébrales impliquées dans l'émotion, la mémoire, l'attention, la motricité et les fonctions exécutives.
Le voyage commence dans l'oreille interne, où les vibrations sonores sont converties en signaux électriques par la cochlée. Ces signaux transitent par le tronc cérébral, où des caractéristiques acoustiques de base comme la hauteur et l'intensité sont décodées, avant d'atteindre le cortex auditif primaire, situé dans le lobe temporal. C'est ici que les éléments sonores sont assemblés en entités perceptives plus complexes : mélodies, harmonies et rythmes. Cependant, la perception musicale ne s'arrête pas là. Le cortex auditif secondaire et les régions associatives adjacentes commencent à analyser la structure musicale, à reconnaître des motifs et à former des attentes quant à la suite de la séquence.
C'est l'interaction de ce traitement auditif avec d'autres systèmes cérébraux qui confère à la musique son pouvoir émotionnel. Le système limbique, souvent décrit comme le siège de nos émotions, est particulièrement sollicité. L'amygdale, une structure clé dans le traitement de la peur mais aussi dans l'évaluation de la saillance émotionnelle en général, réagit intensément à la valence de la musique (triste, joyeuse, angoissante). Elle module notre réponse physiologique, expliquant pourquoi une musique anxiogène peut accélérer notre rythme cardiaque, tandis qu'une mélodie apaisante peut le ralentir. L'hippocampe, voisin de l'amygdale et crucial pour la formation des souvenirs, est également activé. C'est ce lien qui explique le pouvoir extraordinaire de la musique à évoquer des souvenirs autobiographiques vivaces, un phénomène connu sous le nom de "réminiscence musicale". Une simple mélodie peut nous transporter des années en arrière, avec une charge émotionnelle intacte.
L'un des mécanismes les plus étudiés et les plus significatifs est l'activation du système de récompense mésolimbique. Ce circuit, qui inclut l'aire tegmentale ventrale (ATV) et le noyau accumbens, est fondamental dans le traitement du plaisir et de la motivation. Il est activé par des récompenses primaires (nourriture, sexe) et par des drogues addictives. Des études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont démontré de manière concluante que l'écoute d'une musique particulièrement plaisante provoque une libération de dopamine dans le noyau accumbens. Cette libération est même observée lors de l'anticipation d'un passage musical particulièrement apprécié (le "frisson" musical). Ce mécanisme neurochimique explique non seulement le plaisir intrinsèque que nous tirons de la musique, mais aussi son potentiel à contrer l'anhédonie (l'incapacité à ressentir du plaisir), un symptôme central de la dépression majeure.
Enfin, le cortex préfrontal (CPF), siège des fonctions exécutives supérieures, joue un rôle de chef d'orchestre. Le CPF dorsolatéral est impliqué dans le maintien de la structure musicale en mémoire de travail, tandis que le CPF ventromédian et le cortex orbitofrontal intègrent les informations émotionnelles et cognitives pour guider la prise de décision et le jugement esthétique. Cette région est essentielle pour réguler les réponses émotionnelles initiées par le système limbique, nous permettant de prendre de la distance ou, au contraire, de nous immerger dans l'expérience musicale. La musique engage également les aires motrices, y compris le cortex prémoteur et les ganglions de la base, même en l'absence de mouvement physique. Cette "simulation motrice" explique notre tendance irrépressible à taper du pied ou à hocher la tête en rythme (phénomène d'entraînement ou "entrainment"), un principe fondamental utilisé en musicothérapie pour la rééducation motrice.
En somme, l'expérience musicale est une symphonie neuronale complexe. Elle n'est pas localisée dans un "centre de la musique", mais émerge de l'interaction dynamique entre des réseaux dédiés à la perception sensorielle, à l'émotion, à la mémoire, à la récompense et au contrôle cognitif. C'est cette nature holistique et intégrative qui constitue le socle neurobiologique de son potentiel thérapeutique.
B. Mécanismes Psychologiques de l'Influence Musicale
Si la neurobiologie nous offre le "comment" matériel, la psychologie nous éclaire sur le "pourquoi" fonctionnel. Les mécanismes psychologiques décrivent les processus par lesquels l'engagement musical se traduit par des changements observables dans le comportement, la cognition et le bien-être subjectif. On peut les regrouper en plusieurs catégories interdépendantes.
- 1. Régulation Affective et Émotionnelle La régulation émotionnelle est peut-être l'application la plus intuitive et la plus étudiée de la musique. Elle se réfère à notre capacité à influencer les émotions que nous ressentons, quand nous les ressentons et comment nous les exprimons. La musique offre une palette d'outils extraordinairement riche pour cette régulation. Elle peut être utilisée pour la down-regulation (atténuation) d'états négatifs : écouter une musique calme et à tempo lent peut réduire l'anxiété et le stress en diminuant l'activation du système nerveux sympathique (baisse du rythme cardiaque, de la pression artérielle et des niveaux de cortisol). Inversement, elle peut servir à l' up-regulation (amplification) d'états positifs : une musique rythmée et énergique peut combattre la léthargie et améliorer l'humeur. Au-delà de cette modulation directe, la musique facilite des stratégies de régulation plus complexes. Elle peut induire une distanciation cognitive, permettant à un individu de prendre du recul par rapport à une pensée ou une émotion douloureuse. Elle peut aussi favoriser l' expression émotionnelle : pour des personnes qui peinent à verbaliser leurs sentiments, créer ou écouter une musique qui résonne avec leur état interne peut offrir une voie d'extériorisation cathartique et validante.
- 2. Modulation Cognitive L'impact de la musique ne se limite pas à la sphère affective. Elle exerce une influence notable sur nos processus cognitifs. L'un des effets les plus connus est la distraction attentionnelle. En focalisant l'attention sur une structure auditive complexe et engageante, la musique peut détourner les ressources cognitives de stimuli aversifs, qu'ils soient internes (ruminations anxieuses, pensées dépressives) ou externes (douleur chronique). C'est un principe clé dans la gestion de la douleur et de l'anxiété procédurale (par exemple, avant une chirurgie). La musique peut également améliorer certaines fonctions cognitives, bien que les résultats du fameux "effet Mozart" aient été largement nuancés. Il semble que l'amélioration des performances sur des tâches cognitives soit moins liée à la musique de Mozart en elle-même qu'à l'augmentation de l'éveil et de l'humeur positive qu'elle peut induire. Cependant, dans le contexte de la rééducation cognitive, des rythmes structurés peuvent servir de "scaffolding" (échafaudage) temporel pour organiser l'action et la pensée, notamment chez les patients ayant des déficits des fonctions exécutives.
- 3. Stimulation de la Mémoire et de l'Identité Comme mentionné précédemment, le lien entre musique et mémoire est particulièrement puissant, notamment pour la mémoire autobiographique. La musique agit comme un puissant indice de récupération. Les mélodies associées à des périodes de vie spécifiques, en particulier l'adolescence et le début de l'âge adulte (un phénomène connu sous le nom de "pic de réminiscence"), peuvent débloquer des souvenirs avec une clarté et une vivacité émotionnelle surprenantes. Ce mécanisme est d'une importance capitale en gériatrie et dans le soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En réactivant des souvenirs personnels, la musique peut temporairement restaurer un sentiment de continuité de soi et d'identité chez des patients dont la mémoire sémantique et épisodique est sévèrement atteinte.
- 4. Facilitation de la Connexion Sociale La musique est une activité profondément sociale. Faire de la musique en groupe (chanter dans une chorale, jouer dans un orchestre) exige une synchronisation interpersonnelle fine. Cet alignement comportemental, facilité par le rythme, favorise l'émergence de sentiments de cohésion, d'affiliation et d'empathie. L'expérience partagée d'une émotion intense lors d'un concert en est une illustration parfaite. En thérapie, les activités musicales de groupe peuvent être utilisées pour travailler les compétences sociales, la communication non verbale, la prise de tour de rôle et la coopération. Pour des populations isolées socialement (personnes âgées, patients atteints de troubles psychiatriques sévères), ces expériences peuvent briser l'isolement et recréer un sentiment d'appartenance.
Ces mécanismes psychologiques ne sont pas mutuellement exclusifs. Au contraire, ils interagissent constamment. Une séance de musicothérapie de groupe peut simultanément réguler l'anxiété individuelle, stimuler la cognition sociale et renforcer le sentiment d'identité collective. C'est cette multifonctionnalité qui fait de la musique un levier thérapeutique si polyvalent.
C. La Musicothérapie : Une Discipline Clinique Structurée
Il est fondamental de distinguer l'utilisation quotidienne de la musique pour le bien-être de la musicothérapie en tant que profession de santé. La musicothérapie n'est pas simplement le fait de prescrire une "playlist" relaxante. C'est une intervention clinique, fondée sur des preuves (evidence-based), qui utilise la musique et ses éléments (son, rythme, mélodie, harmonie) dans le cadre d'une relation thérapeutique établie entre un patient (ou un groupe) et un musicothérapeute qualifié.
Le musicothérapeute est un professionnel qui a suivi une formation universitaire spécifique, alliant des compétences musicales avancées à une connaissance approfondie de la psychologie, de la psychopathologie, des neurosciences et des méthodes de recherche clinique. Son rôle est d'évaluer les besoins du patient, de définir des objectifs thérapeutiques précis et de concevoir des interventions musicales sur mesure pour atteindre ces objectifs.
L'élément central de la pratique est l'alliance thérapeutique. Comme dans toute psychothérapie, la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient est un facteur déterminant du succès. La musique devient un "tiers objet" médiateur, un espace de communication sécurisé qui peut faciliter l'établissement de ce lien, en particulier lorsque la communication verbale est difficile ou compromise.
Les méthodes en musicothérapie se déclinent principalement en deux approches, souvent combinées :
1. Les Méthodes Actives Dans les approches actives, le patient est engagé dans la création musicale. Il ne s'agit pas de produire une œuvre esthétiquement parfaite ; l'accent est mis sur le processus et non sur le produit final.
- L'improvisation clinique : Le patient et le thérapeute créent de la musique spontanément, à l'aide d'instruments de percussion, de claviers, ou de la voix. Cette technique est extraordinairement riche. Elle permet au patient d'exprimer des émotions non verbalisées, d'explorer différentes facettes de sa personnalité, de tester des modes relationnels (diriger, suivre, dialoguer) dans un cadre sécurisé. Le thérapeute peut utiliser des techniques de "mirroring" (refléter musicalement ce que le patient joue) pour valider son expression, ou d' "empathie musicale" pour montrer qu'il comprend l'état émotionnel du patient.
- La composition (Songwriting) : Le patient est guidé pour écrire les paroles et/ou composer la musique d'une chanson. Ce processus peut aider à structurer une pensée chaotique, à raconter une histoire de vie, à externaliser un traumatisme ou à formuler des espoirs pour l'avenir. L'acte de créer une chanson peut être extrêmement valorisant et renforcer l'estime de soi.
- La performance instrumentale ou vocale : Le fait de rejouer une pièce musicale existante peut travailler la motricité, la concentration, la mémoire et le contrôle de l'impulsivité.
2. Les Méthodes Réceptives Dans les approches réceptives, le patient est principalement en position d'écoute. L'intervention est soigneusement structurée par le thérapeute.
- L'écoute et le dialogue : Le thérapeute sélectionne des œuvres musicales spécifiques en fonction des objectifs thérapeutiques. Après l'écoute, un temps de verbalisation est proposé pour discuter des émotions, des images, des pensées ou des souvenirs suscités par la musique. Cela peut servir de point de départ pour une exploration psychothérapeutique plus profonde.
- La méthode GIM (Guided Imagery and Music) : C'est une approche psychothérapeutique profonde où le patient, dans un état de relaxation, écoute un programme de musique classique spécifiquement séquencé. Le thérapeute le guide verbalement pour qu'il explore les images, sensations et émotions qui émergent. La GIM est souvent utilisée pour travailler sur des problématiques existentielles, des traumatismes ou pour favoriser la croissance personnelle.
- La relaxation musicale : Il s'agit d'utiliser des musiques spécifiquement conçues (tempo lent, textures sonores douces, structures prévisibles) pour induire une réponse de relaxation physiologique et psychologique, souvent combinée avec des techniques de respiration ou de visualisation.
Le choix entre méthodes actives et réceptives, ainsi que la sélection des techniques spécifiques, dépendent de la population, des objectifs thérapeutiques, et des préférences du patient. Un adolescent ayant des difficultés à exprimer sa colère pourra bénéficier de l'improvisation sur des percussions, tandis qu'une personne en fin de vie pourra trouver du réconfort dans l'écoute de musiques qui ont marqué son existence.
D. Applications Cliniques de la Musicothérapie
La base de données probantes soutenant l'efficacité de la musicothérapie s'est considérablement étoffée au cours des deux dernières décennies. Des méta-analyses et des essais contrôlés randomisés ont validé son utilité dans un large éventail de troubles mentaux et neurologiques.
- 1. Troubles Dépressifs et Anxieux La dépression et l'anxiété sont parmi les domaines où la musicothérapie a été le plus étudiée. Pour la dépression, elle agit sur plusieurs fronts. Les approches actives comme l'improvisation ou la composition peuvent contrer l'anhédonie en stimulant le système de récompense dopaminergique. Elles offrent également un canal d'expression pour les sentiments de tristesse ou de colère que le patient ne peut verbaliser, réduisant ainsi la rumination. Les interventions de groupe diminuent le sentiment d'isolement social, un facteur de maintien de la dépression. Concernant les troubles anxieux (anxiété généralisée, trouble panique, phobies), les méthodes réceptives sont particulièrement efficaces. L'écoute de musique à tempo lent (environ 60-80 battements par minute) a démontré sa capacité à réduire significativement les marqueurs physiologiques du stress : diminution du rythme cardiaque, de la pression artérielle et des niveaux de cortisol salivaire. L'entraînement rythmique peut également aider les patients à réguler leur respiration et à détourner leur attention des pensées anxiogènes.
- 2. Traumatisme et Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) Le traumatisme est souvent stocké dans le corps et dans des mémoires non-verbales, sensorielles et émotionnelles. La verbalisation peut être extrêmement difficile, voire re-traumatisante. La musicothérapie offre ici une alternative précieuse. L'improvisation musicale sur des instruments de percussion peut permettre une externalisation sécurisée de l'énergie traumatique (colère, peur). Le rythme peut être utilisé comme un outil de "grounding" (ancrage), aidant le patient à se reconnecter au moment présent et à réguler un système nerveux hyperactivé. Le thérapeute peut aider le patient à construire progressivement des séquences musicales qui évoluent du chaos vers la structure, symbolisant le processus de reconstruction et de reprise de contrôle sur son expérience.
- 3. Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) La musique est un outil particulièrement pertinent pour les personnes avec un TSA. Beaucoup d'entre elles montrent une sensibilité et un intérêt marqués pour la musique. Les structures musicales, avec leurs motifs répétitifs et prévisibles, peuvent être rassurantes dans un monde perçu comme chaotique. La musicothérapie vise des objectifs fonctionnels :
- Communication et interaction sociale : Les jeux musicaux d'improvisation (appel-réponse, dialogue instrumental) modélisent les bases de la communication sociale : prise de tour de rôle, attention conjointe, écoute de l'autre.
- Régulation sensorielle et émotionnelle : La musique peut aider à moduler l'hyper ou l'hypo-sensibilité auditive et à réguler l'anxiété, fréquente chez les personnes avec TSA.
- Développement moteur : Les activités rythmiques peuvent améliorer la coordination motrice et la planification des mouvements.
4. Troubles Neurocognitifs (Maladie d'Alzheimer et Démences apparentées) C'est l'un des champs d'application les plus spectaculaires et les mieux documentés. Alors que de nombreuses capacités cognitives déclinent, la mémoire musicale et les capacités de traitement musical restent souvent remarquablement préservées, même à un stade avancé de la maladie. L'utilisation de playlists personnalisées avec des chansons significatives de la jeunesse du patient peut :
- Réduire l'agitation et l'agressivité : L'écoute de musique familière et apaisante a un effet calmant puissant.
- Améliorer l'humeur et réduire l'apathie : La stimulation du système de récompense peut ramener le sourire et l'envie de participer.
- Stimuler la mémoire autobiographique : Comme discuté précédemment, la musique peut débloquer des souvenirs et permettre des moments de reconnexion avec les proches et avec sa propre identité.
- Faciliter l'interaction sociale : Les séances de chant en groupe encouragent la participation, le contact visuel et le sentiment d'appartenance, même chez des personnes devenues mutiques.
- 5. Schizophrénie et autres Troubles Psychotiques Pour les patients atteints de schizophrénie, la musicothérapie peut aider à traiter les symptômes négatifs (retrait social, émoussement affectif, alogie), qui répondent souvent mal aux traitements pharmacologiques. Les séances de groupe peuvent encourager l'interaction sociale dans un cadre non menaçant. L'improvisation peut permettre une expression émotionnelle qui est souvent bloquée. De plus, en se concentrant sur une tâche musicale structurée, les patients peuvent améliorer leur attention et leurs fonctions exécutives, souvent déficitaires.
- Frontières de la Recherche et Perspectives d'Avenir
Le champ de la musicothérapie est en pleine effervescence, porté par les avancées en neurosciences et en technologie. Plusieurs axes de recherche prometteurs se dessinent.
Le premier est celui de la personnalisation des interventions. L'ère de la "médecine de précision" s'applique aussi à la musicothérapie. Plutôt que d'utiliser des protocoles génériques, la recherche s'oriente vers l'identification de biomarqueurs (par exemple, via électroencéphalogramme - EEG, ou variabilité de la fréquence cardiaque - VFC) qui pourraient prédire la réponse d'un individu à un type de musique ou d'intervention. L'analyse acoustique des préférences musicales personnelles, combinée à l'histoire de vie du patient, permettra de créer des interventions sur mesure, maximisant l'engagement et l'efficacité thérapeutique.
Le deuxième axe concerne l'intégration de la technologie. La réalité virtuelle (VR) peut être utilisée pour créer des environnements d'écoute immersifs et sécurisants. Des applications mobiles de musicothérapie, basées sur des principes d'intelligence artificielle et de biofeedback, pourraient offrir un soutien accessible entre les séances. Par exemple, une application pourrait ajuster en temps réel la musique diffusée en fonction des données physiologiques de l'utilisateur (rythme cardiaque, conductance cutanée) pour optimiser la relaxation ou la concentration.
Le troisième défi majeur est la standardisation et la réplication des études. Pour que la musicothérapie soit pleinement intégrée dans les systèmes de santé et remboursée par les assurances, il est crucial de continuer à produire des recherches de haute qualité, notamment des essais contrôlés randomisés à grande échelle, avec des protocoles clairs et des mesures de résultats standardisées. Cela permettra de comparer les études entre elles et de construire des méta-analyses encore plus robustes.
Enfin, la recherche explore de plus en plus les mécanismes d'action à un niveau fondamental. Comprendre précisément comment l'entraînement rythmique peut réorganiser les réseaux neuronaux moteurs après un AVC, ou comment l'improvisation musicale modifie la connectivité du réseau du mode par défaut chez les personnes dépressives, permettra de raffiner les interventions pour cibler des mécanismes neurocognitifs spécifiques.
Conclusion
L'impact de la musique sur le bien-être mental n'est plus un sujet relevant de la croyance populaire ou de l'intuition. Il repose sur des fondements neurobiologiques solides et des mécanismes psychologiques bien identifiés. Du traitement du signal dans le cortex auditif à l'activation des circuits de la récompense et de la mémoire, en passant par la régulation des centres émotionnels, la musique engage le cerveau dans sa totalité. La musicothérapie a su capitaliser sur cette puissance intrinsèque pour la transformer en une discipline clinique rigoureuse et efficace.
En offrant un espace d'expression non-verbal, en facilitant la régulation émotionnelle, en stimulant la cognition et en renforçant les liens sociaux, elle apporte une contribution unique et précieuse à l'arsenal thérapeutique en santé mentale. Ses applications, validées par une recherche en expansion constante, démontrent son utilité auprès de populations variées, de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme à la personne âgée atteinte de démence.
L'avenir de la discipline est prometteur, à la croisée de l'art ancestral de la musique et des technologies de pointe en neurosciences. En continuant à approfondir notre compréhension scientifique de ses effets et à affiner ses méthodes cliniques, la musicothérapie est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans une approche intégrative et humaniste du soin psychique, nous rappelant que dans la structure organisée du son réside un potentiel de guérison et de reconnexion profondément humain.
Les sources :
Bradt, J., & Dileo, C. (2022). Music therapy for pain management. In M. J. F. R. R. S. D. G. Edwards (Ed.), Oxford Handbook of Music Psychology (2nd ed.). Oxford University Press. (Note: Bien que ce soit un chapitre de livre, il représente une synthèse de pointe par des leaders du domaine).
Chanda, M. L., & Levitin, D. J. (2013). The neurochemistry of music. Trends in Cognitive Sciences, 17(4), 179–193. https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.02.007 URL: https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(13)00035-4
Garrido, S., Román, I. Y., & Tabei, K. (2021). The evaluation of music in everyday life: The role of personality and negative mood. Psychology of Music, 49(6), 1547–1564. https://doi.org/10.1177/0305735620961803 URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0305735620961803
Geretsegger, M., Fusar-Poli, L., Elefant, C., Mössler, K. A., & Gold, C. (2022). Music therapy for autistic people. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2022(5). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub4 URL: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004381.pub4/full
Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 170–180. https://doi.org/10.1038/nrn3666 URL: https://www.nature.com/articles/nrn3666
Kushnir, L., & Rassovsky, Y. (2021). The effect of receptive music therapy on psychophysiological measures of relaxation: A systematic review and meta-analysis. Psychology of Music, 49(5), 1011-1029. https://doi.org/10.1177/0305735620928258 URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0305735620928258
LaGasse, A. B., & Thaut, M. H. (2023). Music and the brain: A neuroscientific model of music perception and applications in music therapy. In A. J. Knight, A. B. LaGasse, & A. C. McClean (Eds.), Music therapy: An introduction to the profession. American Music Therapy Association.
Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., & Zatorre, R. J. (2011). Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nature Neuroscience, 14(2), 257–262. https://doi.org/10.1038/nn.2726 URL: https://www.nature.com/articles/nn.2726
Sihvonen, A. J., Särkämö, T., Leo, V., Tervaniemi, M., Altenmüller, E., & Soinila, S. (2017). Music-based interventions in neurological rehabilitation. The Lancet Neurology, 16(8), 648–660. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30168-0 URL: https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30168-0/fulltext
Van der Kooi, K., & Van den Boogaard, M. (2023). The effect of music therapy on agitation in older adults with dementia: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 71(4), 1161-1171. https://doi.org/10.1111/jgs.18204 URL: https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.18204