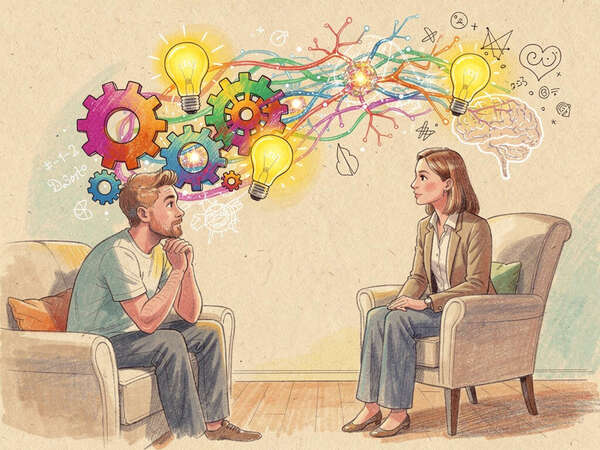Les effets psychologiques du changement climatique
L'urgence climatique ne se manifeste plus uniquement dans les colonnes de température, les courbes d'émissions de CO₂ ou la fonte accélérée des glaciers. Elle s'inscrit désormais dans l'intimité des consciences, dans les architectures émotionnelles qui structurent notre rapport au monde. Lorsque les systèmes terrestres vacillent, c'est l'édifice psychique lui-même qui se fissure. Les conséquences du dérèglement climatique dépassent le cadre des catastrophes physiques pour pénétrer les territoires les plus vulnérables de l'expérience humaine : ceux de la santé mentale, de l'équilibre émotionnel et des capacités d'adaptation psychologique.
Cette intrusion du climat dans la psyché n'est pas métaphorique. Elle s'objective dans une symptomatologie émergente, une nosographie en construction qui témoigne d'une transformation profonde du paysage mental contemporain. Les praticiens de la santé mentale observent l'apparition de configurations cliniques inédites, de détresses spécifiques qui échappent aux catégories diagnostiques traditionnelles. Face à cette réalité, la psychologie doit repenser ses cadres théoriques, élargir son vocabulaire conceptuel et développer des modalités d'intervention adaptées à une crise dont l'amplitude dépasse tout ce que l'humanité a connu.
A. Les impacts psychopathologiques directs des événements climatiques extrêmes
La multiplication des événements météorologiques extrêmes constitue le vecteur le plus immédiat des atteintes à la santé mentale. Les ouragans, inondations, incendies de forêt et vagues de chaleur ne laissent pas seulement des paysages dévastés ; ils gravent dans les psychés des traumatismes durables dont les manifestations cliniques sont aujourd'hui bien documentées.
Les recherches menées après des catastrophes majeures révèlent une prévalence significativement élevée de troubles psychiatriques chez les populations exposées. Le trouble de stress post-traumatique figure au premier rang de ces pathologies, avec des taux de prévalence pouvant dépasser cinquante pour cent chez les enfants ayant vécu un ouragan destructeur. Cette symptomatologie traumatique s'accompagne fréquemment de tableaux dépressifs majeurs, de troubles anxieux généralisés et de perturbations significatives du sommeil. L'exposition à des situations où la vie est menacée crée les conditions d'une rupture dans la continuité psychique, une effraction traumatique dont les effets se prolongent bien au-delà de l'événement lui-même.
Les vagues de chaleur, dont l'intensité et la fréquence s'accroissent de manière exponentielle, exercent des effets particulièrement pernicieux sur le fonctionnement mental. L'élévation des températures ne se contente pas d'induire un inconfort physique ; elle perturbe les équilibres neurobiologiques, altère les capacités de régulation émotionnelle et exacerbe les vulnérabilités préexistantes. Les données épidémiologiques établissent une corrélation robuste entre les épisodes de chaleur extrême et l'augmentation des taux de suicide, des admissions psychiatriques et des manifestations d'agressivité. Les personnes souffrant déjà de troubles mentaux présentent un risque accru de décompensation, de mortalité et d'hospitalisation durant ces périodes critiques.
Au-delà du traumatisme immédiat, les conséquences des catastrophes climatiques s'étendent dans le temps et l'espace psychosocial. La destruction des habitations, les déplacements forcés, la perte de proches, la désorganisation des structures communautaires et l'interruption de l'accès aux soins constituent autant de facteurs de stress psychosocial qui alimentent et pérennisent la détresse mentale. Le deuil, la précarisation économique et l'isolement social viennent complexifier les tableaux cliniques, créant des configurations où se mêlent traumatisme, dépression et désespoir.
B. L'émergence des syndromes psychoterratiques : une nouvelle nosographie
Face aux transformations environnementales induites par le changement climatique, le champ de la psychologie a dû forger de nouveaux concepts pour saisir des réalités émotionnelles et mentales qui échappaient aux catégories traditionnelles. Glenn Albrecht, philosophe et chercheur australien, a introduit le terme de « syndromes psychoterratiques » pour désigner ces états mentaux liés à la dégradation de la relation entre les individus et leur territoire, entre la psyché et la Terre.
Le premier de ces concepts, la solastalgie, décrit la détresse ressentie lorsque le lieu où l'on vit subit des transformations environnementales négatives. Contrairement à la nostalgie, qui implique une distance géographique, la solastalgie survient lorsque l'environnement familier se transforme sous nos yeux, créant un sentiment de dépossession alors même que l'on demeure physiquement présent. Les communautés confrontées à la destruction de leurs paysages par la sécheresse, les incendies ou la montée des eaux océaniques témoignent de cette forme particulière de souffrance : celle de voir son chez-soi devenir étranger, de perdre les repères spatiaux et sensoriels qui structuraient l'identité et le sentiment d'appartenance.
L'éco-anxiété constitue sans doute le concept le plus largement diffusé de cette nouvelle nosographie. Définie comme une peur chronique de la catastrophe environnementale, elle désigne un état d'appréhension constant face à l'avenir écologique de la planète. Cette anxiété se nourrit de la conscience grandissante de l'ampleur de la crise, de l'inaction politique perçue et de l'incertitude radicale qui pèse sur les décennies à venir. Les manifestations de l'éco-anxiété sont multiples : sentiments d'impuissance, de colère, de désespoir, ruminations obsédantes sur l'avenir, difficultés de projection dans le futur et altérations du fonctionnement quotidien.
Les recherches récentes montrent qu'environ seize pour cent des adultes américains rapportent au moins une caractéristique de détresse psychologique liée au changement climatique. Cette prévalence n'est pas distribuée uniformément dans la population. Les jeunes adultes, les communautés hispaniques et latino-américaines, les personnes à faibles revenus et les populations urbaines présentent des niveaux de détresse significativement plus élevés. Ces disparités reflètent à la fois des différences d'exposition aux risques environnementaux, des vulnérabilités socioéconomiques préexistantes et des variations dans les niveaux de préoccupation écologique.
Le chagrin écologique représente une autre dimension de cette souffrance contemporaine. Il s'agit d'un processus de deuil face à la perte d'écosystèmes, d'espèces, de paysages ou de modes de vie liés à la nature. Ce deuil présente des particularités qui le distinguent des formes traditionnelles : il est souvent ambigu, non résolu, anticipé plutôt qu'accompli. Les individus pleurent non seulement ce qui a été perdu mais aussi ce qui sera perdu, créant une forme de deuil anticipatoire qui pèse lourdement sur le bien-être psychologique.
C. Les mécanismes psychologiques sous-jacents
Comprendre les effets psychologiques du changement climatique nécessite d'examiner les processus cognitifs, émotionnels et adaptatifs qui médiatisent ces impacts. Le changement climatique confronte les individus à une menace existentielle d'une nature particulière : diffuse, progressive, globale et largement hors de contrôle individuel. Cette configuration crée des défis psychologiques spécifiques qui mobilisent et parfois dépassent les capacités adaptatives humaines.
L'incertitude constitue l'une des dimensions les plus anxiogènes de la crise climatique. Contrairement à de nombreuses autres menaces, le changement climatique se caractérise par une imprévisibilité profonde concernant ses manifestations locales, son calendrier, son amplitude exacte et ses conséquences en cascade. Cette incertitude radicale entrave les processus de planification, perturbe le sentiment de maîtrise et alimente une anxiété qui ne trouve pas d'objet stable sur lequel se fixer. L'impossibilité de prévoir précisément les risques futurs empêche l'élaboration de stratégies d'adaptation claires, laissant les individus dans un état de vigilance anxieuse chronique.
La régulation émotionnelle joue un rôle central dans la manière dont les individus font face à la détresse climatique. Les recherches suggèrent que les difficultés de régulation émotionnelle pourraient constituer un facteur de vulnérabilité important face à l'éco-anxiété. Les personnes présentant des déficits dans leur capacité à comprendre, accepter et moduler leurs émotions seraient plus susceptibles de développer des réponses inadaptées face aux informations anxiogènes concernant le climat. Inversement, le développement de compétences en régulation émotionnelle pourrait représenter une cible thérapeutique prometteuse pour aider les individus à gérer leur détresse sans la nier ni se laisser submerger.
Les stratégies de coping développées face au changement climatique varient considérablement et déterminent largement l'ajustement psychologique. Le coping centré sur le problème, qui implique de s'engager activement dans des actions visant à réduire la menace, semble généralement associé à un meilleur bien-être psychologique. À l'inverse, les stratégies d'évitement, de déni ou de distraction tendent à maintenir voire aggraver la détresse à long terme. Toutefois, la nature systémique et l'ampleur du changement climatique rendent parfois le coping centré sur le problème difficile à mettre en œuvre, créant des situations où les individus oscillent entre engagement et épuisement.
Le concept d'auto-efficacité revêt une importance particulière dans ce contexte. La croyance en sa capacité personnelle à contribuer positivement à la résolution du problème climatique apparaît comme un facteur protecteur majeur. Les recherches montrent que l'engagement dans des comportements pro-environnementaux, qu'ils soient individuels ou collectifs, peut renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et atténuer la détresse psychologique. Cette observation souligne l'importance de promouvoir non seulement la prise de conscience des enjeux climatiques, mais également les opportunités d'action concrète qui permettent aux individus de se sentir agents de changement plutôt que spectateurs impuissants.
D. Les populations vulnérables et les inégalités psychologiques
Les effets psychologiques du changement climatique ne frappent pas uniformément. Certaines populations présentent des vulnérabilités accrues, cumulant expositions environnementales et fragilités préexistantes. Cette distribution inégale de la détresse mentale reflète et amplifie les injustices sociales, créant ce que certains chercheurs nomment des « inégalités psychologiques » face au climat.
Les enfants et les adolescents constituent l'une des populations les plus affectées psychologiquement par la crise climatique. Une enquête internationale menée auprès de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révèle que soixante-deux pour cent d'entre eux se sentent anxieux face au changement climatique et trente-neuf pour cent se sentent déprimés. Plus préoccupant encore, quarante-cinq pour cent rapportent que leurs sentiments négatifs concernant le climat affectent leur fonctionnement quotidien. Cette détresse juvénile s'explique par plusieurs facteurs : une conscience aiguë de l'ampleur de la menace, une perception d'inaction de la part des générations précédentes, et l'angoisse face à un avenir compromis avant même d'avoir pu se déployer.
L'anxiété climatique chez les jeunes soulève des questions éthiques et développementales complexes. À quel point est-il sain ou pathologique de ressentir de l'anxiété face à une menace réelle et objective ? Comment accompagner les jeunes dans l'élaboration de cette anxiété sans minimiser la gravité de la situation ni les accabler de désespoir ? Ces interrogations défient les modèles traditionnels de la psychologie du développement, qui présumaient généralement un environnement stable dans lequel l'enfant pouvait se projeter.
Les communautés racisées et les populations à faibles revenus présentent des niveaux de détresse climatique significativement supérieurs à la moyenne. Cette surreprésentation s'explique par une exposition disproportionnée aux risques environnementaux. Les quartiers défavorisés et les communautés de couleur subissent de manière accrue les effets de la pollution, des îlots de chaleur urbains, des inondations et d'autres aléas climatiques. Cette exposition différentielle s'enracine dans des décennies d'injustice environnementale, de ségrégation spatiale et de racisme systémique qui ont concentré les populations vulnérables dans les zones les plus exposées.
Au-delà de l'exposition physique, ces populations font face à des barrières supplémentaires dans l'accès aux ressources de résilience : systèmes de santé mentale moins accessibles, précarité économique limitant les capacités d'adaptation, capital social fragilisé par l'instabilité. Paradoxalement, ces mêmes communautés manifestent souvent des niveaux élevés d'engagement environnemental et de leadership dans les mouvements climatiques, témoignant d'une résilience collective forgée dans l'adversité historique.
Les personnes souffrant de troubles mentaux préexistants constituent une autre population à risque. Le changement climatique agit comme un multiplicateur de menaces, exacerbant les vulnérabilités existantes. Les patients suivis pour dépression, troubles anxieux ou troubles psychotiques présentent des risques accrus de décompensation lors d'événements climatiques extrêmes. Les perturbations dans l'accès aux soins, les ruptures médicamenteuses lors de déplacements forcés et le stress physiologique des vagues de chaleur peuvent précipiter des crises psychiatriques graves.
E. La relation complexe entre détresse climatique et engagement
L'une des questions les plus débattues dans la littérature récente concerne la relation entre la détresse psychologique liée au climat et l'engagement dans l'action climatique. Deux hypothèses contradictoires s'affrontent : d'une part, l'idée que l'anxiété et le désespoir paralyseraient l'action, conduisant à l'évitement et à l'apathie ; d'autre part, la proposition selon laquelle ces émotions négatives pourraient motiver l'engagement comme stratégie de coping adaptative.
Les données empiriques récentes penchent nettement en faveur de la seconde hypothèse. Les études montrent que les personnes rapportant au moins une caractéristique de détresse climatique sont significativement plus susceptibles de s'engager dans des actions collectives sur le climat, de manifester l'intention de le faire, et de discuter du changement climatique avec leur entourage. Cette relation persiste même lorsque l'on contrôle statistiquement de nombreux facteurs confondants tels que l'idéologie politique, les croyances d'efficacité collective ou les normes sociales perçues.
La relation entre détresse et action ne suit toutefois pas une trajectoire linéaire. Les recherches suggèrent plutôt une courbe en forme de L : une augmentation substantielle de l'engagement entre les personnes sans détresse et celles présentant au moins un symptôme, mais un plateau ou même une légère diminution aux niveaux les plus élevés de détresse. Cette configuration indique qu'une certaine quantité d'anxiété ou de préoccupation peut effectivement mobiliser l'action, mais que des niveaux extrêmes de détresse pourraient effectivement entraver la capacité à s'engager de manière soutenue.
L'activisme climatique apparaît ainsi comme un mécanisme de coping potentiellement adaptatif. En transformant des émotions pénibles en action dirigée vers la résolution du problème, les individus peuvent restaurer un sentiment d'agentivité, réduire leur sentiment d'impuissance et trouver du sens dans une situation autrement accablante. Les communautés d'activistes offrent également des espaces de validation émotionnelle, de soutien mutuel et de connexion sociale qui constituent des facteurs protecteurs bien établis en santé mentale.
Cette perspective invite à reconsidérer fondamentalement le statut de l'éco-anxiété. Plutôt qu'une pathologie à éradiquer, elle pourrait représenter une réponse psychologique adaptative à une menace réelle et objective. La médicalisation excessive de ces réactions risquerait de pathologiser des réponses normales et potentiellement fonctionnelles, détournant l'attention des véritables causes systémiques de la détresse. Plusieurs auteurs soulignent ainsi la nécessité de distinguer entre une éco-anxiété fonctionnelle, qui motive l'action tout en préservant le bien-être, et une éco-anxiété dysfonctionnelle, qui altère significativement le fonctionnement quotidien et nécessite un soutien clinique.
F. Du désespoir à l'espoir : les ressources psychologiques pour la résilience
Face à l'ampleur de la crise climatique et à ses impacts psychologiques, la question des ressources mobilisables pour maintenir la santé mentale et favoriser l'adaptation devient cruciale. Les recherches récentes identifient plusieurs leviers psychologiques susceptibles de soutenir la résilience individuelle et collective.
L'espoir écologique émerge comme un concept central dans cette perspective. Distinct de l'optimisme naïf qui minimiserait la gravité de la situation, l'espoir écologique repose sur une double reconnaissance : celle de l'ampleur de la crise et celle de la possibilité réelle d'un changement par l'action collective. Cet espoir ne nie pas l'anxiété ou le chagrin ; il les intègre dans une vision plus large qui maintient ouverte la possibilité d'un avenir vivable.
Les études montrent que l'espoir climatique corrèle positivement avec l'engagement dans l'action environnementale et le bien-être psychologique. L'espoir fonctionne comme un processus dynamique où la croyance en des issues possibles motive l'action, et où l'action elle-même, même modeste, nourrit en retour l'espérance. Cette boucle vertueuse contraste avec la spirale descendante du désespoir et de l'inaction qui caractérise le fatalisme climatique.
Cultiver l'espoir nécessite toutefois des conditions spécifiques. Les interventions psychothérapeutiques peuvent aider les individus à développer des stratégies de régulation émotionnelle efficaces, à identifier des voies d'action concrètes, et à construire du sens face à l'incertitude. Les approches de groupe s'avèrent particulièrement prometteuses, offrant des espaces où les émotions difficiles peuvent être partagées, validées et transformées collectivement. La connexion avec la nature, lorsqu'elle est possible, constitue également une ressource importante pour le bien-être mental et peut renforcer la motivation à la protéger.
Le passage d'un coping centré sur le problème à un coping centré sur le sens apparaît comme une stratégie adaptative face à une menace aussi systémique que le changement climatique. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la résolution concrète du problème — objectif qui peut sembler hors de portée à l'échelle individuelle — cette approche encourage les individus à s'appuyer sur leurs valeurs, leurs croyances existentielles et leurs objectifs de vie pour maintenir le bien-être malgré un stress chronique. Cette réorientation ne signifie pas l'abandon de l'action, mais plutôt son intégration dans une recherche plus large de cohérence et de sens.
La résilience communautaire représente une autre dimension essentielle. Les liens sociaux, les réseaux de soutien et les mobilisations collectives constituent des tampons puissants contre les effets délétères du stress climatique. Les communautés qui maintiennent une cohésion sociale forte, qui préservent ou réinventent des rituels collectifs, et qui développent des projets d'adaptation partagés démontrent de meilleures capacités de résilience face aux chocs climatiques. Cette résilience collective ne s'improvise pas ; elle nécessite des investissements délibérés dans le tissu social, l'équité et la justice.
Conclusion
Les effets psychologiques du changement climatique constituent un domaine de recherche et d'intervention en expansion rapide, qui révèle l'intrication profonde entre les systèmes écologiques et psychiques. La montée des syndromes psychoterratiques, la prévalence croissante de la détresse climatique et les impacts traumatiques des événements extrêmes témoignent d'une crise qui ne se limite pas aux paramètres physiques de la planète mais pénètre l'intimité des consciences.
Cette réalité appelle une transformation des pratiques en santé mentale. Les cliniciens doivent développer une littératie climatique qui leur permette de reconnaître, légitimer et accompagner les souffrances psychologiques liées à la crise écologique. Les interventions thérapeutiques doivent intégrer les dimensions écologiques de l'expérience contemporaine, en s'éloignant d'une pathologisation excessive pour reconnaître le caractère souvent adaptatif des réponses émotionnelles au changement climatique.
Au-delà de la clinique, c'est une responsabilité collective qui émerge : celle de créer des conditions sociales, politiques et culturelles qui soutiennent la santé mentale dans un monde en transformation. Cela implique de réduire les expositions aux risques environnementaux, de garantir un accès équitable aux ressources de résilience, de promouvoir les opportunités d'engagement significatif, et de cultiver des narratifs d'espoir réaliste qui maintiennent ouverte la possibilité d'un avenir vivable.
La psychologie du changement climatique en est encore à ses débuts. De nombreuses questions demeurent : Comment les effets psychologiques évoluent-ils sur le long terme ? Quelles interventions sont les plus efficaces pour différentes populations ? Comment articuler reconnaissance de la détresse et promotion de l'action ? Comment éviter les écueils du fatalisme sans tomber dans un optimisme déconnecté de la réalité ?
Ces interrogations ne trouveront de réponses que dans un effort de recherche soutenu, interdisciplinaire et ancré dans les expériences vécues des populations affectées. La santé mentale et la santé planétaire ne constituent pas deux domaines séparés mais deux facettes d'une même réalité systémique. Prendre soin de la psyché humaine dans l'ère de l'Anthropocène exige de reconnaître cette interdépendance fondamentale et d'agir en conséquence, avec l'urgence et la détermination que requiert notre situation commune.
Les sources :
Ágoston, C., Csaba, B., Nagy, B., Kováry, Z., Dúll, A., Rácz, J., & Dombrádi, V. (2022). Identifying types of eco-anxiety, eco-guilt, eco-grief, and eco-coping in a climate-sensitive population: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2461. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8875433/
Ballew, M. T., Uppalapati, S. S., Myers, T. A., Gustafson, A., Maibach, E. W., Kotcher, J. E., Swim, J. K., Rosenthal, S. A., & Leiserowitz, A. (2024). Climate change psychological distress is associated with increased collective climate action in the U.S. npj Climate Action, 3, 88. https://www.nature.com/articles/s44168-024-00172-8
Betro', S. (2024). From eco-anxiety to eco-hope: Surviving the climate change threat. Frontiers in Psychiatry, 15, 1429571. https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1429571/full
Centers for Disease Control and Prevention. (2025). Mental health and stress-related disorders. Climate and Health. https://www.cdc.gov/climate-health/php/effects/mental-health-disorders.html
Clayton, S. (2020). Climate anxiety: Psychological responses to climate change. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102263. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618520300773
Clayton, S., & Karazsia, B. T. (2020). Development and validation of a measure of climate change anxiety. Journal of Environmental Psychology, 69, 101434. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618520300773
Coffey, Y., Bhullar, N., Durkin, J., Islam, M. S., & Usher, K. (2021). Understanding eco-anxiety: A systematic scoping review of current literature and identified knowledge gaps. Journal of Climate Change and Health, 3, 100047. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667278221000444
Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., Wray, B., Mellor, C., & van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: A global survey. The Lancet Planetary Health, 5(12), e863-e873. https://www.nature.com/articles/d41586-024-00998-6
Hopkins Bloomberg Public Health Magazine. (2024). Climate change's psychological impact. https://magazine.publichealth.jhu.edu/2024/climate-changes-psychological-impact
National Academy of Medicine. (2025). Summary: Health impacts of extreme weather. https://nam.edu/product/extreme-weather-climate-health-hazard/
Orrù, L., & Mannarini, S. (2024). Psychological impact of climate change emergency: An attempt to define eco-anxiety. Frontiers in Psychology, 15, 1375803. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1375803/full
Schwartz, S. E. O., Benoit, L., Clayton, S., Parnes, M. F., Swenson, L., & Lowe, S. R. (2023). Climate change anxiety and mental health: Environmental activism as buffer. Current Psychology, 42, 16708-16721. https://www.nature.com/articles/s44168-024-00172-8
Stanley, S. K., Hogg, T. L., Leviston, Z., & Walker, I. (2021). From anger to action: Differential impacts of eco-anxiety, eco-depression, and eco-anger on climate action and wellbeing. Journal of Climate Change and Health, 1, 100003. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1341921/full