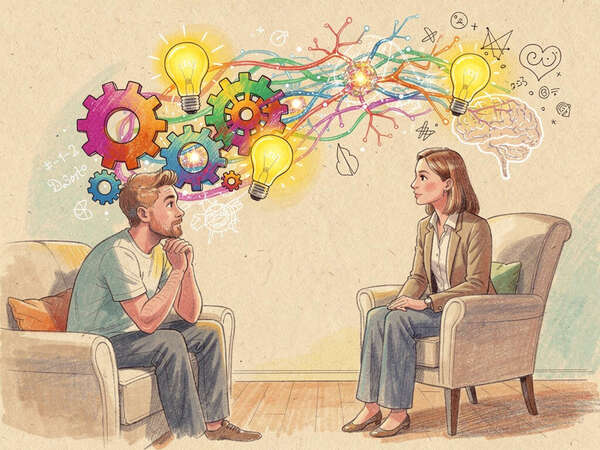Déficience intellectuelle et santé mentale : Comment reconnaître et traiter les troubles mentaux associés ?
Loin de l’image réductrice d’une « innocence éternelle » ou d’une souffrance psychique qui ne serait que le prolongement inévitable de la condition cognitive, la réalité clinique des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) est infiniment plus complexe. L’un des paradigmes les plus tenaces et les plus préjudiciables en santé mentale a longtemps été celui de l’ombre diagnostique (le diagnostic overshadowing), un biais cognitif qui conduit le clinicien à attribuer systématiquement toute manifestation comportementale ou émotionnelle à la déficience intellectuelle elle-même, occultant ainsi la possible existence d’un trouble psychiatrique comorbide. Cette posture, aussi confortable soit-elle pour un système de soins peu préparé, constitue une double peine pour des individus déjà vulnérables : elle leur nie non seulement la reconnaissance de leur souffrance psychique, mais aussi l’accès à des soins adaptés qui pourraient transformer leur qualité de vie.
Cet article se propose de déconstruire ce paradigme en explorant la relation complexe et bidirectionnelle entre la déficience intellectuelle et la santé mentale. Nous aborderons la prévalence élevée des troubles mentaux dans cette population, les défis considérables que pose leur diagnostic, les spécificités de leurs manifestations cliniques, et les stratégies d’évaluation et de traitement qui doivent impérativement être adaptées. Il ne s’agit pas simplement d’un exercice académique, mais d’un impératif éthique et clinique. Reconnaître et traiter la comorbidité psychiatrique chez la personne avec une déficience intellectuelle, c’est lui restituer sa pleine humanité, avec sa capacité à ressentir, à souffrir et, surtout, à guérir. Notre analyse s’articulera autour d’une exploration rigoureuse des données scientifiques actuelles, visant à outiller les cliniciens, les chercheurs et les aidants pour mieux voir, mieux comprendre et mieux soigner.
A. Clarifications Conceptuelles : Déficience Intellectuelle, Santé Mentale et Double Diagnostic
Avant d’explorer la complexité de leur interaction, il est fondamental de définir précisément les termes. La déficience intellectuelle et les troubles mentaux sont deux entités nosologiques distinctes, bien que leur coexistence, ou « double diagnostic », soit fréquente.
La Déficience Intellectuelle (DI) Selon les classifications internationales de référence comme le DSM-5 (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, 5ème édition) et la CIM-11 (Classification Internationale des Maladies, 11ème révision), la déficience intellectuelle est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par trois critères fondamentaux :
- Des déficits des fonctions intellectuelles : Tels que le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, l’apprentissage scolaire et l’apprentissage par l’expérience. Ces déficits doivent être confirmés à la fois par une évaluation clinique et par des tests d’intelligence standardisés et individualisés. Typiquement, un quotient intellectuel (QI) d’environ 70 ou moins (avec un intervalle de confiance) est un indicateur, mais il ne suffit pas à lui seul.
- Des déficits des fonctions adaptatives : Ils se traduisent par une incapacité à atteindre les normes développementales et socioculturelles d’autonomie personnelle et de responsabilité sociale. Ces déficits limitent le fonctionnement dans un ou plusieurs domaines de la vie quotidienne, comme la communication, la participation sociale et la vie autonome, dans des environnements variés (domicile, école, travail, communauté). Le fonctionnement adaptatif est évalué via des échelles standardisées (par exemple, l’échelle de Vineland ou l’ABAS).
- Une apparition durant la période de développement : Les déficits intellectuels et adaptatifs doivent survenir avant l’âge de 18 ans.
Il est crucial de souligner que la DI n’est pas une maladie, mais un état. Elle est hétérogène dans ses étiologies (génétiques, prénatales, périnatales, postnatales) et dans son niveau de sévérité (léger, modéré, sévère, profond), qui est désormais défini par le niveau de soutien requis pour le fonctionnement adaptatif plutôt que par le seul score de QI.
Le “Double Diagnostic” et la Vulnérabilité Accrue Le terme « double diagnostic » (ou dual diagnosis) désigne la coexistence d’une déficience intellectuelle et d’un trouble mental. Cette population présente une vulnérabilité significativement accrue au développement de troubles psychiatriques pour une multitude de raisons interdépendantes :
- Facteurs Biologiques et Neurodéveloppementaux : De nombreuses conditions génétiques et neurologiques à l’origine de la DI (ex: syndrome de l’X fragile, syndrome de Down, délétions chromosomiques) sont également associées à un profil neurobiologique qui prédispose à certains troubles mentaux. Par exemple, des altérations des systèmes de neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine) ou des anomalies structurelles et fonctionnelles du cerveau peuvent être communes aux deux conditions.
- Facteurs Psychosociaux : Les personnes avec une DI sont exposées à un nombre beaucoup plus élevé de stresseurs psychosociaux tout au long de leur vie. Cela inclut la stigmatisation, la discrimination, l’exclusion sociale, des opportunités d’éducation et d’emploi limitées, une plus grande dépendance vis-à-vis des aidants, et des réseaux sociaux souvent restreints.
- Exposition aux Traumatismes et à la Maltraitance : Les données épidémiologiques sont alarmantes. Les personnes avec une DI, en particulier les femmes, sont de 4 à 10 fois plus susceptibles d’être victimes d’abus (physiques, psychologiques, sexuels) et de négligence que la population générale. Ces expériences traumatiques sont un facteur de risque majeur pour le développement du trouble de stress post-traumatique (TSPT), des troubles anxieux, de la dépression et des troubles de la personnalité.
- Barrières de Communication : Les difficultés à exprimer verbalement ses émotions, ses pensées et sa détresse (alexithymie fonctionnelle) peuvent empêcher la personne de chercher de l’aide ou d’être comprise. Cette incapacité à communiquer la souffrance peut conduire à une “somatisation” ou à une expression de la détresse par des comportements problématiques, qui sont alors souvent mal interprétés.
- Capacités Cognitives Limitées : Des compétences de résolution de problèmes, de régulation émotionnelle et de coping plus faibles peuvent rendre la personne moins apte à gérer les stresseurs de la vie quotidienne, augmentant ainsi le risque de décompensation psychiatrique.
Comprendre cette interaction multifactorielle est la première étape pour abandonner une vision simpliste et adopter une approche bio-psycho-sociale intégrée.
B. La Prévalence des Troubles Mentaux : Une Épidémiologie Complexe
Les études épidémiologiques menées au cours des trois dernières décennies convergent vers un constat sans équivoque : la prévalence des troubles mentaux est considérablement plus élevée chez les personnes avec une DI que dans la population générale.
Ampleur du Phénomène Les estimations varient en fonction des méthodologies, des outils de diagnostic utilisés et des populations étudiées, mais la plupart des recherches rigoureuses estiment que la prévalence se situe entre 30% et 50%. Cela représente un risque de 3 à 4 fois supérieur à celui de la population générale. Pour certains troubles spécifiques, l’écart est encore plus marqué.
Spectre des Troubles Rencontrés Pratiquement tous les troubles mentaux décrits dans le DSM-5 et la CIM-11 peuvent être diagnostiqués chez les personnes avec une DI. Cependant, certains sont plus fréquemment observés :
- Troubles de l’humeur : Les troubles dépressifs et les troubles bipolaires sont particulièrement prévalents. La dépression peut être difficile à repérer en raison de ses manifestations atypiques (voir section D).
- Troubles anxieux : Le trouble d’anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques et l’anxiété sociale sont très courants. L’anxiété se manifeste souvent par des comportements d’évitement, une agitation motrice ou une augmentation des comportements répétitifs.
- Troubles liés aux traumatismes et au stress : Compte tenu de la haute prévalence de la maltraitance, le TSPT est un diagnostic fréquent mais souvent manqué.
- Troubles du spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques : Bien que moins fréquents que les troubles anxieux ou dépressifs, ils sont plus prévalents que dans la population générale. Le diagnostic différentiel avec les caractéristiques de certains syndromes génétiques ou avec un discours désorganisé lié à la DI peut être ardu.
- Trouble obsessionnel-compulsif (TOC) : Il doit être soigneusement distingué des comportements stéréotypés et répétitifs qui peuvent faire partie du phénotype comportemental de la DI. Dans le TOC, les comportements sont une réponse à une obsession anxiogène, ce qui n’est pas le cas des stéréotypies.
- Troubles du comportement et TDAH : Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) est une comorbidité neurodéveloppementale très fréquente. Les troubles du comportement (ex: trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites) peuvent être soit un trouble primaire, soit une manifestation secondaire d’un autre trouble mental sous-jacent (ex: un adolescent déprimé devenant agressif).
Défis Épidémiologiques Obtenir des chiffres de prévalence précis reste un défi. Les études souffrent souvent de biais de sélection (recrutement dans des services spécialisés où la pathologie est plus sévère) ou de l’utilisation d’outils de dépistage non validés pour cette population. De plus, le phénomène de diagnostic overshadowing conduit à une sous-estimation chronique de la véritable prévalence dans les statistiques de santé générales. Malgré ces limites, le consensus scientifique est clair : la santé mentale est un enjeu de santé publique majeur pour la population avec une déficience intellectuelle.
C. Les Défis du Diagnostic : L’Ombre du “Diagnostic Overshadowing”
Le diagnostic psychiatrique chez une personne avec une DI est l’une des tâches les plus complexes en santé mentale. Il est semé d’embûches qui exigent du clinicien une expertise spécifique, une grande humilité et une méthodologie rigoureuse.
Le “Diagnostic Overshadowing” en Pratique Ce biais cognitif est le principal obstacle à un diagnostic correct. Il se manifeste de plusieurs manières :
- Attribution causale erronée : Un retrait social est attribué à la DI plutôt qu’à une dépression ou une anxiété sociale. Une agitation est vue comme un “comportement-problème” inhérent à la DI plutôt qu’un symptôme d’anxiété, de psychose ou de manie. Des plaintes somatiques sont interprétées comme une recherche d’attention plutôt que des équivalents dépressifs.
- Normalisation pathologique : Certains comportements, qui seraient clairement identifiés comme pathologiques dans la population générale (ex: parler seul de manière intense, rituels complexes), sont banalisés et considérés comme “faisant partie” de la DI de la personne.
L’Exacerbation du “Baseline” (Baseline Exaggeration) Un concept complémentaire est celui de l’exagération de la ligne de base. De nombreuses personnes avec une DI ont des comportements idiosyncrasiques ou des traits de personnalité stables (leur “baseline”). Un trouble mental ne se manifeste pas toujours par l’apparition de nouveaux symptômes, mais souvent par une augmentation significative en fréquence, en intensité ou en durée de ces comportements préexistants. Par exemple, une personne qui a toujours eu des comportements d’autostimulation (balancements) peut se mettre à le faire de manière quasi-continue lorsqu’elle est déprimée ou anxieuse. Le défi pour le clinicien est de savoir ce qui constitue le fonctionnement de base de l’individu pour pouvoir identifier une déviation significative.
Les Barrières de Communication et de Cognition
- Difficulté du rapport verbal : La capacité à décrire des expériences subjectives internes (humeur, pensées, émotions) est souvent limitée, en particulier dans les DI modérées à profondes. Les entretiens cliniques standards, qui reposent largement sur l’introspection et le récit verbal, sont inefficaces.
- Pensée concrète : La difficulté avec la pensée abstraite rend compliquée la compréhension de concepts comme “l’humeur”, “l’anxiété” ou “l’avenir”. Les questions doivent être simplifiées, concrètes et souvent soutenues par des supports visuels.
- Limites des outils standards : La plupart des questionnaires et échelles d’auto-évaluation ne sont pas validés pour les personnes avec une DI. Le vocabulaire est trop complexe, les concepts trop abstraits et les normes non applicables. Des outils spécifiquement conçus ou adaptés (ex: PAS-ADD, DM-ID-2) sont nécessaires mais peu répandus.
Le Rôle Crucial des Informateurs Tiers En raison de ces limites, l’évaluation repose massivement sur les informations fournies par les aidants (famille, personnel éducatif ou résidentiel). Cependant, ces rapports peuvent aussi être biaisés. Les informateurs peuvent avoir leurs propres interprétations, leur propre niveau de tolérance, ou ne pas avoir observé la personne dans des contextes variés. Il est donc essentiel de croiser les sources, de poser des questions factuelles sur les comportements observables plutôt que de demander des interprétations, et d’être conscient des dynamiques relationnelles entre la personne et son entourage.
D. Manifestations Cliniques Atypiques : Déchiffrer les Signes
La sémiologie psychiatrique classique est souvent prise en défaut chez les personnes avec une DI. Les troubles mentaux s’y expriment différemment, de manière plus comportementale et somatique que verbale. Reconnaître ces équivalents sémiologiques est la clé du diagnostic.
D.1. Le Trouble Dépressif Plutôt qu’une tristesse verbalisée ou une anhédonie décrite, la dépression peut se manifester par :
- Changements comportementaux : Apparition ou augmentation de l’agressivité, de l’irritabilité, de l’automutilation ou des comportements d’opposition.
- Régression des compétences : Perte soudaine et inexpliquée de compétences acquises (propreté, autonomie à l’habillage, compétences professionnelles). C’est un signe d’alerte majeur.
- Retrait social et apathie : Refus de participer à des activités habituellement appréciées, isolement, perte d’initiative.
- Plaintes somatiques : Augmentation des maux de tête, douleurs abdominales, troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie) et changements d’appétit (perte ou gain de poids).
- Expressions non verbales : Faciès triste, pleurs plus fréquents, ralentissement psychomoteur visible.
D.2. Les Troubles Anxieux L’anxiété, cette anticipation appréhensive d’un danger futur, est difficile à verbaliser. Elle se traduit souvent par :
- Agitation et hyperactivité : Incapacité à rester en place, déambulation, tension motrice.
- Augmentation des stéréotypies : Les comportements répétitifs (balancements, “flapping”) peuvent s’intensifier de manière spectaculaire en période d’anxiété, servant de mécanisme d’autorégulation.
- Comportements d’évitement : Refus d’aller dans certains lieux, de voir certaines personnes, ou de participer à des activités nouvelles.
- Comportements de réassurance excessifs : Poser sans cesse les mêmes questions, chercher constamment la proximité d’un aidant de confiance.
- Symptômes physiologiques observables : Pâleur, sudation, tremblements, tachycardie, plaintes somatiques aiguës.
D.3. Les Troubles Psychotiques Le diagnostic de schizophrénie ou d’un autre trouble psychotique est particulièrement difficile.
- Idées délirantes : Elles sont souvent moins systématisées, plus concrètes et peuvent être liées à l’environnement immédiat de la personne (ex: conviction qu’un voisin veut lui voler ses objets). Il faut les distinguer de la pensée magique ou des fabulations.
- Hallucinations : Les hallucinations auditives sont les plus fréquentes. La personne peut sembler écouter, répondre dans le vide, ou se boucher les oreilles. Il est crucial de les différencier du “soliloque” (parler seul), qui peut être un comportement de base chez certaines personnes.
- Désorganisation du discours : Elle doit être évaluée par rapport au niveau de langage habituel de la personne. Un discours qui devient soudainement plus incohérent, avec des associations illogiques, est un signe d’alerte.
- Symptômes négatifs : L’apathie, l’alogie (pauvreté du discours) ou le retrait social peuvent être confondus avec les caractéristiques de la DI elle-même. C’est le changement par rapport à la ligne de base qui est informatif.
D.4. Le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) En plus des symptômes classiques (reviviscences, évitement, hypervigilance), le TSPT peut se manifester par :
- Mise en acte du traumatisme : Rejouer des scènes de l’abus à travers des comportements ou des jeux, parfois de manière très littérale.
- Augmentation massive des troubles du comportement : Agressivité soudaine et intense, crises de colère explosives, automutilation sévère, comme une tentative de gérer une détresse interne insupportable.
- Régression développementale : Perte de langage, énurésie/encoprésie secondaire.
- Peur et méfiance extrêmes : Envers des personnes ou des situations qui rappellent, même symboliquement, le traumatisme.
E. L’Évaluation Multimodale : Une Approche Intégrative Indispensable
Face à ces défis, une évaluation “en silo” est vouée à l’échec. Une approche multimodale, intégrative et longitudinale est non seulement recommandée, mais indispensable.
- Constitution d’une équipe pluridisciplinaire : L’évaluation idéale implique un psychiatre ou un pédopsychiatre, un psychologue, un psychomotricien, un orthophoniste et l’équipe éducative ou les aidants familiaux. Chacun apporte une perspective unique.
- Anamnèse détaillée et longitudinale : Il est fondamental de reconstituer l’histoire de vie de la personne, avec une chronologie précise des événements médicaux, développementaux, sociaux et des changements comportementaux. La question clé est toujours : “Qu’est-ce qui a changé, quand, et dans quel contexte ?”. L’établissement de la “ligne de base” comportementale et fonctionnelle est une priorité.
- Entretiens cliniques adaptés : L’entretien avec la personne doit utiliser un langage simple, des questions fermées et concrètes, des supports visuels (échelles de douleur/émotion avec des visages, photos). Le clinicien doit être attentif au non-verbal.
- Hétéro-anamnèse structurée : Interroger plusieurs informateurs de contextes différents (famille, foyer, atelier) en utilisant des questionnaires structurés qui se concentrent sur les comportements observables (fréquence, intensité, durée) plutôt que sur les interprétations.
- Observation directe : Observer la personne dans ses différents milieux de vie peut fournir des informations inestimables qui n’émergent pas en consultation.
- Utilisation d’outils d’évaluation standardisés et adaptés :
- Dépistage : Des échelles comme la Reiss Screen for Maladaptive Behavior ou l’Aberrant Behavior Checklist (ABC) peuvent aider à quantifier les comportements-problèmes, mais ne donnent pas de diagnostic.
- Diagnostic : La Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped-II (DASH-II) ou les critères du Diagnostic Manual–Intellectual Disability (DM-ID-2) sont des ressources de référence. Le DM-ID-2, en particulier, fournit des adaptations des critères du DSM-5 pour chaque trouble, avec des exemples concrets de manifestations atypiques.
- Bilan somatique complet : De nombreuses conditions médicales non diagnostiquées (douleurs chroniques, problèmes dentaires, reflux gastro-œsophagien, épilepsie, troubles thyroïdiens) peuvent provoquer des changements comportementaux mimant un trouble psychiatrique. Il est impératif de les exclure avant de poser un diagnostic psychiatrique.
F. Stratégies Thérapeutiques Adaptées : Au-delà de la Pharmacothérapie
Le traitement du double diagnostic doit être aussi intégré et personnalisé que l’évaluation. Il repose sur une combinaison d’interventions pharmacologiques, psychothérapeutiques et environnementales.
F.1. Les Interventions Psychothérapeutiques Adaptées L’idée que la psychothérapie est impossible pour les personnes avec une DI est un mythe dépassé. De nombreuses approches ont été adaptées avec succès.
- Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) Adaptée : C’est l’approche la mieux validée. Les adaptations incluent :
- Simplification du langage et des concepts.
- Utilisation massive de supports visuels : Thermomètres des émotions, scénarios sociaux, dessins, pictogrammes pour la psychoéducation.
- Focalisation sur le comportemental : L’accent est mis sur l’activation comportementale (pour la dépression) ou l’exposition progressive (pour l’anxiété) plus que sur la restructuration cognitive complexe.
- Répétition et pratique : Les sessions sont plus nombreuses et plus courtes, avec beaucoup de répétitions et de jeux de rôle.
- Implication des aidants : Les aidants sont formés pour aider à la généralisation des compétences à domicile et au quotidien.
- Thérapies Comportementales (Analyse Appliquée du Comportement - ABA) : Très utiles pour analyser la fonction des comportements-problèmes (qui peuvent être des symptômes) et mettre en place des stratégies de renforcement de comportements alternatifs plus adaptés.
- Approches Psychodynamiques Adaptées : Bien que moins étudiées, elles peuvent être utiles, en particulier pour les personnes ayant des difficultés relationnelles ou des traumatismes. La thérapie se concentre sur la relation thérapeutique comme un lieu de réparation et utilise des médiations comme le jeu, le dessin ou le modelage pour faciliter l’expression.
- Thérapie de Désensibilisation et de Retraitement par les Mouvements Oculaires (EMDR) Adaptée : Des protocoles adaptés ont montré leur efficacité pour le traitement du TSPT, en s’appuyant davantage sur le retraitement des sensations corporelles et des images que sur le récit verbal du traumatisme.
- Groupes de psychoéducation et d’entraînement aux habiletés sociales : Ils permettent d’apprendre à reconnaître et à nommer les émotions, à développer des stratégies de coping et à améliorer les interactions sociales.
F.2. La Pharmacothérapie : Prudence et Expertise Le recours aux psychotropes est souvent nécessaire, mais il doit être guidé par des principes stricts pour éviter les dérives (surprescription, “camisole chimique”).
- Le principe directeur : “Start low, go slow”. Commencer avec la plus petite dose possible et augmenter très progressivement, en surveillant attentivement l’apparition des effets thérapeutiques et des effets secondaires.
- Sensibilité accrue aux effets secondaires : Les personnes avec une DI peuvent présenter une sensibilité accrue aux effets secondaires métaboliques (prise de poids, diabète avec les antipsychotiques de seconde génération), neurologiques (symptômes extrapyramidaux) et comportementaux (désinhibition paradoxale avec les benzodiazépines).
- Diagnostic clair requis : Un traitement ne doit jamais être prescrit pour un “comportement-problème” non spécifique. Il doit viser les symptômes d’un trouble psychiatrique clairement identifié.
- Monothérapie privilégiée : Éviter la polypharmacie autant que possible.
- Monitorage régulier : Un suivi médical et biologique (poids, tension, bilan métabolique, ECG) est indispensable.
- Réévaluation périodique : L’utilité du traitement doit être réévaluée régulièrement avec une tentative de diminution ou d’arrêt si l’état de la personne est stabilisé.
F.3. Interventions Systémiques et Environnementales Souvent, l’intervention la plus efficace ne vise pas uniquement la personne, mais son environnement.
- Formation et soutien des aidants : Former la famille et les équipes professionnelles à reconnaître les signes de détresse psychique, à comprendre la fonction des comportements et à mettre en œuvre les stratégies thérapeutiques au quotidien. Le soutien psychologique des aidants est également crucial pour prévenir l’épuisement.
- Aménagement de l’environnement : Réduire les stresseurs environnementaux (bruit, surstimulation), créer des routines prévisibles et sécurisantes, offrir des opportunités de choix et de contrôle.
- Coordination des soins : Assurer une communication fluide et une coordination parfaite entre les services de santé mentale, les services médico-sociaux, les médecins généralistes et la famille. Le modèle des soins intégrés est le plus pertinent.
G. Les Enjeux Éthiques et Systémiques
Au-delà de la clinique, le double diagnostic soulève des questions éthiques et organisationnelles fondamentales.
- Le Droit à la Santé Mentale : Les personnes avec une DI ont le même droit à des soins de santé mentale de qualité que n’importe quel autre citoyen. Ce droit est encore loin d’être pleinement respecté.
- Consentement et Capacité : La question du consentement éclairé au traitement est complexe. Elle nécessite une évaluation de la capacité de la personne à comprendre les informations pertinentes. Lorsque la capacité est altérée, les décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt de la personne, en l’impliquant au maximum de ses capacités, et en suivant les cadres légaux en vigueur (mesures de protection juridique).
- Stigmatisation et “Sanisme” : La double stigmatisation (liée à la DI et au trouble mental) reste un obstacle majeur. Au sein même du système de santé, le “sanisme” (discrimination basée sur la santé mentale) peut conduire au refus de prise en charge de ces patients jugés “trop complexes”.
- Le Fossé des Compétences : Il existe un manque criant de professionnels de la santé mentale formés aux spécificités du double diagnostic. De même, les professionnels du secteur du handicap sont souvent peu formés à la santé mentale.
- La Fragmentation des Services : Les services de santé mentale et les services pour personnes handicapées fonctionnent souvent en silos, se renvoyant la responsabilité des patients “à l’interface”. La création de services intégrés, de consultations spécialisées et d’équipes mobiles est une nécessité pour combler ce fossé.
Conclusion
La comorbidité entre la déficience intellectuelle et les troubles mentaux n’est ni une fatalité, ni une simple “difficulté comportementale”. Elle est une réalité clinique complexe, sous-tendue par une interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. L’ère du diagnostic overshadowing doit prendre fin, pour être remplacée par une pratique clinique éclairée, rigoureuse et profondément humaniste.
Cela exige un changement de paradigme à tous les niveaux. Pour les cliniciens, il s’agit d’acquérir des compétences spécifiques : savoir déchiffrer une sémiologie atypique, maîtriser les outils d’évaluation adaptés, et manier avec prudence et expertise les thérapies adaptées. Pour les chercheurs, le défi est de continuer à valider des outils et des interventions, tout en explorant plus finement les mécanismes neurobiologiques communs. Pour les institutions et les décideurs politiques, l’enjeu est de démanteler les barrières systémiques en favorisant la formation des professionnels et en construisant des modèles de soins véritablement intégrés qui ne laissent personne au bord du chemin.
En définitive, offrir des soins de santé mentale de qualité aux personnes présentant une déficience intellectuelle est plus qu’un devoir technique ; c’est la reconnaissance de leur droit fondamental à être soulagées de leur souffrance et à atteindre le meilleur bien-être possible. C’est leur rendre justice.
Les sources :
Charlot, L., & Beasley, J. B. (Eds.). (2016). DM-ID-2: Diagnostic Manual—Intellectual Disability, 2nd Edition: A Textbook of Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual Disability. NADD Press. https://thenadd.org/products/dm-id-2-diagnostic-manual-intellectual-disability-2nd-edition/
Cooper, S.-A., McLean, G., Guthrie, B., McConnachie, A., Mercer, S., Smith, D. J., & Morrison, J. (2015). Primary-care-based mental health morbidity in adults with intellectual disabilities: A cross-sectional study. The Lancet Psychiatry, 2(7), 615–622. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00192-3/fulltext
Einfeld, S. L., Ellis, L. A., & Emerson, E. (2011). Comorbidity of intellectual disability and mental disorder in children and adolescents: A systematic review. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 36(2), 137–143. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13668250.2011.576495
Fletcher, R. J., Barnhill, J., & Cooper, S.-A. (Eds.). (2016). Diagnostic Manual—Intellectual Disability (DM-ID-2): A Clinical Guide for Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual Disability. NADD Press. https://thenadd.org/products/dm-id-2/
Lunsky, Y., Weiss, J. A., & Slusarczyk, M. (2018). A systematic review of randomized controlled trials of cognitive-behavioural therapy for adults with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(1), 1-15. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12513
Martorell, A., Tsakanikos, E., & Tsetsos, F. (2018). Psychiatric comorbidity in intellectual disabilities: Aetiology, diagnosis, and treatment. Current Opinion in Psychiatry, 31(2), 97–103. https://journals.lww.com/co-psychiatry/Abstract/2018/03000/Psychiatric_comorbidity_in_intellectual.3.aspx
Salvador-Carulla, L., Reed, G. M., Vaez-Azizi, L. M., Cooper, S.-A., Martinez-Leal, R., Bertelli, M., Adnams, C., Cooray, S., Deb, S., Akoury-Dirani, L., Girimaji, S. C., Katz, G., Kwok, H., Luckasson, R., Simeonsson, R., Walsh, C., Munir, K., & Saxena, S. (2011). Intellectual developmental disorders: Towards a new name, definition and framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD-11. World Psychiatry, 10(3), 175–180. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188762/
Totsika, V., Hastings, R. P., Emerson, E., Lancaster, G. A., & Berridge, D. M. (2011). A population-based investigation of behavioural and emotional problems and maternal mental health: Associations with autism spectrum disorder and intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 90–99. https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7610.2010.02295.x
Werner, S., & Stawski, M. (2012). The role of diagnostic overshadowing in the context of intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25(3), 279-284. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-3148.2012.00693.x