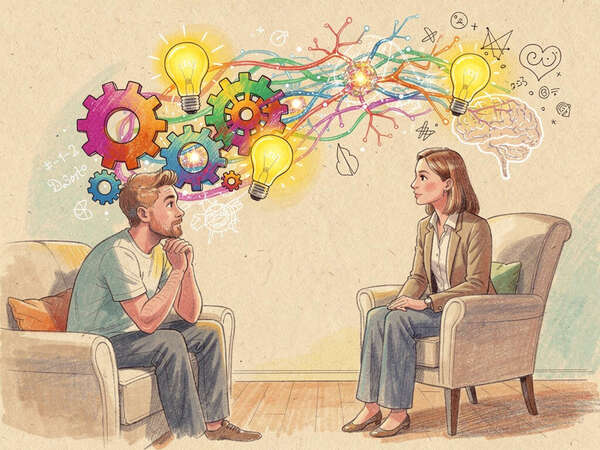Quel est l'apport et l'impact des politiques publiques sur la qualité de vie des personnes avec une déficience intellectuelle ?
La question de la citoyenneté des personnes présentant une déficience intellectuelle ne se résume pas à une simple affirmation de droits universels. Elle interroge au plus profond les fondements de notre pacte social : comment une société conçoit-elle la place de ses membres les plus vulnérables, non pas en termes de charge ou de soin, mais en termes de contribution, de désir et d’existence propre ? La France, par son histoire et son architecture administrative complexe, offre un terrain d’analyse particulièrement riche. Elle a superposé des strates de politiques publiques, oscillant entre un modèle médical et charitable hérité du passé et une ambition plus récente, d’inspiration internationale, centrée sur les droits et l’autodétermination. Cet article se propose de disséquer cette architecture. Il ne s’agira pas de dresser un catalogue de dispositifs, mais d’en sonder la cohérence, d’en évaluer l’efficacité psycho-sociale et, in fine, de questionner si les outils mis en place permettent véritablement l’émergence d’une qualité de vie choisie et non subie. En confrontant le modèle français à d’autres approches nationales, nous tenterons de mettre en lumière les impensés, les blocages systémiques et les leviers potentiels qui pourraient transformer une égalité de droit, souvent formelle, en une équité de fait, tangible et vécue au quotidien.
A. Le Cadre Conceptuel : De la Prise en Charge à l’Autodétermination
Pour analyser l’impact des politiques publiques, il est impératif de définir le prisme théorique à travers lequel nous évaluons la “qualité de vie”. Ce concept, loin d’être univoque, a connu une évolution épistémologique majeure au cours des dernières décennies, particulièrement dans le champ du handicap intellectuel.
Historiquement, l’approche dominante était celle du modèle médical, puis caritatif. Dans ce paradigme, la déficience intellectuelle est perçue comme un trouble intrinsèque à l’individu, une déviance par rapport à une norme biologique et fonctionnelle. La réponse sociétale est alors logiquement orientée vers le soin, la réadaptation et la protection. La “prise en charge” institutionnelle devient la solution par défaut, visant à pallier les incapacités de la personne, souvent au détriment de son autonomie. La qualité de vie, dans cette perspective, se mesure principalement par des indicateurs objectifs de santé, de sécurité physique et de satisfaction des besoins primaires. Les politiques publiques découlant de ce modèle ont massivement investi dans la création de structures spécialisées (Instituts Médico-Éducatifs, Foyers d’Accueil Médicalisés), créant un secteur médico-social puissant mais ségrégatif.
À partir des années 1970, sous l’influence des mouvements de défense des droits civiques et des travaux de chercheurs en sciences sociales, émerge le modèle social du handicap. Ce dernier opère un renversement conceptuel fondamental : le handicap n’est plus une caractéristique de l’individu, mais le résultat de l’interaction entre des incapacités personnelles et un environnement social, économique et culturel créateur de barrières. Le problème n’est plus la personne, mais la société qui échoue à s’adapter à la diversité de ses membres. Cette vision a nourri l’élaboration de politiques axées sur l’accessibilité, la non-discrimination et l’inclusion. La qualité de vie se définit alors par le degré de participation sociale, l’accès aux mêmes opportunités que les autres citoyens (éducation, emploi, logement, loisirs) et l’exercice de la citoyenneté.
Plus récemment, une troisième vague conceptuelle est venue enrichir cette approche : le paradigme de l’autodétermination et des capabilités. Théorisé par des chercheurs comme Michael Wehmeyer dans le champ du handicap et inspiré par les travaux d’Amartya Sen, ce modèle va au-delà de la simple participation. L’autodétermination est définie comme la capacité d’un individu à agir comme l’agent causal principal de sa propre vie, à faire des choix et à prendre des décisions concernant sa qualité de vie, libre de toute influence externe ou contrainte indue. Elle se compose de plusieurs dimensions : le choix, la prise de décision, la résolution de problèmes, la fixation d’objectifs, l’auto-observation et l’auto-plaidoyer (self-advocacy).
La qualité de vie, dans ce cadre, n’est plus seulement la somme des conditions de vie objectives ou du niveau de participation, mais elle intègre une dimension subjective fondamentale : le sentiment de contrôle sur sa propre existence et la possibilité de poursuivre les objectifs de vie que l’on se donne. L’évaluation de l’efficacité des politiques publiques ne peut donc plus se contenter de mesurer le nombre de places en institution ou le montant des allocations. Elle doit interroger : les dispositifs en place favorisent-ils ou entravent-ils le développement de l’autodétermination ? Les personnes ont-elles un contrôle réel sur les aides qui leur sont allouées ? Le système leur permet-il d’expérimenter, de faire des erreurs et d’apprendre, comme tout autre citoyen ? C’est à l’aune de ce paradigme exigeant que nous analyserons le système français.
B. Le Panorama des Politiques Publiques en France : Intentions Ambitieuses et Implémentation Complexe
La politique française du handicap s’est construite par sédimentation législative, avec une accélération notable depuis le début du XXIe siècle. La loi fondatrice du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées” constitue la pierre angulaire du système actuel. Elle incarne, dans son intention, le passage du modèle médical au modèle social.
Les Piliers de la Loi de 2005 et leurs Objectifs
La loi de 2005 a introduit plusieurs innovations structurelles majeures visant à placer la personne au centre du dispositif :
- Le Droit à la Compensation : Le principe fondamental est que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Ce droit est censé être personnalisé et couvrir tous les aspects de la vie (aides humaines, techniques, aménagement du logement, etc.).
- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : C’est l’outil financier de ce droit. Contrairement à l’ancienne Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), la PCH est en théorie déconnectée des revenus et vise à couvrir les surcoûts liés au handicap, sur la base d’un plan personnalisé d’évaluation.
- Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : Conçues comme un “guichet unique”, les MDPH ont pour mission d’accueillir, d’informer, d’accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille. Elles sont le lieu unique où sont évalués les besoins et où la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) prend les décisions d’attribution des droits et prestations.
- Le Projet de Vie : La loi stipule que l’évaluation des besoins doit se fonder sur le “projet de vie” de la personne. C’est une avancée conceptuelle majeure, supposant que les aides ne sont pas prescrites sur la base d’un diagnostic, mais allouées en fonction des aspirations et des choix de l’individu.
- L’Inclusion Scolaire et Professionnelle : La loi affirme le droit de chaque enfant handicapé à être scolarisé dans l’établissement de son quartier (son “école de référence”) et promeut l’emploi en milieu ordinaire comme la priorité.
2. La Disjonction entre l’Intention et la Réalité Opérationnelle
Près de deux décennies après sa promulgation, le bilan de la loi de 2005 est contrasté, révélant une tension permanente entre ses ambitions inclusives et la persistance de logiques gestionnaires et institutionnelles.
- La Complexité Administrative et la Logique de Guichet : Les MDPH, pensées comme des facilitateurs, sont souvent perçues comme des forteresses administratives. Les délais de traitement des dossiers sont chroniquement longs, plongeant les familles dans l’incertitude. L’évaluation des besoins, qui devrait être un dialogue centré sur le projet de vie, se transforme souvent en une procédure standardisée, basée sur des grilles et des critères quantitatifs (le guide-barème GEVA). Le “projet de vie” est fréquemment réduit à un formulaire à remplir, sans véritable accompagnement pour aider la personne à l’élaborer et à l’exprimer, surtout en cas de déficience intellectuelle sévère.
- La Compensation : Entre Réparation et Capacitation Manquée : La PCH, bien qu’utile, souffre de plusieurs écueils. Son calcul est complexe et souvent perçu comme opaque. Surtout, elle reste prisonnière d’une logique de “réparation” des incapacités plutôt que de “capacitation” à l’autodétermination. Par exemple, les aides humaines sont souvent fléchées vers des actes essentiels (toilette, repas), avec des volumes horaires qui laissent peu de place à l’accompagnement à la vie sociale, aux loisirs, à la citoyenneté. Le financement de l’aide par les pairs ou de l’assistance à l’autodétermination reste marginal. La personne est plus souvent “objet” d’une aide qu’actrice de son propre plan de soutien.
- La Persistance du Modèle Institutionnel : Malgré le discours sur “le virage inclusif”, la France reste l’un des pays européens où le taux de placement en institution est le plus élevé. Le système est structuré par une “offre” médico-sociale (les places disponibles en IME, FAM, MAS) qui conditionne fortement les “orientations” prononcées par les CDAPH. Plutôt que de construire une solution sur mesure à partir des besoins de la personne, le système tend à orienter la personne vers la “case” existante la plus proche. Cette “culture de l’institution” est renforcée par les mécanismes de financement, qui sécurisent les structures existantes au détriment du développement de solutions alternatives et innovantes en milieu ordinaire (habitat inclusif, services d’accompagnement à domicile renforcés, etc.).
- L’Inclusion “en Pointillés” : L’inclusion scolaire progresse quantitativement, mais qualitativement, elle reste un défi majeur. De nombreux élèves sont inclus de manière partielle, sans les moyens humains (AESH) et pédagogiques suffisants pour une réelle participation. En matière d’emploi, le taux de chômage des personnes handicapées reste double de celui de la population générale, et l’emploi des personnes avec une déficience intellectuelle en milieu ordinaire est anecdotique. Le secteur protégé (ESAT), bien qu’offrant une activité, ne relève pas du Code du travail, privant les travailleurs de droits fondamentaux (salaire minimum, droit de grève) et constituant rarement un tremplin vers le milieu ordinaire.
Ainsi, le système français se caractérise par une architecture juridique moderne et ambitieuse, mais dont l’application est freinée par une inertie administrative, une culture institutionnelle profondément ancrée et un financement qui peine à se détourner des solutions ségrégatives pour investir massivement dans l’accompagnement personnalisé en milieu ordinaire.
C. L’Évaluation de l’Efficacité : Mesures Objectives et Expérience Vécue
Évaluer l’efficacité de ces politiques requiert une double approche : l’analyse des indicateurs quantitatifs et la prise en compte de la dimension qualitative, c’est-à-dire l’expérience vécue par les personnes elles-mêmes et leurs familles. C’est dans la confrontation de ces deux niveaux de réalité que l’impact sur la qualité de vie se révèle.
1. Les Indicateurs Quantitatifs : Des Progrès Limités et des Inégalités Patentes
- Logement et Mode de Vie : Les données de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques) et de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) sont éloquentes. Une part très significative des adultes avec une déficience intellectuelle vit soit au domicile parental (souvent jusqu’à un âge avancé, créant une angoisse majeure sur “l’après-nous” pour les parents vieillissants), soit en établissement médico-social. Le développement de l’habitat “inclusif” ou “accompagné”, bien que promu par les récents plans gouvernementaux, reste à une échelle expérimentale et ne constitue pas une alternative systémique. L’accès au logement autonome est quasi impossible sans un soutien familial ou un accompagnement professionnel intense, rarement financé à la hauteur des besoins.
- Emploi : Le taux d’emploi en milieu ordinaire des personnes reconnues handicapées stagne autour de 3,5% des effectifs dans les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi. Pour les personnes avec une déficience intellectuelle, ce chiffre est infime. Environ 120 000 personnes travaillent en ESAT, dans un statut hybride qui les maintient à la marge du marché du travail. Le passage de l’ESAT vers le milieu ordinaire, objectif affiché, est extrêmement rare (environ 1% par an). La politique d’emploi reste donc duale : un milieu ordinaire peu accueillant et un secteur protégé qui, s’il offre une occupation et un cadre, ne favorise ni l’émancipation économique ni l’inclusion sociale.
- Scolarisation : Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a quadruplé en 15 ans, ce qui est un succès quantitatif indéniable. Cependant, la Cour des Comptes, dans plusieurs rapports, a souligné les limites de cette inclusion : manque de formation des enseignants, précarité et professionnalisation insuffisante des Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH), et recours massif aux notifications pour des heures d’accompagnement qui ne sont pas toujours effectives sur le terrain. L’inclusion se résume parfois à une simple présence physique dans la classe, sans participation pédagogique réelle.
2. La Dimension Qualitative : Le Poids du Système sur la Qualité de Vie
Au-delà des chiffres, les recherches qualitatives (entretiens, études ethnographiques) révèlent l’impact psychologique et social du système sur les personnes et leurs familles.
- La Charge Administrative et l’Épuisement Parental : Les familles décrivent un parcours du combattant permanent. La constitution des dossiers MDPH, leur renouvellement périodique, les recours en cas de refus, la recherche d’une place en établissement ou d’un professionnel libéral… Tout cela constitue une charge mentale et administrative considérable qui pèse principalement sur les mères et entrave leur propre vie professionnelle et sociale. Cet “emploi à temps plein” de gestionnaire du handicap de son enfant ou de son proche est une source majeure de stress et d’épuisement.
- Le Sentiment de Dépossession et le Manque de Choix Réel : Le concept de “projet de vie” se heurte à la réalité d’une offre limitée. Les familles et les personnes se voient souvent proposer un choix binaire : l’établissement (s’il y a une place) ou le maintien à domicile sans solution adaptée. Ce “non-choix” est une source de frustration et de résignation. Le sentiment dominant est celui de subir un système au lieu de le piloter. L’autodétermination est entravée à la racine lorsque les options réelles sont quasi inexistantes.
- L’Insécurité des Parcours de Vie : Le système français fonctionne par “ruptures” successives : la fin de la scolarisation à 20 ans (l’amendement Creton permet un maintien en IME, mais c’est une solution par défaut), le passage à l’âge adulte, le vieillissement des parents… Chaque transition est une source d’angoisse car les “passerelles” entre les dispositifs (scolaire, emploi, logement, retraite) sont mal organisées. Cette insécurité permanente affecte profondément la qualité de vie, empêchant toute projection sereine dans l’avenir.
- La Stigmatisation et l’Auto-dévalorisation : En maintenant une forte dichotomie entre le “milieu ordinaire” et le “secteur spécialisé”, le système français renforce involontairement la stigmatisation. Être orienté en ESAT ou en foyer de vie, c’est être labellisé comme “incapable” de vivre ou de travailler avec les autres. Cette ségrégation institutionnelle a des effets psychologiques délétères, limitant les aspirations et renforçant un sentiment d’identité négative. Les politiques, malgré leur intention inclusive, perpétuent une représentation de la personne avec déficience intellectuelle comme un individu “à part”.
En somme, si les politiques françaises ont permis des avancées en termes de droits formels et d’accès à certaines prestations, leur efficacité sur la qualité de vie est fortement obérée par leur complexité, leur inertie institutionnelle et leur incapacité à traduire le principe d’autodétermination en pratiques concrètes et généralisées.
D. Le Miroir International : Perspectives Comparées et Leçons à Tirer
La confrontation du modèle français avec d’autres approches nationales est un exercice heuristique puissant. Il permet de dénaturaliser des pratiques qui semblent aller de soi et d’ouvrir le champ des possibles. Nous analyserons ici trois modèles contrastés : suédois, italien et canadien (québécois).
1. La Suède : Le Droit à l’Assistance Personnelle comme Pilier de l’Autonomie
La Suède est souvent citée comme un modèle en matière de politique du handicap, notamment depuis la loi LSS (Loi concernant le soutien et le service à certaines personnes handicapées) de 1994.
- Le Principe Fondamental : La philosophie suédoise repose sur la normalisation et la désinstitutionnalisation radicale. L’objectif est de garantir aux personnes handicapées les mêmes conditions de vie (“good living conditions”) que les autres citoyens. L’innovation majeure est le droit à l’assistance personnelle (personlig assistans). Il ne s’agit pas d’une aide pour des actes essentiels, mais d’un budget conséquent permettant à la personne d’embaucher ses propres assistants pour l’aider dans tous les aspects de sa vie quotidienne, y compris la participation sociale, les loisirs, la culture, la parentalité.
- Mise en Œuvre et Impact : La personne est l’employeur (directement ou via une coopérative). Elle choisit qui l’aide, quand et pour quoi faire. Ce dispositif transfère le pouvoir de l’institution ou de l’administration vers l’individu. L’impact sur la qualité de vie et l’autodétermination est considérable. Des milliers de personnes, y compris avec des déficiences intellectuelles importantes, ont pu quitter les institutions pour vivre dans leur propre logement. Ce modèle favorise un contrôle direct sur sa vie, même si la gestion de l’assistance peut être complexe.
- Comparaison avec la France : La PCH française, en comparaison, apparaît beaucoup plus restrictive. Ses montants sont souvent inférieurs, les plans d’aide sont décidés par une commission et non par la personne, et l’éligibilité est plus stricte. Le modèle suédois montre qu’une politique ambitieuse de financement de l’aide humaine directe est le levier le plus puissant pour la désinstitutionnalisation et l’autonomie résidentielle. Il pose la question fondamentale : finance-t-on des murs (institutions) ou des personnes (assistance personnelle) ?
2. L’Italie : Le Pari Radical de l’Inclusion Scolaire Totale
L’Italie a fait un choix radical et précurseur dès les années 1970 avec la “Loi Basaglia” qui a fermé les hôpitaux psychiatriques, suivie de lois qui ont quasiment aboli les écoles spécialisées.
- Le Principe Fondamental : Le principe est celui de l’intégration totale (inserimento). La loi-cadre 104 de 1992 stipule que tous les élèves, quel que soit leur handicap, doivent être scolarisés dans les classes ordinaires de leur école de quartier. Il n’existe quasiment plus de structures ségrégatives pour les enfants d’âge scolaire.
- Mise en Œuvre et Impact : Ce choix a obligé le système éducatif ordinaire à s’adapter. Chaque élève avec un handicap bénéficie d’un plan éducatif individualisé et du soutien d’un enseignant spécialisé (insegnante di sostegno) qui co-intervient dans la classe. Ce modèle a favorisé une culture de l’accueil de la différence au sein de l’école et de la société. Les enfants grandissent ensemble, ce qui réduit la peur et la stigmatisation.
- Comparaison avec la France : Le modèle français, avec sa dualité entre milieu ordinaire et établissements spécialisés (IME), apparaît beaucoup plus timoré. En France, l’inclusion est souvent pensée comme un effort que doit faire l’élève handicapé pour s’adapter à l’école, avec l’aide d’un AESH. En Italie, c’est l’école qui est légalement tenue de s’adapter à l’élève. Le modèle italien, bien que non exempt de difficultés (formation des enseignants, disparités régionales), démontre qu’une inclusion scolaire quasi-complète est possible et qu’elle transforme en profondeur les représentations sociales.
3. Le Canada (Québec) : L’Approche Communautaire et la Planification Centrée sur la Personne
Le Québec propose un modèle intéressant, moins étatiste que le modèle suédois, mais très axé sur la participation sociale et le rôle des communautés locales.
- Le Principe Fondamental : La politique québécoise “À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité” (2009) vise à accroître la “participation sociale” des personnes. L’accent est mis sur une approche écosystémique : l’individu est au centre d’un réseau de soutien qui inclut la famille, les services publics, mais aussi et surtout les organismes communautaires, les voisins, les employeurs.
- Mise en Œuvre et Impact : La planification des services est fortement individualisée, utilisant des approches comme la “Planification d’un Avenir Désiré” (PAD) ou le “McGill Action Planning System” (MAPS). Ces méthodes visent à faire émerger les rêves et les aspirations de la personne en mobilisant son cercle de soutien. Le financement est souvent orienté vers des solutions souples et locales, portées par des organismes communautaires, plutôt que vers de grandes institutions. Ce modèle favorise l’ancrage local et la construction d’un capital social pour la personne.
- Comparaison avec la France : Le “projet de vie” français semble être une version administrative et désincarnée de ces approches de planification centrée sur la personne. Au Québec, le processus est dynamique, collaboratif et vise à mobiliser des ressources informelles et communautaires. En France, il reste largement un dialogue entre la famille et l’administration, centré sur l’accès à des prestations et services formels. Le modèle québécois invite à penser l’inclusion non seulement comme un droit à des services, mais comme la construction active d’une place dans sa communauté.
Ces comparaisons montrent que la France, malgré un cadre légal solide, souffre d’un déficit de radicalité dans ses choix politiques. Elle reste à mi-chemin entre le maintien d’un puissant secteur institutionnel et la promotion de l’inclusion, créant un système hybride, coûteux et souvent inefficace à promouvoir une véritable autodétermination.
E. Les Leviers d’Amélioration et les Perspectives d’Avenir
Sur la base de cette analyse, plusieurs axes stratégiques se dessinent pour faire évoluer le système français et améliorer significativement la qualité de vie des personnes avec une déficience intellectuelle. Il ne s’agit pas de “réformer” à la marge, mais d’opérer un véritable changement de paradigme.
1. Opérer un Rééquilibrage Financier de l’Institution vers la Personne
Le principal verrou est financier. Tant que la majorité des financements publics sera fléchée vers le financement des “places” en établissement, la désinstitutionnalisation restera un vœu pieux. Il est impératif d’engager un plan pluriannuel de réorientation des crédits :
- Transformer la PCH en un véritable budget personnel sur le modèle de l’assistance suédoise, permettant de financer un large éventail de soutiens choisis par la personne (aide humaine, services, loisirs, soutien à la parentalité…).
- Conditionner le financement des établissements médico-sociaux à leur transformation en plateformes de services et de ressources pour le milieu ordinaire, plutôt qu’en lieux de vie fermés. Leurs compétences pourraient être redéployées pour soutenir l’inclusion scolaire, professionnelle et l’habitat inclusif.
2. Investir massivement dans l’Autodétermination et la Décision Soutenue
Le respect de la volonté et des préférences de la personne doit devenir le principe cardinal.
- Généraliser les pratiques de planification centrée sur la personne (sur le modèle québécois) pour l’élaboration du projet de vie, avec des facilitateurs formés et indépendants des organismes gestionnaires.
- Développer et financer l’aide à la décision soutenue, conformément à l’article 12 de la Convention de l’ONU. Cela implique de former des “soutiens” qui aident la personne à comprendre les enjeux, à peser les options et à exprimer sa volonté, comme alternative aux mesures de protection juridique (curatelle, tutelle) qui privent la personne de sa capacité juridique.
- Soutenir financièrement et structurellement les associations d’auto-représentation (self-advocacy), comme “Nous Aussi” en France. Leur expertise d’usage est indispensable pour co-construire et évaluer les politiques publiques.
Bâtir une Véritable Société Inclusive
L’inclusion ne peut reposer uniquement sur des dispositifs spécialisés. Elle nécessite une transformation de l’environnement et des mentalités.
- Une école véritablement inclusive : Cela passe par la formation initiale et continue de tous les enseignants à la pédagogie universelle et à la gestion de l’hétérogénéité, et non par la simple juxtaposition d’un AESH précaire. Le modèle italien de l’enseignant de soutien co-responsable de la classe est une piste à explorer.
- Un emploi accompagné et diversifié : Au-delà de l’ESAT, il faut développer massivement le “job coaching” et l’emploi accompagné en milieu ordinaire. Cela suppose d’inciter les entreprises non seulement à recruter, mais surtout à adapter les postes et à manager la diversité.
- Désigner un “référent de parcours” unique pour chaque personne, un professionnel qui l’accompagne dans la durée, à travers les différentes étapes de la vie, pour assurer la cohérence et la continuité de son accompagnement, et éviter les ruptures et la charge administrative pour les familles.
Conclusion
L’analyse des politiques publiques françaises destinées aux personnes avec une déficience intellectuelle révèle un paradoxe saisissant. La France dispose d’un des corpus législatifs les plus avancés au monde, affirmant le droit à la compensation, à la participation et à la citoyenneté. Pourtant, l’impact de ces politiques sur la qualité de vie perçue et sur l’autodétermination réelle des individus reste profondément décevant. Le système, par sa complexité bureaucratique, son attachement historique au modèle institutionnel et son approche souvent paternaliste de la compensation, érige autant de barrières qu’il n’offre de soutiens. Il peine à traduire en actes le passage conceptuel d’une logique de prise en charge à une culture du pouvoir d’agir.
La comparaison internationale est éclairante : elle montre que des choix plus radicaux sont possibles et efficaces. Que ce soit le droit inconditionnel à l’assistance personnelle en Suède, le pari de l’école pour tous en Italie ou l’ancrage communautaire au Québec, ces modèles ont en commun d’avoir déplacé le curseur du pouvoir de l’administration et des institutions vers la personne et son entourage choisi. Le défi pour la France n’est donc plus tant de proclamer de nouveaux droits que de se donner les moyens culturels, organisationnels et financiers de les rendre effectifs. La véritable citoyenneté, pour les personnes avec une déficience intellectuelle comme pour tous, ne se décrète pas ; elle se construit dans la possibilité concrète de choisir sa vie, de participer à la société et d’y être reconnu comme un pair, avec ses spécificités, ses désirs et son irréductible singularité. Le chemin est encore long pour que le “projet de vie” devienne autre chose qu’un document administratif : une réalité vécue.
Les sources :
Berthoud, A. (2020). Le parcours du combattant des parents d’enfants en situation de handicap : Entre charge mentale et quête de reconnaissance. Presses de l’EHESP. https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-parcours-du-combattant-des-parents-denfants-en-situation-de-handicap/
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). (2022). Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2022. CNSA. https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres-cles_2022_web-accessible.pdf
Cour des Comptes. (2021). La scolarisation des élèves en situation de handicap : Mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Rapport public thématique. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). (2021). Les personnes en situation de handicap et leur logement en 2018. Études et Résultats, N°1206. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/les-personnes-en-situation-de-handicap-et
Ebersold, S. (2017). L’école inclusive : une nouvelle donne pour l’éducation ?. Revue française de pédagogie, 199, 5-9. https://journals.openedition.org/rfp/5341
Fardeau, O. (2019). L’autodétermination des personnes en situation de handicap : un processus à soutenir. Empan, 114(2), 55-61. https://www.cairn.info/revue-empan-2019-2-page-55.htm
Gardou, C. (2016). La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule. Éditions Érès. https://www.editions-eres.com/ouvrage/3929/la-societe-inclusive-parlons-en
Ravaud, J.-F., & Stiker, H.-J. (2018). Inclusion/exclusion: A new old couple of concepts. Alter, 12(2), 65-76. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187506721830026X
Saloviita, T. (2020). A comparison of the implementation of inclusive education in the Nordic countries and Italy. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 17(4), 304-312. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jppi.12353
Tøssebro, J., & Lundeby, H. (2019). Deinstitutionalization for People with Intellectual Disabilities in Scandinavia: The Impact of Personal Assistance and Other Community Services. Dans The Oxford Handbook of Disability History. Oxford University Press. https://academic.oup.com/edited-volume/28135/chapter-abstract/212260682
Tricart, J.-P. (2019). La loi de 2005 : une révolution inachevée. Analyse critique des politiques du handicap. Presses Universitaires de Grenoble. https://www.pug.fr/produit/1647/9782706142784/la-loi-de-2005-une-revolution-inachevee
Wehmeyer, M. L., Shogren, K. A., Little, T. D., & Lopez, S. J. (Eds.). (2017). Development of self-determination through the life-course. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-024-1002-3