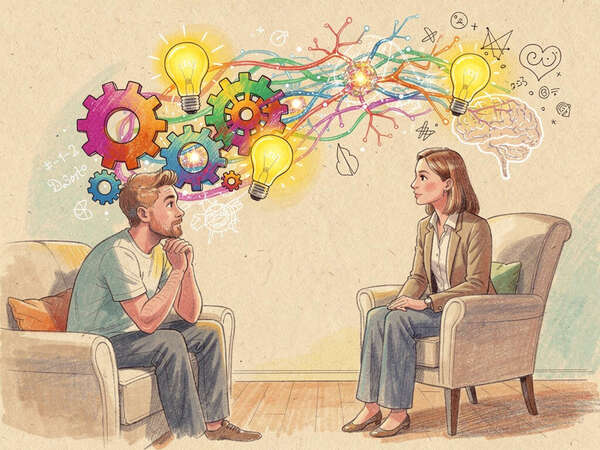Éducation sexuelle et déficience intellectuelle : Quelles sont les approches adaptées et respectueuses ?
Le cinéma a ce pouvoir singulier de cristalliser en une fiction de deux heures des dilemmes sociétaux complexes, souvent tus ou relégués aux marges du débat public. Le film Mon Inséparable d’Anne-Sophie Bailly (2024) en est une illustration saisissante. Il nous confronte, à travers le parcours de Jo, un jeune homme porteur d’une déficience intellectuelle, et de sa mère, à une question aussi fondamentale qu’inconfortable : le droit à l’amour et à la sexualité pour une personne considérée comme “vulnérable”. Le récit ne se contente pas de dépeindre une quête d’autonomie affective ; il expose crûment les angoisses parentales, les frilosités institutionnelles et les préjugés d’une société qui oscille entre une surprotection infantilisante et la négation pure et simple du désir de l’autre.
Au-delà de l’émotion suscitée par une telle œuvre, il incombe à la recherche scientifique et à la pratique clinique de déconstruire cette problématique pour la hisser au niveau qui doit être le sien : celui d’un enjeu de santé publique, de droits humains et de dignité. Cet article se propose de dépasser la seule narration cinématographique pour analyser, sur la base des connaissances actuelles en psychologie, en sciences de l’éducation et en éthique, les fondements, les obstacles et les modalités d’une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVRAS) qui soit à la fois adaptée et respectueuse des personnes présentant une déficience intellectuelle. Il s’agira de démontrer que cette éducation, loin d’être une option périlleuse, constitue une nécessité impérieuse pour l’autodétermination, le bien-être et la protection de ces individus. Nous explorerons ainsi les paradigmes qui sous-tendent notre approche, les barrières systémiques à lever, les stratégies pédagogiques concrètes à déployer et le rôle essentiel de l’écosystème entourant la personne. Car si le film de Bailly pose les bonnes questions, c’est à nous, chercheurs et praticiens, de commencer à y apporter des réponses structurées, éclairées et profondément humaines.
A. Le Droit à la Vie Affective et Sexuelle : Un Paradigme en Mutation
La question de la sexualité des personnes avec une déficience intellectuelle (DI) a longtemps été piégée dans un étau conceptuel. Historiquement, la pensée dominante reposait sur un modèle que l’on pourrait qualifier d’« asexué » ou de « protectionniste ». Dans cette perspective, la personne avec DI était perçue comme un “éternel enfant”, dépourvu de désirs sexuels adultes ou, à l’inverse, comme un être potentiellement dangereux, dont la sexualité devait être contrôlée, voire réprimée, pour protéger la société et la personne elle-même. Cette vision a justifié des pratiques allant de la ségrégation institutionnelle à la stérilisation forcée, pratiques aujourd’hui unanimement condamnées sur les plans éthique et juridique.
Une mutation paradigmatique profonde s’est opérée au cours des dernières décennies, portée par le mouvement des droits des personnes en situation de handicap. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), notamment ses articles sur le respect de la vie privée (Art. 22), le droit de se marier et de fonder une famille (Art. 23) et le droit à l’éducation (Art. 24), a fourni un cadre juridique international incontournable. Ce cadre déplace le curseur de la protection vers l’autodétermination (self-determination). Il ne s’agit plus de “gérer” une sexualité perçue comme problématique, mais de reconnaître et de soutenir le droit fondamental de chaque individu à vivre une vie affective et sexuelle épanouie, à faire ses propres choix et à exprimer ses désirs.
Ce changement de perspective implique de considérer la sexualité non plus comme une source de risques à éliminer, mais comme une dimension essentielle de l’identité humaine, contribuant au bien-être psychologique, à la qualité de vie et à l’estime de soi. La sexualité englobe bien plus que l’acte génital ; elle inclut l’intimité, l’affection, l’attachement, l’image corporelle, l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Nier l’accès à cette dimension de l’existence revient à amputer la personne d’une part de son humanité.
Par conséquent, l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVRAS) n’est plus une option, mais une obligation. Elle devient l’outil principal pour traduire le droit en réalité tangible. Son objectif n’est pas d’inciter à la sexualité, mais de fournir aux individus les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour comprendre leur propre corps, naviguer dans les relations interpersonnelles de manière saine et sécure, prendre des décisions éclairées et se protéger contre les abus. C’est un processus d’empowerment, visant à donner le pouvoir d’agir et de choisir, plutôt qu’un processus de contrôle visant à restreindre. Ce virage conceptuel est la pierre angulaire de toute approche moderne et respectueuse.
B. Déconstruire les Mythes et les Obstacles Systémiques
Malgré l’évolution du cadre juridique et éthique, la mise en œuvre d’une EVRAS efficace se heurte à des barrières profondément ancrées, qui sont à la fois cognitives (mythes et stéréotypes) et structurelles (obstacles systémiques).
Les mythes persistants :
- Le mythe de l’enfance éternelle : Comme évoqué précédemment, cette croyance considère les personnes avec DI comme asexuées, incapables de ressentir un désir amoureux ou sexuel authentique. Ce mythe conduit les familles et les professionnels à éviter le sujet, pensant à tort qu’ils protègent une innocence qui, en réalité, n’existe pas sous cette forme. Le résultat est une ignorance qui rend la personne extrêmement vulnérable à la manipulation et aux abus.
- Le stéréotype de l’hypersexualité ou de la déviance : C’est le pendant inverse du premier mythe. Il postule que les personnes avec DI ont des pulsions incontrôlables et une sexualité inappropriée. Cette peur conduit à des politiques institutionnelles restrictives, interdisant toute forme d’intimité et punissant sévèrement les manifestations naturelles de la sexualité (masturbation, flirt, etc.). Ce stéréotype ignore que les comportements jugés “inappropriés” sont souvent le fruit d’un manque total d’éducation sur les normes sociales (distinction public/privé, notion de consentement).
- La négation de la capacité à consentir : Un des obstacles les plus complexes est la présomption d’incapacité à donner un consentement éclairé à une relation sexuelle. Si la question du consentement est cruciale et doit être évaluée avec rigueur, une présomption généralisée d’incapacité est discriminatoire. Elle nie la possibilité pour une personne de comprendre, de désirer et d’accepter une relation intime, la condamnant de fait à une solitude affective et sexuelle.
Les obstacles systémiques :
- Les réticences parentales et familiales : Les familles sont souvent le premier et le plus grand frein. Leur angoisse est compréhensible : peur des abus sexuels, d’une grossesse non désirée, des infections sexuellement transmissibles (IST), ou encore du “qu’en-dira-t-on”. Pris entre un désir de protéger leur enfant et la reconnaissance de ses besoins d’adulte, beaucoup de parents choisissent l’évitement. Le personnage de la mère dans Mon Inséparable incarne parfaitement cette ambivalence déchirante.
- Le manque de formation des professionnels : Éducateurs, psychologues, soignants… nombreux sont les professionnels qui se sentent démunis et mal à l’aise pour aborder la sexualité. Le manque de formation initiale et continue sur les approches pédagogiques adaptées, sur le cadre légal et sur la gestion de leurs propres représentations constitue un obstacle majeur. Cette lacune conduit soit à un évitement du sujet, soit à des interventions maladroites et parfois contre-productives.
- Les politiques institutionnelles restrictives : De nombreuses institutions d’accueil (foyers, instituts médico-éducatifs) fonctionnent encore sur un principe de précaution poussé à l’extrême. Par crainte de poursuites judiciaires en cas d’incident, elles instaurent des règlements qui interdisent toute expression de la sexualité entre résidents. Ces politiques, bien que partant d’une intention protectrice, créent un environnement infantilisant qui va à l’encontre des principes d’autodétermination et du droit à la vie privée.
- L’absence de supports et d’outils pédagogiques adaptés : Les programmes d’éducation sexuelle standards sont massivement inadaptés aux personnes avec DI, car ils reposent sur un haut niveau d’abstraction, un langage complexe et des supports écrits denses. Le développement et la diffusion d’outils spécifiques (visuels, concrets, simplifiés) restent insuffisants.
Pour progresser, il est donc indispensable de mener une action concertée sur ces deux fronts : déconstruire activement les mythes par l’information et la sensibilisation, et réformer les structures en formant les acteurs et en développant des politiques et des outils véritablement inclusifs.
C. Les Fondements d’une Éducation Sexuelle Adaptée : Principes et Pédagogie
Une EVRAS destinée à un public avec déficience intellectuelle ne peut être une simple version “simplifiée” des programmes classiques. Elle doit reposer sur une architecture pédagogique spécifique, conçue pour répondre aux particularités cognitives et d’apprentissage de ces personnes. Les principes fondamentaux sont les suivants :
- Le concret et le littéral : Les personnes avec DI ont souvent des difficultés avec la pensée abstraite, les métaphores et l’implicite. L’éducation sexuelle doit donc utiliser un langage clair, direct, simple et sans euphémismes. Parler des parties du corps avec leurs noms anatomiques corrects (pénis, vulve, seins) est essentiel pour éviter la confusion et la honte. Les concepts doivent être liés à des situations de la vie quotidienne et à des expériences concrètes.
- L’utilisation massive de supports visuels : Le canal visuel est souvent un point fort. L’utilisation de pictogrammes, de photos, de dessins anatomiques clairs, de maquettes, de poupées sexuées ou de vidéos est primordiale. Les “scénarios sociaux” (social stories), qui décrivent une situation sociale étape par étape avec des supports visuels, sont particulièrement efficaces pour enseigner des compétences complexes comme le flirt, l’invitation à un rendez-vous ou la manière de dire non.
- La répétition, la structuration et la routine : L’apprentissage nécessite du temps et de la répétition espacée. Les séances d’EVRAS doivent être courtes, régulières et structurées. Le fait de revenir sur les mêmes concepts de différentes manières et à plusieurs reprises favorise la mémorisation et l’intégration des connaissances. Un cadre prévisible et routinier est rassurant et facilite l’apprentissage.
- L’individualisation de l’approche : La “déficience intellectuelle” n’est pas une catégorie homogène. Les capacités cognitives, le niveau de langage, les expériences de vie et les besoins varient énormément d’un individu à l’autre. Le programme éducatif doit donc être entièrement personnalisé. Une évaluation initiale des connaissances, des compétences et des désirs de la personne est un prérequis indispensable pour définir des objectifs d’apprentissage réalistes et pertinents pour elle.
- Un curriculum en spirale et holistique : L’EVRAS ne doit pas se limiter à la biologie de la reproduction et à la prévention des risques. Elle doit couvrir un large spectre de thématiques, abordées de manière progressive et répétée à différents âges et stades de développement (curriculum en spirale). Les thèmes essentiels incluent :
- L’anatomie et l’hygiène corporelle : Connaître son corps et savoir en prendre soin.
- L’image de soi et l’estime de soi : Développer une image positive de son corps et de sa personne.
- Les émotions et les sentiments : Identifier, nommer et gérer ses émotions (amour, désir, jalousie, rejet).
- Les relations sociales et amoureuses : Différencier les types de relations (amitié, amour), apprendre les codes sociaux de la séduction.
- L’intimité et les limites personnelles : Comprendre le concept d’espace personnel, la distinction public/privé.
- Le consentement : Savoir donner et reconnaître un consentement, savoir dire et accepter un “non”.
- La santé sexuelle : Contraception, prévention des IST.
- La sécurité : Identifier les situations à risque, les contacts inappropriés et savoir chercher de l’aide.
Cette approche pédagogique, exigeante mais efficace, transforme l’éducation sexuelle en un véritable apprentissage de compétences de vie (life skills), fondamentales pour l’autonomie et l’inclusion sociale.
D. Le Consentement Éclairé : Un Concept à Redéfinir et à Soutenir
Le concept de consentement est au cœur de toutes les craintes et de tous les débats. La question “Une personne avec une déficience intellectuelle peut-elle consentir ?” est mal posée. Elle est binaire et réductrice. La véritable question est : “Comment évaluer et soutenir la capacité d’une personne à consentir ?”.
Il est crucial de distinguer la capacité légale, qui peut être limitée par une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle), de la capacité fonctionnelle à prendre une décision spécifique. Une personne peut être sous tutelle pour la gestion de ses biens, mais posséder la capacité fonctionnelle de consentir à une relation sexuelle. La capacité n’est pas un interrupteur “on/off” ; elle est spécifique à une décision, peut fluctuer dans le temps et être influencée par le soutien apporté.
Pour évaluer la capacité à consentir à une relation sexuelle, les cliniciens et les chercheurs s’accordent sur plusieurs critères fonctionnels. La personne doit être capable de comprendre :
- La nature de l’acte : Comprendre qu’il s’agit d’une activité sexuelle impliquant un contact physique intime avec une autre personne.
- Les conséquences possibles : Avoir une compréhension de base des conséquences potentielles, tant positives (plaisir, intimité) que négatives (grossesse, IST, conséquences émotionnelles). Le niveau de détail requis pour cette compréhension doit être proportionné et non prohibitif.
- Le droit de choisir : Comprendre que la participation est volontaire et qu’elle a le droit de refuser à tout moment, sans subir de conséquences négatives.
Plutôt que de conclure hâtivement à une incapacité, l’approche moderne et éthique est celle de la prise de décision accompagnée (supported decision-making). Ce modèle, promu par la CDPH, consiste à fournir à la personne le soutien dont elle a besoin pour prendre ses propres décisions. Dans le contexte de la sexualité, ce soutien peut prendre plusieurs formes :
- Éducation adaptée : Fournir les informations nécessaires (sur l’acte, les risques, etc.) dans un format accessible (visuel, langage simple), comme décrit dans la section précédente.
- Soutien à la communication : Aider la personne à exprimer ses propres désirs, ses peurs et ses choix, en utilisant si besoin des outils de communication alternatifs et augmentatifs (CAA).
- Exploration des valeurs : Discuter avec la personne de ce qui est important pour elle dans une relation, de ses propres valeurs et limites.
- Un réseau de confiance : Aider la personne à identifier une ou plusieurs personnes de confiance (un parent, un éducateur, un psychologue) avec qui elle peut parler ouvertement de ses questions intimes, sans crainte de jugement ou d’interdiction.
Cette approche déplace la responsabilité des accompagnants. Leur rôle n’est plus de décider “à la place de”, mais de tout mettre en œuvre pour maximiser la capacité de la personne à décider par elle-même. Il s’agit de présumer la compétence et de fournir les soutiens nécessaires, plutôt que de présumer l’incompétence et d’imposer des restrictions. Cela demande une évaluation clinique fine, interdisciplinaire, et centrée sur les droits et la volonté de la personne.
E. Le Rôle Crucial de l’Écosystème : Familles, Professionnels et Institutions
L’éducation et l’autodétermination sexuelle ne peuvent se développer en vase clos. Elles dépendent de la cohérence et du soutien de l’ensemble de l’écosystème entourant la personne.
Les familles : Elles sont les partenaires incontournables. Il est essentiel de les accompagner pour les aider à surmonter leurs angoisses. Cela passe par :
- Des groupes de parole et de soutien : Permettre aux parents d’échanger sur leurs craintes et leurs expériences dans un cadre sécurisant.
- De la formation et de l’information : Leur fournir des informations claires sur le développement psycho-sexuel, les droits de leur enfant et les stratégies éducatives qu’ils peuvent mettre en place à la maison.
- Un travail sur leur propre posture : Les aider à opérer la transition délicate du rôle de protecteur exclusif à celui de soutien à l’autonomie. Le film Mon Inséparable illustre magnifiquement la douleur et la complexité de cette transition pour une mère.
Les professionnels : Leur montée en compétence est une priorité absolue.
- Formation spécialisée : Les cursus initiaux et la formation continue doivent intégrer des modules obligatoires et approfondis sur la sexualité et la DI, couvrant les aspects pédagogiques, éthiques et juridiques.
- Supervision et analyse des pratiques : Les professionnels ont besoin d’espaces régulés pour parler des situations complexes qu’ils rencontrent, pour analyser leurs propres réactions émotionnelles et leurs préjugés, et pour élaborer collectivement des stratégies d’intervention adaptées.
- Adoption d’une posture d’allié : Le professionnel doit se voir comme un facilitateur, un allié de la personne dans sa quête d’autodétermination, et non comme un agent de contrôle.
Les institutions : Elles doivent passer d’une logique de risque zéro à une logique de gestion éclairée des risques et de promotion des droits.
- Élaboration de politiques proactives : Les institutions doivent rédiger et mettre en œuvre des “chartes de la vie affective et sexuelle” claires, co-construites avec les résidents, les familles et les professionnels. Ces chartes doivent définir les droits et les devoirs de chacun, les procédures d’accompagnement et les règles de vie commune (par exemple, des politiques sur l’intimité dans les chambres).
- Création d’espaces d’intimité : Reconnaître le droit à la vie privée implique de garantir la possibilité pour les résidents d’avoir des moments d’intimité, seuls ou à deux, dans le respect des autres.
- Mise en place de personnes-ressources : Désigner au sein de l’équipe des “référents vie affective et sexuelle” spécifiquement formés, vers qui les résidents et les autres professionnels peuvent se tourner.
C’est uniquement par une action coordonnée et synergique de cet écosystème qu’un environnement véritablement capacitant et respectueux pourra être créé.
F. “Mon Inséparable” comme Miroir Sociétal : De la Fiction à la Réalité Clinique
Le film d’Anne-Sophie Bailly, au-delà de sa valeur artistique, agit comme un puissant miroir des réalités cliniques et sociales que nous venons de décrire. Il n’est pas un documentaire, mais sa force réside dans sa capacité à incarner les concepts abstraits et à donner un visage humain aux tensions systémiques.
Le personnage de Jo n’est pas présenté comme un “cas” ou un problème, mais comme un jeune homme avec des désirs, des aspirations et une volonté propre. Sa quête amoureuse est le moteur du récit, ce qui force le spectateur à reconnaître la légitimité de son besoin d’intimité et d’affection. Le film déconstruit ainsi, par la narration, le mythe de l’enfance éternelle.
La figure de la mère, interprétée avec une grande justesse, est l’archétype de l’ambivalence parentale. Son amour est indéniable, tout comme sa peur panique. Elle veut le bonheur de son fils, mais sa définition du bonheur entre en conflit avec la vision que Jo a pour lui-même. Son parcours est celui d’un lâcher-prise difficile, une illustration clinique parfaite de la transition nécessaire du parent-protecteur au parent-soutien. Le film montre que cette transition est douloureuse et qu’elle nécessite un accompagnement.
L’institution, représentée dans le film, met en lumière les obstacles systémiques. On y voit probablement des professionnels bien intentionnés mais prisonniers d’un cadre rigide, où le principe de précaution prime sur le projet de vie de la personne. La réaction de l’institution face à la relation amoureuse de Jo est un cas d’école des politiques restrictives qui, en voulant prévenir tout risque, étouffent la vie.
Enfin, Mon Inséparable soulève la question du consentement et du “bon choix” de manière nuancée. La partenaire de Jo est-elle “la bonne personne” ? Est-il “prêt” ? Le film a l’intelligence de ne pas donner de réponse simple. Il suggère que le droit à l’autodétermination inclut aussi le droit à l’erreur, le droit de faire ses propres expériences, même si elles sont imparfaites ou douloureuses. C’est un droit fondamental pour toute personne, qu’elle ait ou non une déficience intellectuelle.
En portant ce sujet sur la place publique, le film joue un rôle sociétal majeur. Il initie une conversation nécessaire, humanise le débat et peut servir de formidable outil de sensibilisation pour les familles, les professionnels et le grand public. Il crée une brèche émotionnelle et cognitive dans laquelle le discours scientifique et clinique peut et doit s’engouffrer pour proposer des solutions concrètes et durables.
Conclusion
L’enjeu de l’éducation à la vie affective et sexuelle pour les personnes présentant une déficience intellectuelle transcende largement la simple transmission de connaissances biologiques ou préventives. Il s’agit d’un impératif éthique et d’un levier fondamental d’émancipation. Comme le met en lumière une fiction poignante telle que Mon Inséparable, nous sommes confrontés à un choix de société : continuer à enfermer ces individus dans une citadelle de protection qui les prive de leur pleine humanité, ou leur donner les clés pour explorer le monde complexe mais essentiel des relations humaines.
La science et la clinique nous montrent que la seconde voie, bien que plus exigeante, est la seule qui soit digne. Elle requiert de démanteler les mythes tenaces, de former en profondeur tous les acteurs de l’écosystème, de développer des pédagogies innovantes, concrètes et individualisées, et de repenser le concept de consentement non pas comme une barrière infranchissable, mais comme une capacité à construire et à soutenir.
Le passage d’un paradigme de contrôle à un paradigme d’autodétermination n’est pas une utopie. Il s’agit d’un processus complexe qui demande du courage politique, un investissement dans la formation et la recherche, et surtout, un changement de regard collectif. Il nous faut accepter que le droit à l’amour, au désir et à l’intimité est un droit humain universel, et que notre devoir n’est pas de le restreindre par peur, mais de le rendre possible par l’éducation, le respect et le soutien. C’est à cette condition que nous pourrons construire une société véritablement inclusive, où la vulnérabilité n’est plus un prétexte à l’exclusion, mais une invitation à une solidarité plus attentive et plus intelligente.
Les sources :
Beddows, E., & Taggart, L. (2021). ‘Let’s talk about sex’: The views of men with intellectual disabilities on receiving relationships and sexuality education. Journal of Intellectual Disabilities, 25(2), 205–221. https://doi.org/10.1177/1744629519875501
Brown, M., & McCann, E. (2018). The role of the mental health nurse in sexual health promotion for people with intellectual disabilities: A systematic review. Journal of Clinical Nursing, 27(19-20), 3531–3544. https://doi.org/10.1111/jocn.14515
Choi, H., & Lee, J. (2022). A systematic review of sex education programs for individuals with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 40(3), 431–451. https://doi.org/10.1007/s11195-022-09744-9
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division des politiques sociales et du développement social. (2018). Sexual and reproductive health of young persons with disabilities. https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/YPWD_SRH_final.pdf
Morin, D., & L’Heureux, D. (2021). La vie amoureuse et sexuelle des personnes ayant une déficience intellectuelle : perspectives des parents. Revue francophone de la déficience intellectuelle, 32, 70-85. https://doi.org/10.7202/1084227ar
Parchomiuk, M. (2019). The sexual needs of people with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 37(4), 491-502. https://doi.org/10.1007/s11195-019-09594-8
Servais, L. (2017). Sexual health care in persons with intellectual disabilities. In Textbook of Clinical Pediatrics (pp. 1-13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31962-9_171-1
Whittle, C., & Butler, C. (2018). The challenges for support staff in safeguarding the sexual well‐being of adults with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(1), e163-e173. https://doi.org/10.1111/jar.12320