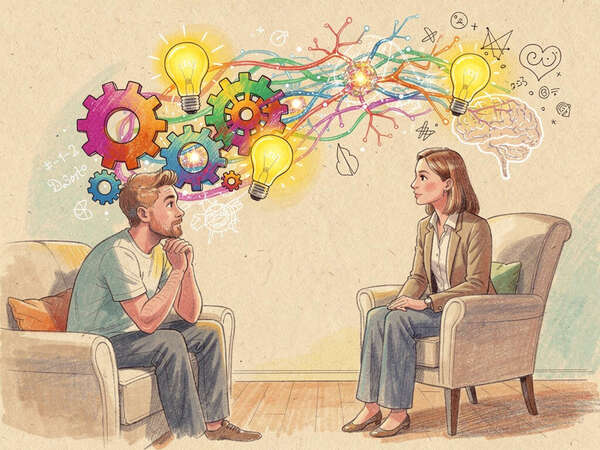Quel est le rôle des familles dans le soutien aux personnes avec une déficience intellectuelle ?
Au cœur de notre expérience d'être humain se trouve la famille, non pas comme une simple unité sociale, mais comme le premier et le plus fondamental des écosystèmes développementaux. C’est au sein de cette matrice relationnelle que l’individu forge son identité, ses compétences et sa perception du monde. Pour une personne présentant une déficience intellectuelle, cette réalité ontologique est amplifiée de manière exponentielle. Loin d’être un simple groupe de pourvoyeurs de soins, la famille devient l’épicentre d’un univers complexe de soutien, d’adaptation et de résilience. L’évolution des paradigmes sociétaux, marquant un passage progressif de l’institutionnalisation systématique vers l’inclusion communautaire, a repositionné la famille au premier plan, lui conférant des responsabilités immenses, souvent sans la reconnaissance ou les ressources adéquates.
Cet article se propose d’explorer en profondeur la nature multidimensionnelle et la portée capitale du soutien familial pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Nous nous détacherons d’une vision simpliste du “fardeau” pour embrasser une perspective systémique et dynamique, reconnaissant la nature réciproque des influences entre l’individu et son entourage. En naviguant à travers les cadres conceptuels, les phases critiques du développement, les impacts psychologiques sur l’ensemble du système familial et les facteurs qui modulent l’efficacité de ce soutien, nous chercherons à brosser un portrait rigoureux et nuancé. L’objectif est de mettre en lumière non seulement le rôle de la famille, mais aussi les conditions nécessaires pour que ce rôle puisse s’exercer de manière constructive et durable, en partenariat avec les systèmes de soutien formels. Il s’agit, in fine, de comprendre comment l’alchimie familiale peut se transformer en un levier puissant pour l’autodétermination et la qualité de vie.
A. Cadres Conceptuels : Définir la Déficience Intellectuelle et le Soutien Familial
Pour mener une analyse rigoureuse, une clarification terminologique et conceptuelle s’impose. La compréhension contemporaine de la déficience intellectuelle s’est considérablement éloignée des anciens modèles purement déficitaires centrés sur le quotient intellectuel (QI). L’Association Américaine sur les Déficiences Intellectuelles et Développementales (AAIDD) propose une définition multidimensionnelle qui fait aujourd’hui consensus. La déficience intellectuelle est caractérisée par des limitations significatives à la fois dans le fonctionnement intellectuel (raisonnement, planification, résolution de problèmes, pensée abstraite, apprentissage) et dans le comportement adaptatif, qui recouvre un ensemble de compétences conceptuelles, sociales et pratiques. Ces limitations doivent se manifester avant l’âge de 22 ans.
Ce qui est fondamental dans cette définition moderne, c’est l’interaction entre les limitations de l’individu et l’environnement dans lequel il évolue. La performance d’une personne n’est pas une caractéristique intrinsèque et immuable, mais le produit d’une interaction dynamique avec son contexte. C’est ici que le concept de soutien prend toute son importance. Le soutien est défini comme l’ensemble des ressources et des stratégies visant à promouvoir le développement, l’éducation, les intérêts et le bien-être d’une personne, et à améliorer son fonctionnement individuel. L’évaluation de la déficience intellectuelle ne se limite plus à mesurer les déficits, mais vise surtout à identifier l’intensité des besoins de soutien dans différentes sphères de la vie.
Le soutien familial constitue la forme la plus prégnante et la plus continue de ce soutien. Il est lui-même un concept multidimensionnel que l’on peut décomposer en plusieurs facettes interdépendantes :
Le soutien émotionnel : C’est sans doute le pilier le plus fondamental. Il englobe l’amour inconditionnel, l’acceptation, l’affection, l’empathie et la validation. Il crée un sentiment de sécurité et d’appartenance qui est le socle de l’estime de soi et de la résilience psychologique. Pour une personne souvent confrontée au rejet ou à l’incompréhension sociale, la famille est le refuge où sa valeur intrinsèque n’est pas remise en question.
Le soutien instrumental : Il s’agit de l’aide concrète et pratique apportée au quotidien. Cela va de l’aide pour les soins personnels (hygiène, habillement), la gestion des repas et du domicile, à l’accompagnement aux rendez-vous médicaux et thérapeutiques, en passant par la gestion administrative et financière. Ce type de soutien est souvent le plus visible et le plus exigeant en termes de temps et d’énergie.
Le soutien informationnel : Les familles deviennent rapidement des expertes dans un domaine qu’elles n’ont pas choisi. Elles doivent naviguer dans des systèmes complexes : médical, éducatif, social et juridique. Le soutien informationnel consiste à rechercher, comprendre, synthétiser et transmettre des informations pertinentes sur la condition de leur proche, les thérapies disponibles, les droits sociaux, les structures d’accueil ou les opportunités d’emploi. Elles agissent comme des courtiers en information, filtrant un flux souvent dense et contradictoire.
Le soutien à l’estime de soi et à l’autodétermination (Appraisal Support) : Cette dimension est plus subtile mais cruciale. Il s’agit d’aider la personne à construire une image positive d’elle-même, en se focalisant sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Cela implique d’encourager la prise de décision, de respecter ses choix (même s’ils comportent un risque calculé), de lui offrir des opportunités d’exprimer ses préférences et de développer son autonomie. C’est un soutien qui vise à renforcer le sentiment de compétence et de contrôle sur sa propre vie, un des piliers de la qualité de vie.
Comprendre le soutien familial à travers ces quatre dimensions permet de dépasser une vision monolithique et de saisir la complexité des actions et des attitudes qui, au quotidien, façonnent la trajectoire de vie de la personne avec une déficience intellectuelle.
B. La Famille comme Microsystème Développemental Primaire
La théorie des systèmes écologiques du développement humain d’Urie Bronfenbrenner offre un cadre puissant pour comprendre l’influence de la famille. Selon ce modèle, le développement de l’individu est le produit d’interactions progressives et réciproques entre un organisme biopsychologique actif et les personnes, objets et symboles de son environnement immédiat. Cet environnement immédiat est le microsystème, et pour tout enfant, le premier et le plus influent de ces microsystèmes est la famille.
Dans le contexte de la déficience intellectuelle, le rôle de ce microsystème familial est exacerbé. Dès les premiers instants de la vie, la famille devient l’architecte principal de l’environnement développemental de l’enfant.
- 1. Stimulation précoce et plasticité cérébrale :
La recherche en neurosciences a largement démontré l’incroyable plasticité du cerveau durant la petite enfance. Les interactions précoces, la richesse des stimulations sensorielles, langagières et motrices sont déterminantes. Les familles d’enfants avec une déficience intellectuelle sont souvent encouragées, via des programmes d’intervention précoce, à devenir des co-thérapeutes. Elles apprennent à créer un environnement enrichi, à adapter les jeux, à utiliser des techniques de communication alternatives ou augmentatives, et à célébrer chaque micro-progrès. Ces interactions quotidiennes et répétées ne sont pas de simples activités ; elles constituent des expériences qui sculptent littéralement les connexions neuronales et peuvent optimiser le potentiel de développement de l’enfant, opérant dans sa “zone proximale de développement”, pour reprendre le concept de Vygotsky. - 2. Construction de l’attachement et régulation émotionnelle :
La qualité du lien d’attachement entre l’enfant et ses figures parentales est un prédicteur majeur de la santé mentale et des compétences sociales futures. Pour un enfant qui peut avoir des difficultés à interpréter les signaux sociaux ou à exprimer ses besoins de manière conventionnelle, la capacité des parents à être sensibles, réceptifs et constants est cruciale. Un attachement sécure, forgé par des réponses parentales adéquates et affectueuses, offre à l’enfant une base de sécurité à partir de laquelle il peut explorer le monde. Il internalise un modèle de relations basé sur la confiance et apprend les rudiments de la régulation émotionnelle en observant et en étant guidé par ses parents. Cette sécurité affective est un bouclier contre l’anxiété et favorise une meilleure adaptation sociale à long terme. - 3. Médiation du monde social et avocat du système éducatif :
La famille est le premier interprète du monde pour l’enfant. Elle lui apprend les codes sociaux, les normes et les attentes. Pour l’enfant avec une déficience intellectuelle, la famille joue un rôle de médiateur encore plus actif. Elle explique le monde à l’enfant, mais aussi, et c’est fondamental, elle explique l’enfant au monde. Elle doit éduquer l’entourage élargi (grands-parents, voisins, amis) pour déconstruire les préjugés et favoriser une inclusion authentique.
Ce rôle d’avocat devient central lors de l’entrée dans le système scolaire. Les parents doivent se battre pour obtenir un diagnostic correct, un plan d’éducation individualisé (PEI) ou un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) adapté, des aides humaines et matérielles, et souvent, pour défendre le principe même de l’inclusion en milieu ordinaire. Ils deviennent des négociateurs, des experts de la législation et des partenaires (parfois critiques) de l’institution scolaire. La qualité de cet engagement parental a un impact direct sur la qualité de l’expérience éducative de l’enfant et, par conséquent, sur ses acquisitions cognitives et sociales.
En somme, le microsystème familial n’est pas un décor passif. Il est une force active et dynamique qui structure les opportunités d’apprentissage, de socialisation et de développement affectif, posant ainsi les fondations sur lesquelles toute la trajectoire de vie de l’individu sera construite.
C. Le Soutien Familial à l’Épreuve des Transitions de Vie
La vie d’une personne avec une déficience intellectuelle, comme toute vie, est jalonnée de transitions. Cependant, ces passages sont souvent plus complexes, plus anxiogènes et requièrent une planification et un soutien plus intenses de la part de la famille. Le rôle de cette dernière évolue de manière significative à chaque étape.
- 1. L’annonce du diagnostic et la petite enfance :
Le moment du diagnostic est une crise normative pour la plupart des familles. Il marque une rupture avec les attentes et les projections parentales, entraînant un processus de deuil du “bébé imaginaire”. Les réactions initiales peuvent inclure le choc, le déni, la colère, la tristesse et la culpabilité. Le soutien familial à ce stade est d’abord intra-familial : le couple parental doit se soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve. Le soutien du réseau élargi est également crucial. La capacité de la famille à se réorganiser, à accepter la nouvelle réalité et à se mobiliser est un facteur pronostique majeur. Passée la phase de choc, la famille entre dans une période d’apprentissage intense, devenant le gestionnaire en chef des soins et des interventions précoces. - 2. Les années scolaires : L’équilibre entre protection et inclusion :
Durant la scolarité, la famille doit trouver un équilibre délicat. D’un côté, elle doit protéger son enfant du harcèlement, de l’échec et de la stigmatisation. De l’autre, elle doit le pousser vers l’inclusion sociale et l’autonomie, ce qui implique de le laisser prendre des risques. Les parents sont en première ligne pour faciliter les amitiés, organiser des activités extrascolaires adaptées et s’assurer que l’inclusion ne se résume pas à une simple présence physique dans une salle de classe. Ils doivent constamment évaluer les bénéfices sociaux de l’inclusion par rapport aux éventuelles difficultés académiques ou émotionnelles. - 3. L’adolescence et la transition vers l’âge adulte :
Cette période est marquée par des défis spécifiques et majeurs. La puberté et l’émergence de la sexualité sont des sujets souvent tabous et anxiogènes pour les parents, qui craignent les abus, les grossesses non désirées ou l’exploitation. Pourtant, une éducation sexuelle adaptée, fournie dans un cadre familial sécurisant, est essentielle au développement d’une vie affective et sexuelle saine et consentie.
La transition vers l’âge adulte (généralement entre 18 et 25 ans) est une autre falaise à franchir. Alors que les pairs sans handicap quittent le nid familial pour les études ou le travail, la trajectoire est moins linéaire. La fin du système scolaire protégé peut représenter un “précipice de services”, où les soutiens s’amenuisent brutalement. La famille doit alors explorer les options de formation professionnelle, d’emploi en milieu protégé ou ordinaire, de logement (maintien à domicile, foyer de vie, habitat inclusif). La tension entre le désir d’autonomie de l’adulte émergent et le besoin de sécurité des parents est à son paroxysme. Encourager l’autodétermination tout en assurant un filet de sécurité est un art d’équilibriste. - 4. L’âge adulte et le vieillissement :
Une fois l’adulte “installé” dans un projet de vie, le soutien familial se transforme mais ne disparaît pas. Il devient plus un rôle de supervision, de conseil et de soutien émotionnel. La famille peut aider à la gestion du budget, à l’organisation des loisirs et au maintien des liens sociaux.
Un enjeu critique et universel est le vieillissement des parents. La question “Qui s’occupera de mon enfant quand je ne serai plus là ?” est une source d’angoisse profonde et constante pour de nombreux parents vieillissants. La planification de l’avenir (succession, tutelle/curatelle, désignation d’autres référents) devient une priorité absolue. Cette planification est souvent retardée par la difficulté émotionnelle à envisager sa propre fin et l’incertitude quant aux solutions pérennes. Le rôle des frères et sœurs (siblings) devient alors prépondérant, ce qui soulève des questions complexes sur leurs propres désirs, responsabilités et capacités à prendre le relais.
À chaque étape, la famille doit s’adapter, acquérir de nouvelles compétences et redéfinir son rôle, passant de soignant à éducateur, puis à avocat, à coach de vie et enfin à planificateur pour l’avenir.
D. L’Impact Psychologique sur le Système Familial : Une Dynamique de Réciprocité
La présence d’un membre avec une déficience intellectuelle ne touche pas seulement l’individu concerné ; elle reconfigure l’ensemble du système familial. La recherche a longtemps adopté un prisme pathologisant, se concentrant sur le stress, le fardeau (“burden of care”) et la détresse parentale. Si ces aspects sont réels et ne doivent pas être minimisés, une vision plus équilibrée, issue de la psychologie positive et de la théorie de la résilience, est aujourd’hui nécessaire.
- 1. Stress, adaptation et résilience parentale :
Il est indéniable que les parents, et en particulier les mères qui assument encore majoritairement la charge des soins, rapportent des niveaux de stress chronique plus élevés. Les sources de stress sont multiples : les exigences des soins quotidiens, les soucis financiers liés aux thérapies et à la perte de revenus, l’incertitude face à l’avenir, le combat contre les institutions et le sentiment d’isolement social.
Cependant, la plupart des familles développent des stratégies d’adaptation (coping) efficaces. Ces stratégies peuvent être centrées sur le problème (rechercher des informations, planifier, demander de l’aide professionnelle) ou sur l’émotion (rechercher du soutien social, recadrer cognitivement la situation, pratiquer des activités de détente). La résilience familiale n’est pas l’absence de stress, mais la capacité du système à absorber les chocs, à se réorganiser et à continuer de fonctionner, parfois même en sortant renforcé de l’épreuve. - 2. Les transformations positives et la croissance post-traumatique :
De nombreuses études qualitatives mettent en lumière des aspects transformateurs positifs rapportés par les familles. Les parents décrivent souvent un changement dans leur système de valeurs, avec une plus grande appréciation des choses simples de la vie, une tolérance accrue et une empathie plus profonde. Ils rapportent avoir développé de nouvelles compétences, une plus grande patience et une force intérieure insoupçonnée. La famille peut devenir plus soudée, unie par un objectif commun. Ce phénomène, parfois assimilé à une forme de croissance post-traumatique, montre que l’expérience, bien que difficile, peut être une source de sens et de maturation personnelle et familiale. - 3. La place et l’expérience des frères et sœurs (Siblings) :
Les frères et sœurs d’une personne avec une déficience intellectuelle vivent une expérience unique et complexe, souvent ambivalente. D’une part, ils peuvent ressentir de la jalousie face au temps et à l’attention parentale accordés à leur frère/sœur, de la gêne sociale, de la colère face aux contraintes imposées à la vie familiale, et une anxiété quant à leur responsabilité future. Le risque de “parentification”, où l’enfant assume prématurément des rôles de soignant, est réel.
D’autre part, de nombreux siblings rapportent des bénéfices significatifs. Ils développent souvent une maturité, une empathie, une tolérance et un sens des responsabilités supérieurs à la moyenne. Ils sont fiers des accomplissements de leur frère/sœur et développent avec lui/elle un lien affectif très fort. Leur choix de carrière est fréquemment influencé par leur expérience, les orientant vers les métiers du soin, de l’éducation ou du social. Il est crucial de reconnaître et de soutenir les besoins spécifiques des fratries, en leur offrant des espaces de parole et en les déchargeant d’une responsabilité future non choisie et trop lourde. - 4. La dynamique du couple parental :
La gestion du handicap peut être un ciment ou un explosif pour le couple. Les divergences d’opinions sur l’éducation, la répartition inégale des tâches, l’épuisement physique et émotionnel et le manque de temps pour la vie de couple peuvent mettre la relation à rude épreuve. Cependant, de nombreux couples rapportent que le fait de surmonter ensemble ces défis a renforcé leur lien, leur communication et leur admiration mutuelle. La qualité de la relation conjugale est un facteur clé de la santé mentale des parents et de la qualité globale du climat familial. - Facteurs Médiateurs et Modérateurs de l’Efficacité du Soutien Familial
Toutes les familles ne sont pas égales face au défi que représente l’accompagnement d’un proche avec une déficience intellectuelle. L’efficacité et la durabilité du soutien familial sont influencées par une constellation de facteurs qui peuvent soit l’amplifier, soit l’entraver.
- 1. Les ressources socio-économiques :
Le statut socio-économique est un modérateur puissant. Les familles disposant de revenus plus élevés ont un meilleur accès aux thérapies privées (psychomotricité, orthophonie, ergothérapie), à du matériel adapté, à des services de répit payants et peuvent plus facilement compenser une perte de revenus si l’un des parents réduit son temps de travail. À l’inverse, les familles précaires cumulent les difficultés : logements inadaptés, stress financier chronique, et moindre capacité à naviguer dans des systèmes administratifs complexes pour faire valoir leurs droits. Le “coût du handicap” est une réalité tangible qui pèse lourdement sur les familles les plus modestes. - 2. Le capital social et le soutien extra-familial :
La qualité du réseau social de la famille est déterminante. Un soutien informel solide de la part des grands-parents, oncles, tantes, amis ou voisins peut fournir une aide pratique (garder l’enfant quelques heures) et un soutien émotionnel inestimables. L’appartenance à des associations de parents est également un facteur protecteur majeur. Ces associations brisent l’isolement, permettent le partage d’expériences et d’informations (“savoirs expérientiels”), et constituent une force de plaidoyer collectif. Une famille isolée est une famille en danger d’épuisement. - 3. Les croyances culturelles et la perception du handicap :
La manière dont une culture conçoit le handicap influence profondément les réactions familiales. Dans certaines cultures, le handicap peut être perçu comme une honte, une punition divine ou un secret à cacher, menant à la stigmatisation et à l’isolement de la famille. Dans d’autres, une forte cohésion communautaire et des valeurs de solidarité peuvent fournir un soutien naturel et déculpabilisant. La perception que la famille a elle-même de la déficience intellectuelle (comme une tragédie insurmontable ou comme une caractéristique parmi d’autres) est également un filtre cognitif qui va colorer toutes ses stratégies d’adaptation. - 4. Les caractéristiques de la personne avec déficience intellectuelle :
Il est évident que l’intensité des besoins de soutien de la personne elle-même est un facteur important. La présence de troubles du comportement sévères (agressivité, automutilation), de problèmes de santé complexes ou de handicaps multiples (polyhandicap) augmente de manière significative les exigences en matière de soins et le niveau de stress parental. - 5. La dynamique interne de la famille :
Au-delà des facteurs externes, le fonctionnement interne de la famille est primordial. Une famille avec des schémas de communication clairs et ouverts, une bonne capacité à résoudre les problèmes, une flexibilité dans la répartition des rôles et une cohésion forte sera plus à même de s’adapter. À l’inverse, des conflits préexistants, une communication dysfonctionnelle ou une rigidité dans les rôles peuvent être exacerbés par la situation et entraver la capacité de la famille à fournir un soutien cohérent et efficace. - Du Soutien Familial aux Systèmes Formels : La Nécessité d’un Partenariat Authentique
Si la famille est le pilier du soutien, elle ne peut et ne doit pas tout porter seule. Laisser reposer l’intégralité de la responsabilité sur les familles est non seulement irréaliste, mais aussi éthiquement problématique. Une politique d’inclusion réussie repose sur un partenariat solide et respectueux entre le soutien informel (la famille) et le soutien formel (les services professionnels, les institutions).
Le paradigme de la planification centrée sur la personne (Person-Centered Planning) est au cœur de cette collaboration. Cette approche place la personne avec une déficience intellectuelle et sa famille au centre du processus de décision. Il ne s’agit plus pour les professionnels d’imposer un plan “d’en haut”, mais de co-construire un projet de vie basé sur les forces, les préférences et les rêves de la personne. Dans ce modèle, les parents ne sont plus considérés comme de simples “bénéficiaires” ou des “clients”, mais comme des experts de leur enfant, dont le savoir expérientiel est aussi légitime et précieux que le savoir académique des professionnels.
Pour que ce partenariat soit authentique, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’empowerment familial : Les services doivent viser à renforcer les compétences et la confiance des familles, et non à créer une dépendance. Cela passe par la formation, l’information accessible et le soutien à la prise de décision.
- La flexibilité et l’individualisation des services : Les services doivent s’adapter aux besoins uniques de chaque famille, et non l’inverse. Les budgets personnalisés ou les chèques-services sont des exemples de dispositifs qui vont dans ce sens, en donnant aux familles plus de contrôle sur l’organisation du soutien.
- L’offre de services de répit de qualité : Le répit n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale pour prévenir l’épuisement parental et préserver l’équilibre de toute la famille. Des solutions de répit variées, accessibles et fiables sont un des investissements les plus efficaces pour assurer la durabilité du soutien familial à long terme.
- Le soutien aux fratries et aux aidants : Les politiques publiques doivent reconnaître la famille comme une unité. Cela implique de proposer des services de soutien psychologique et des groupes de parole non seulement pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs et autres proches aidants.
En définitive, l’objectif n’est pas de “soulager” la famille pour que les professionnels prennent le relais, mais de soutenir la famille pour qu’elle puisse continuer à jouer son rôle irremplaçable dans les meilleures conditions possibles. C’est un changement de posture fondamental : passer d’une logique de prise en charge à une logique de partenariat et de capacitation.
Conclusion
L’analyse approfondie du rôle du soutien familial pour les personnes avec une déficience intellectuelle révèle une réalité d’une immense complexité, bien loin des représentations simplistes. La famille n’est pas une entité statique, mais un système dynamique, résilient et adaptatif, qui constitue le creuset fondamental du développement, de l’identité et de la qualité de vie. De la stimulation précoce à la planification de l’avenir pour un parent vieillissant, le soutien familial se métamorphose continuellement, exigeant une plasticité émotionnelle, cognitive et organisationnelle hors du commun. Nous avons vu que ce parcours, s’il est jonché de défis et de sources de stress indéniables, est également porteur de transformations profondes et de croissance, reconfigurant les valeurs et renforçant les liens.
Cependant, l’efficacité de ce pilier central n’est pas inconditionnelle. Elle est intimement liée à un ensemble de facteurs contextuels – socio-économiques, culturels, sociaux – et dépend de manière critique de la qualité de l’articulation avec les systèmes de soutien formels. L’ère de l’inclusion communautaire nous impose un impératif éthique et pragmatique : reconnaître la famille non comme un simple fournisseur de services gratuits, mais comme un partenaire expert et indispensable.
Pour l’avenir, la recherche et les politiques publiques doivent opérer un changement de focale décisif. Il ne s’agit plus seulement de se demander “comment aider la personne avec une déficience intellectuelle ?”, mais “comment soutenir l’ensemble de l’écosystème familial pour qu’il puisse être un levier d’épanouissement pour tous ses membres ?”. Cela implique de concevoir des services qui renforcent les capacités familiales, qui respectent l’expertise parentale, qui offrent des solutions de répit vitales et qui n’oublient aucun membre du système, notamment les fratries. Car en définitive, investir dans le bien-être et la résilience de la famille est l’investissement le plus sûr et le plus humain pour garantir une vie digne, autonome et pleine de sens à la personne qu’elle entoure de son soutien.
Les Sources :
Bigby, C., & Frawley, P. (2010). Social inclusion and people with intellectual disability and their families: A literature review. La Trobe University. https://www.latrobe.edu.au/health/about/schools-and-departments/living-with-disability-research-centre/publications/bigby-and-frawley-2010-social-inclusion-and-people-with-intellectual-disability-and-their-families
Glidden, L. M., & Jobe, J. B. (2021). The shifting sands of family life and intellectual disability: A 50-year retrospective. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 126(6), 469–485. https://doi.org/10.1352/1944-7558-126.6.469
Griffith, G. M., & Hastings, R. P. (2014). “He’s a whole new ball game”: Positive impact and resilience in parents of children with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(3), 256-267. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12069
Heller, T., & Arnold, C. K. (2010). The context of aging in the family and community for people with intellectual and developmental disabilities. International Review of Research in Developmental Disabilities, 39, 131-168. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123809277000040
McConnell, D., & Savage, A. (2015). Stress and resilience among families caring for children with intellectual disability. Social Work and Social Sciences Review, 17(2), 6-22. https://journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/article/view/970
Petalas, M. A., Hastings, R. P., Totsika, V., Moutzouri, I., & Felce, D. (2012). The quality of life of Greek siblings of children with intellectual disabilities: The role of family and sibling factors. Research in Developmental Disabilities, 33(4), 1141-1151. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.02.007
Schalock, R. L., Borthwick-Duffy, S. A., Bradley, V. J., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., … & Yeager, M. H. (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (11th ed.). American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition
Totsika, V., Hastings, R. P., Emerson, E., Lancaster, G. A., & Berridge, D. M. (2011). A population-based investigation of behavioural and emotional problems and maternal mental health: associations with autism spectrum disorder and intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 90-99. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02295.x